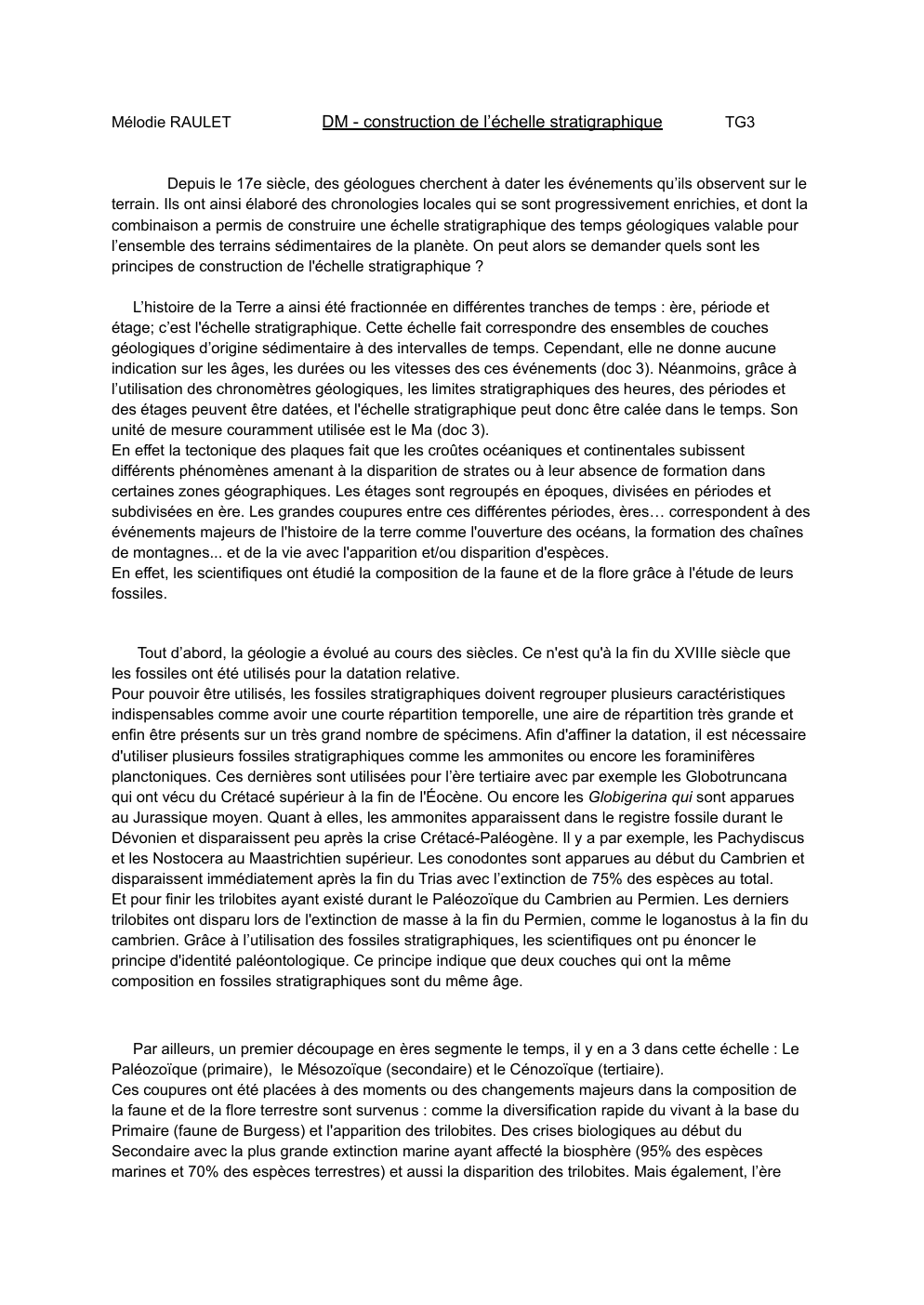Justifier la construction de l'échelle stratographique
Publié le 01/11/2022
Extrait du document
«
DM - construction de l’échelle stratigraphique
TG3
Depuis le 17e siècle, des géologues cherchent à dater les événements qu’ils observent sur le
terrain.
Ils ont ainsi élaboré des chronologies locales qui se sont progressivement enrichies, et dont la
combinaison a permis de construire une échelle stratigraphique des temps géologiques valable pour
l’ensemble des terrains sédimentaires de la planète.
On peut alors se demander quels sont les
principes de construction de l'échelle stratigraphique ?
L’histoire de la Terre a ainsi été fractionnée en différentes tranches de temps : ère, période et
étage; c’est l'échelle stratigraphique.
Cette échelle fait correspondre des ensembles de couches
géologiques d’origine sédimentaire à des intervalles de temps.
Cependant, elle ne donne aucune
indication sur les âges, les durées ou les vitesses des ces événements (doc 3).
Néanmoins, grâce à
l’utilisation des chronomètres géologiques, les limites stratigraphiques des heures, des périodes et
des étages peuvent être datées, et l'échelle stratigraphique peut donc être calée dans le temps.
Son
unité de mesure couramment utilisée est le Ma (doc 3).
En effet la tectonique des plaques fait que les croûtes océaniques et continentales subissent
différents phénomènes amenant à la disparition de strates ou à leur absence de formation dans
certaines zones géographiques.
Les étages sont regroupés en époques, divisées en périodes et
subdivisées en ère.
Les grandes coupures entre ces différentes périodes, ères… correspondent à des
événements majeurs de l'histoire de la terre comme l'ouverture des océans, la formation des chaînes
de montagnes...
et de la vie avec l'apparition et/ou disparition d'espèces.
En effet, les scientifiques ont étudié la composition de la faune et de la flore grâce à l'étude de leurs
fossiles.
Tout d’abord, la géologie a évolué au cours des siècles.
Ce n'est qu'à la fin du XVIIIe siècle que
les fossiles ont été utilisés pour la datation relative.
Pour pouvoir être utilisés, les fossiles stratigraphiques doivent regrouper plusieurs caractéristiques
indispensables comme avoir une courte répartition temporelle, une aire de répartition très grande et
enfin être présents sur un très grand nombre de spécimens.
Afin d'affiner la datation, il est nécessaire
d'utiliser plusieurs fossiles stratigraphiques comme les ammonites ou encore les foraminifères
planctoniques.
Ces dernières sont utilisées pour l’ère tertiaire avec par exemple les Globotruncana
qui ont vécu du Crétacé supérieur à la fin de l'Éocène.
Ou encore les Globigerina qui sont apparues
au Jurassique moyen.
Quant à elles, les ammonites apparaissent dans le registre fossile durant le
Dévonien et disparaissent peu après la crise Crétacé-Paléogène.
Il y a par exemple, les Pachydiscus
et les Nostocera au Maastrichtien supérieur.
Les conodontes sont apparues au début du Cambrien et
disparaissent immédiatement après la fin du Trias avec l’extinction de 75% des espèces au total.
Et pour finir les trilobites ayant existé durant le Paléozoïque du Cambrien au Permien.
Les derniers
trilobites ont disparu lors de l'extinction de masse à la fin du Permien, comme le loganostus à la fin du
cambrien.
Grâce à l’utilisation des fossiles stratigraphiques, les scientifiques ont pu énoncer le
principe d'identité paléontologique.
Ce principe indique que deux couches qui ont la même
composition en fossiles stratigraphiques sont du même âge.
Par ailleurs, un premier découpage en ères segmente le temps, il y en a 3 dans cette échelle : Le
Paléozoïque (primaire), le Mésozoïque (secondaire) et le Cénozoïque (tertiaire).
Ces coupures ont été placées à des moments ou des changements majeurs dans la composition de
la faune et de la flore terrestre sont survenus : comme la diversification rapide du vivant à la base du
Primaire (faune de Burgess) et l'apparition des trilobites.
Des crises biologiques au début du
Secondaire avec la plus grande extinction marine ayant affecté la biosphère (95% des espèces
marines et 70% des espèces terrestres) et aussi la disparition des trilobites.
Mais également, l’ère
tertiaire avec une grande extinction (75% des espèces marines et au total, 50% des espèces) et un
changement brutal d’espèces de foraminifères planctoniques et la disparition des ammonites.
(document feuille).
En ce qui concerne les périodes, leur découpage s’appuie sur des indices géologiques de
différentes ampleurs.
En effet, l’extinction de 85 % des espèces délimite l’Ordovicien du Silurien.
L’extinction de 75 % des espèces délimite le dévonien du Carbonifère, et le trias du jurassique.
Toutefois, toutes les périodes ne sont pas délimitées par des crises, comme la fin du Permien avec la
disparition des trilobites ou encore du Trias avec la disparition des conodontes.
A propos du document 1 du livre, il nous montre la banque de données Sepkoski qui compile des
informations sur plus de 30 000 genres de fossiles au niveau mondial.
Le doc nous présente 6
groupes d’espèces fossiles qui ont aidé à déterminer la délimitation des périodes géologiques : les
chondrichthyens, les stromatopores, les symmoriiformes, les ostéichthyens, les ptéraspidomorphes et
les placodermes.....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- HABERMAS, L’intégration républicaine, « Les droits de l’homme. À l’échelle mondiale et au niveau de l’État » (1996). Traduit de l’allemand par Rainer Rochlitz (revue) - corrigé HLP
- L'EUROPE DE L'OUEST EN CONSTRUCTION JUSQU'A LA FIN DES ANNÉES 1980
- Thème 2 : Dynamiques territoriales, coopérations et tensions dans la mondialisation Chapitre 1 : A l’échelle mondiale, une inégale intégration des territoires, des tensions, des coopérations et des régulations
- En quoi la littérature et le cinéma participent-ils à la construction de la mémoire de la Shoah ? (exemple du journal d'Hélène Berr)
- « Quelles sont les dynamiques de la métropolisation à l’échelle mondiale ? »