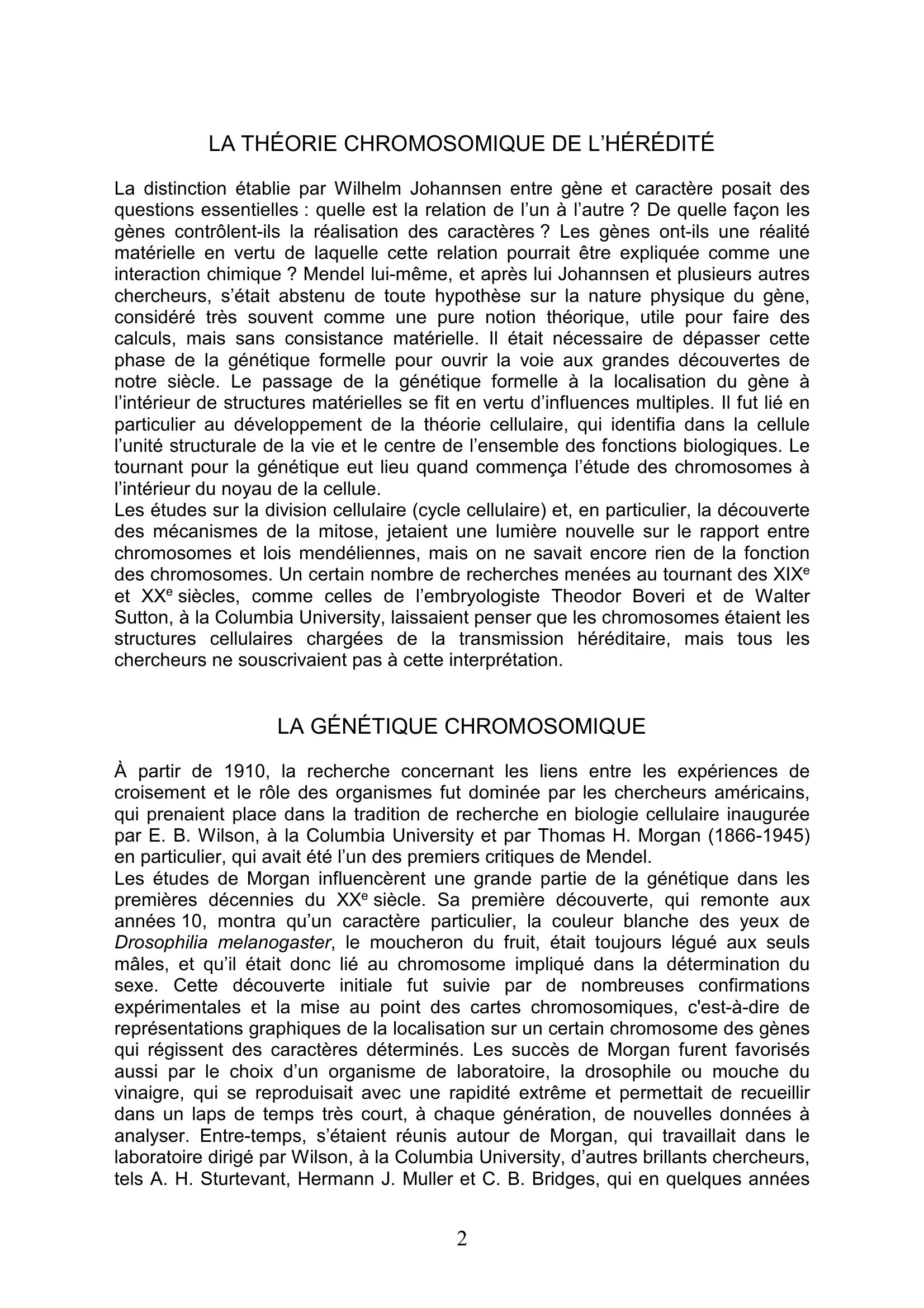HISTOIRE DE LA GÉNÉTIQUE
Publié le 02/05/2019
Extrait du document

EUGÉNISME
En 1883, Francis Galton (1822-1911) utilisa pour la première fois le terme « eugénisme » pour indiquer « l’étude sous le contrôle social des agents qui peuvent améliorer ou dégrader les qualités raciales des futures générations, tant physiquement que mentalement ». La naissance de la génétique donna à ce programme une nouvelle vitalité. Le principe fondamental était que les caractères héréditaires de l’homme pouvaient être déterminés par un nombre limité voire un seul gène mendélien, et que leur fréquence pouvait donc être facilement contrôlée. Le mouvement eugéniste connut une expansion importante entre 1910 et 1940, surtout aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Allemagne. De nombreux grands savants, y adhérèrent directement ou indirectement et le soutinrent, au moins pendant une période. Les programmes eugénistes étaient de deux types. Le premier, eugénisme négatif, tendait à limiter et à interdire les mariages entre individus susceptibles de donner lieu à une descendance présentant des caractères indésirables. Le deuxième, eugénisme positif, tendait à faire augmenter au sein de la population la fréquence des gènes considérés comme positifs, en favorisant les mariages entre porteurs de « bons » gènes. Mais il était évident que dans ces programmes la génétique semblait fournir une base scientifique à des valeurs sociales et à des structures économiques préexistantes et, comme cela était arrivé avec le darwinisme social à la fin du XIXe siècle, la science, à travers différents abus de la théorie évolutive, semblait fournir des justifications biologiques aux inégalités sociales. Dans les milieux scientifiques, l’opposition au mouvement eugéniste augmenta avec le temps en même temps que la conscience de ces implications, et atteint son apogée quand on commença à comprendre que l'eugénisme était appliquée systématiquement dans l’Allemagne nazie. Il était de plus en plus clair que les positions eugénistes étaient en train de perdre tout fondement scientifique. La génétique montrait de façon de plus en plus évidente que même des caractères phénotypiques relativement simples, comme la couleur des yeux ou les dimensions corporelles, pouvaient être déterminées par un nombre très élevé de gènes différents. Et la génétique des populations montrait, au moyen de modèles mathématiques, que l’élimination du patrimoine génétique d’une population d’un gène récessif était un processus très lent (plusieurs milliers d’années), que la présence de fortes pressions sélectives n’accélérait pas. La fin du mouvement eugéniste n’effaça pas tous les principes sur lesquels il se fondait, en particulier la possibilité et la nécessité d’intervenir sur le patrimoine humain pour améliorer les conditions sanitaires et les perspectives des générations futures.
L’ADN EXTRANUCLÉAIRE
Dans la deuxième moitié des années 60 des progrès importants furent accomplis dans les études génétiques de certains organites, les mitochondries et les chloroplastes. On a démontré que, dans tous les organismes, les mitochondries possèdent un ADN propre qui s’autoreproduit et qui est doté d’une information génétique propre. Des observations analogues ont été faites sur la structure et la fonction des chloroplastes, et on a pu démontrer une analogie structurelle entre l’ADN des chloroplastes et celui des algues bleues, organismes procaryotes très primitifs dans lesquels le matériel génétique de la cellule n’est pas délimité par une enveloppe. Ces observations ont amené certains chercheurs, au nombre desquels la biologiste américaine Lynn Margulis, à formuler l’hypothèse que les cellules eucaryotes se sont formées à une époque très éloignée après la symbiose et de la fusion de deux micro-organismes procaryotes ou plus.
DÉTERMINER LE GÉNOME HUMAIN
Une fois déterminée la nature des gènes, le rêve de certains généticiens devint d’identifier la structure de tous les gènes d’un organisme, c'est-à-dire son génome. En 1978, un premier pas dans cette direction fut accompli, grâce à la détermination du génome d’un virus appelé SV40. Évidemment, l’objectif principal restait de réaliser des cartes chromosomiques du génome humain tout entier. En 1956, date à laquelle remonte la détermination du nombre de chromosomes de notre espèce (il y en a 46), il était difficile de supposer qu’un peu plus de vingt ans plus tard un programme de recherche international pour la constitution intégrale de la carte du génome humain aurait pris corps et qu’il bénéficierait d’une grande partie des fonds destinés à la recherche biologique. Certains jugent disproportionnée la masse des investissements affectée à ce projet et y voient l’effet de l’importance excessive attribuée à la génétique au sein des sciences biologiques. D’autres regardent avec enthousiasme cette entreprise, qui pourrait permettre d’éradiquer un grand nombre de maladies héréditaires. Quoiqu’il en soit, le programme génome humain se poursuit.

«
2
LA THÉORIE CHROMOSOMIQUE DE L’HÉRÉDITÉ
La distinction établie par Wilhelm Johannsen entre gène et caractère posait des
questions essentielles : quelle est la relation de l’un à l’autre ? De quelle façon les
gènes contrôlent-ils la réalisation des caractères ? Les gènes ont-ils une réalité
matérielle en vertu de laquelle cette relation pourrait être expliquée comme une
interaction chimique ? Mendel lui-même, et après lui Johannsen et plusieurs autres
chercheurs, s’était abstenu de toute hypothèse sur la nature physique du gène,
considéré très souvent comme une pure notion théorique, utile pour faire des
calculs, mais sans consistance matérielle.
Il était nécessaire de dépasser cette
phase de la génétique formelle pour ouvrir la voie aux grandes découvertes de
notre siècle.
Le passage de la génétique formelle à la localisation du gène à
l’intérieur de structures matérielles se fit en vertu d’influences multiples.
Il fut lié en
particulier au développement de la théorie cellulaire, qui identifia dans la cellule
l’unité structurale de la vie et le centre de l’ensemble des fonctions biologiques.
Le
tournant pour la génétique eut lieu quand commença l’étude des chromosomes à
l’intérieur du noyau de la cellule.
Les études sur la division cellulaire (cycle cellulaire) et, en particulier, la découverte
des mécanismes de la mitose, jetaient une lumière nouvelle sur le rapport entre
chromosomes et lois mendéliennes, mais on ne savait encore rien de la fonction
des chromosomes.
Un certain nombre de recherches menées au tournant des XIX e
et XX esiècles, comme celles de l’embryologiste Theodor Boveri et de Walter
Sutton, à la Columbia University, laissaient penser que les chromosomes étaient les
structures cellulaires chargées de la transmission héréditaire, mais tous les
chercheurs ne souscrivaient pas à cette interprétation.
LA GÉNÉTIQUE CHROMOSOMIQUE
À partir de 1910, la recherche concernant les liens entre les expériences de
croisement et le rôle des organismes fut dominée par les chercheurs américains,
qui prenaient place dans la tradition de recherche en biologie cellulaire inaugurée
par E.
B.
Wilson, à la Columbia University et par Thomas H.
Morgan (1866-1945)
en particulier, qui avait été l’un des premiers critiques de Mendel.
Les études de Morgan influencèrent une grande partie de la génétique dans les
premières décennies du XX esiècle.
Sa première découverte, qui remonte aux
années 10, montra qu’un caractère particulier, la couleur blanche des yeux de
Drosophilia melanogaster , le moucheron du fruit, était toujours légué aux seuls
mâles, et qu’il était donc lié au chromosome impliqué dans la détermination du
sexe.
Cette découverte initiale fut suivie par de nombreuses confirmations
expérimentales et la mise au point des cartes chromosomiques, c'est-à-dire de
représentations graphiques de la localisation sur un certain chromosome des gènes
qui régissent des caractères déterminés.
Les succès de Morgan furent favorisés
aussi par le choix d’un organisme de laboratoire, la drosophile ou mouche du
vinaigre, qui se reproduisait avec une rapidité extrême et permettait de recueillir
dans un laps de temps très court, à chaque génération, de nouvelles données à
analyser.
Entre-temps, s’étaient réunis autour de Morgan, qui travaillait dans le
laboratoire dirigé par Wilson, à la Columbia University, d’autres brillants chercheurs,
tels A.
H.
Sturtevant, Hermann J.
Muller et C.
B.
Bridges, qui en quelques années.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Les principales dates de l'Histoire de la Génétique 1651 William Harvey suggère que les individus vivants proviennent tous des ovules.
- Suis-je mon histoire ou mon code génétique ?
- MUTATIONS DE LA Génétique de 1990 à 1994 : Histoire
- Les principales dates de l'Histoire de la Génétique
- THÈME 1 : La Terre, la vie et l’organisation du vivant Thème 1A : Transmission, variation et expression du patrimoine génétique Chapitre 1 : Les divisions cellulaires, transmission du programme génétique chez les eucaryotes