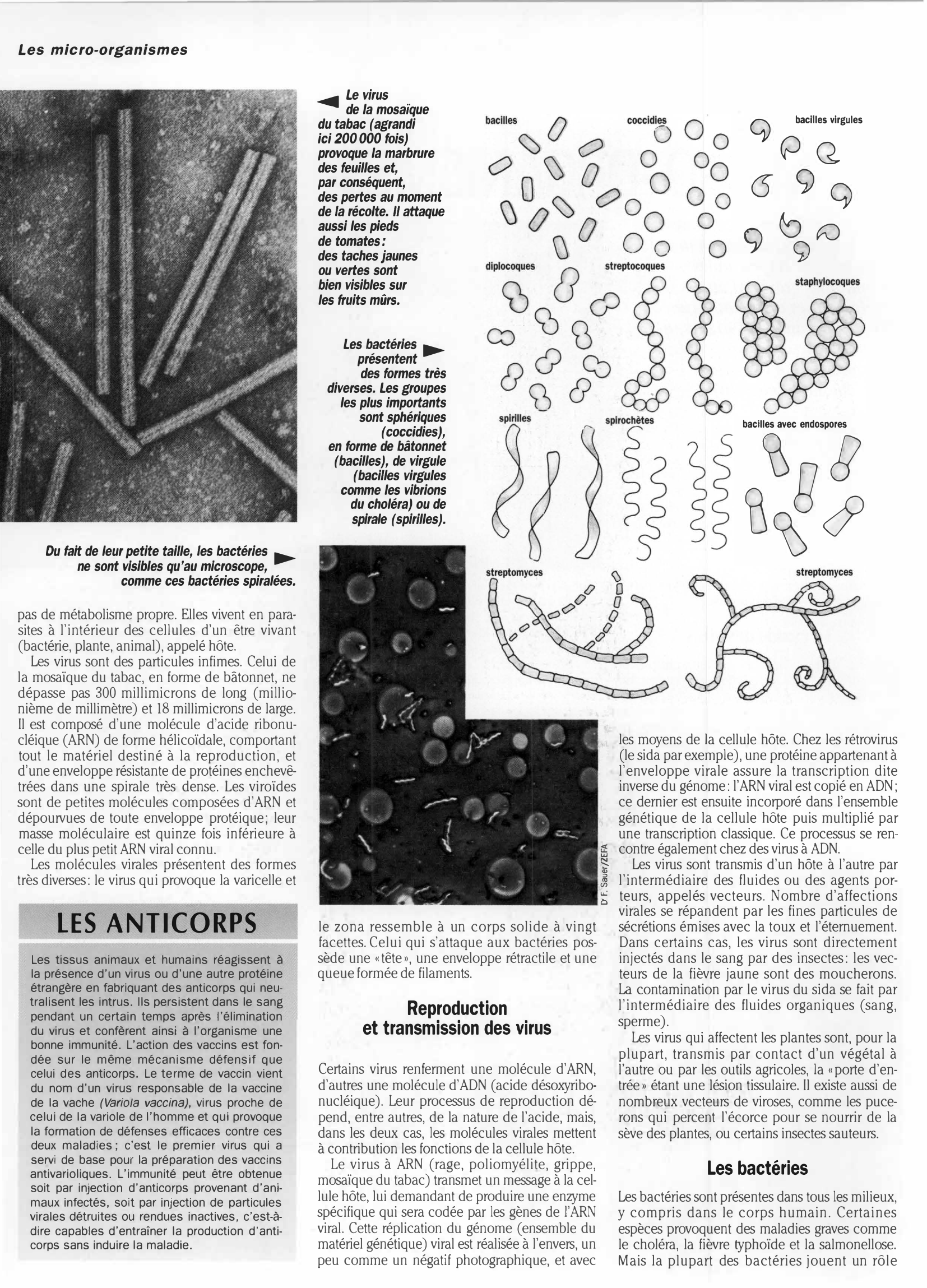Grand oral du bac : LES MICRO-ORGANISMES
Publié le 29/01/2019
Extrait du document
Structure et reproduction
Les algues unicellulaires, dont le diamètre est d’environ 0,01 mm, ne sont pas visibles à l’œil nu. Leur anatomie et leur mode de croissance sont très variés, mais elles possèdent toutes des structures cellulaires avec des chloroplastes renfermant la chlorophylle. Chez les Chlorella, la cellule ne contient qu’un seul chloroplaste, alors que les Spirogyra possèdent de nombreux chloroplastes disposés sous forme de ruban spiralé. Les algues comme les chlorelles sont des cellules uniques, avec une paroi protéique, des chloroplastes et un noyau contenant le matériel génétique (ADN). Certaines algues unicellulaires sont dotées d’un flagelle leur permettant de se déplacer.
Les espèces pluricellulaires sont composées de filaments plus ou moins ramifiés et se présentent sous des aspects très divers: plantes filamenteuses, minces, épaisses, en cordons cylindriques ou en lanières, encroûtantes, creuses, etc.
division d'un protoplaste
1 Deux zoospores sont relâchées.
Lorsqu’une algue verte unicellulaire se reproduit par voie asexuée (1), la plante se divise en deux cellules identiques. Dans le cas d'une reproduction sexuée (2), le végétal produit plusieurs cellules reproductrices (gamètes) qui fusionnent avec les gamètes d’autres plantes pour former d’abord un zygote (œuf) puis une zygospore. Cette dernière germe et se divise ensuite, donnant naissance à quatre nouveaux individus.
D'Gordon Leedale/Biophoto Associâtes
À La plupart des algues rouges
sont des végétaux marins pluricellulaires. Leurs nombreux filaments forment des structures ramifiées qui rappellent une plume.
Les algues peuvent se multiplier de façon végétative : une partie du thalle se détache, se fixe et donne naissance à une nouvelle plante. Cependant, les formes de reproduction courantes sont la scission et la voie sexuée. Les algues unicellulaires se reproduisent par scission : la cellule mère se divise en deux cellules filles identiques, comme chez les bactéries.
Chez les algues plus complexes, les conditions de milieu semblent influer sur les méthodes de reproduction. La voie asexuée est fondée sur une réduction chromatique qui aboutit à la production de spores, dont certaines possèdent des flagelles (zoospores) et sont donc mobiles. La plupart des algues se reproduisent par voie sexuée. Chez les espèces marines évoluées comme les fucus, les organes spécifiques des deux sexes se trouvent souvent sur des plantes séparées. Les organes mâles (anthéridies) et les organes femelles (oogones) se développent au printemps et, lorsqu’ils sont recouverts par la marée haute, expulsent leurs cellules reproductrices (gamètes) dans l’eau. Les gamètes mâles, munis d’un flagelle, se déplacent pour rencontrer les gamètes femelles, immobiles. Leur fusion donne naissance à un œuf (zygote), qui se transforme en un nouvel individu.
CYANOPHYCÉES ET CYANOBACTÉRIES
Les cyanophycées, ou algues bleues, doivent leur nom au fait qu’un pigment bleu masque partiellement les grains verts de chlorophylle. Les cellules de ces organismes sont en général plus grandes et plus complexes que celles des bactéries dont elles sont très proches. Dépourvues de flagelle, elles se développent en longues files simples, appelées filaments. Ces espèces captent l'énergie solaire et fabriquent des glucides par photosynthèse comme les plantes supérieures.
Les cyanobactéries (bactéries bleues) ne possèdent pas de chloroplastes ou d’organites similaires. Les pigments verts sont contenus dans des sacs plats, dénommés thylakoïdes. Organismes photosynthétiques, ces algo-bac-téries ne produisent pas d’enzymes capables de décomposer la matière organique comme les bactéries ordinaires. Cependant, elles ont la faculté de vivre dans des milieux peu éclairés, mais pas dans l’obscurité totale - près de la surface du sol, au fond des étangs, dans la vase -, et d’absorber des substances organiques simples.
La fertilité de certains sols dépend largement de l’activité des algues bleues. Par exemple, les terrains humides ou les prairies inondées transformées en rizières doivent leur renouvellement organique aux cyanobactéries.
«
Les
micro-organismes
Ou fait de leur petite taille, tes bactéries ..,....
ne sont visibles qu'au microscope,
comme ces bactéries spiralées.
pas de métabolisme propre.
Elles vivent en para
sites à l'intérieur des cellules d'un être vivant
(bactérie, plante, animal), appelé hôte.
Les virus sont des particules infimes.
Celui de
la mosaïque du tabac, en forme de bâtonnet, ne
dépasse pas 300 millimicrons de long (millio
nième de millimètre) et 18 millimicrons de large.
Il est composé d'une molécule d'acide ribonu
cléique (ARN) de forme hélicoïdale, comportant
tout le matériel destiné à la reproduction, et
d'une enveloppe résistante de protéines enchevê
trées dans une spirale très dense.
Les viroïdes
sont de petites molécules composées d'ARN et
dépourvues de toute enveloppe protéique; leur
masse moléculaire est quinze fois inférieure à
celle du plus petit ARN viral connu.
Les molécules virales présentent des formes
très diverses: te virus qui provoque la varicelle et
LES ANTICORPS
Les tissus animaux et humains réagissent à
la présence d'un virus ou d'une autre protéine
étrangère en fabriquant des anticorps qui neu
tralisent les intrus.
Ils persistent dans le sang
pendant un certain temps après l'élimination
du virus et confèrent ainsi à l'organisme une
bonne immunité.
L'action des vaccins est fon
dée sur le même mécanisme défensif que
celui des anticorps.
Le terme de vaccin vient
du nom d'un virus responsable de la vaccine
de la vache (Variola vaccina), virus proche de
celui de la variole de l'homme et qui provoque
la formation de défenses efficaces contre ces
deux maladies; c'est le premier virus qui a
servi de base pour la préparation des vaccins
antivarioliques.
L'immunité peut être obtenue
soit par injection d'anticorps provenant d'ani
maux infectés, soit par injection de particules
virales détruites ou rendues inactives, c'est-à
dire capables d'entraîner la production d'anti
corps sans induire la maladie.
.......
Le virus
de la mosaïque
du tabac (agrandi
ici 200 000 fois)
provoque la marbrure
des feuilles et,
par conséquent,
des pertes au moment
de ta récolte.
Il attaque
aussi les pieds
de tomates:
des taches jaunes
ou vertes sont
bien visibles sur
les fruits mûrs.
Les bactéries ..,....
présentent
des formes très
diverses.
Les groupes
les plus importants
sont sphériques
(coccidies),
en forme de bâtonnet
(bacilles), de virgule
(bacilles virgules
comme les vibrions
du choléra) ou de
spirale (spirilles).
le zona ressemble à un corps solide à vingt
facettes.
Celui qui s'attaque aux bactéries pos
sède une "tête>> , une enveloppe rétractile et une
queue formée de filaments.
Reproduction
et transmission des virus
Certains virus renferment une molécule d'ARN,
d'autres une molécule d'ADN (acide désoxyribo
nucléique).
Leur processus de reproduction dé
pend, entre autres, de la nature de l'acide, mais,
dans les deux cas, les molécules virales mettent
à contribution les fonctions de la cellule hôte.
Le virus à ARN (rage, poliomyélite, grippe,
mosaïque du tabac) transmet un message à la cel
lule hôte, lui demandant de produire une enzyme
spécifique qui sera codée par tes gènes de l'ARN
viral.
Cette réplication du génome (ensemble du
matériel génétique) viral est réalisée à l'envers, un
peu comme un négatif photographique, et avec q
bacilles virgules
Pa
6 9q
9�0) 9
bacilles avec endospores
� !J
��> étant une lésion tissulaire.
Il existe aussi de
nombreux vecteurs de viroses, comme les puce
rons qui percent l'écorce pour se nourrir de la
sève des plantes, ou certains insectes sauteurs.
Les bactéries
Les bactéries sont présentes dans tous les milieux,
y compris dans le corps humain.
Certaines
espèces provoquent des maladies graves comme
le choléra, la fièvre typhoïde et la salmonellose.
Mais la plupart des bactéries jouent un rôle.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Grand oral du bac : Arts et Culture L'ART DE LA PHOTOGRAPHIE
- Grand oral du bac : Arts et Culture LE BAUHAUS
- Grand oral du bac : Arts et Culture LE BAROQUE
- Grand oral du bac : WALT DISNEY
- Grand oral du bac : GEORGE ORWELL