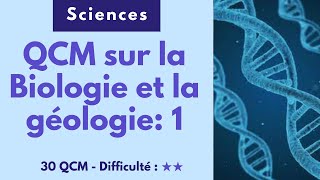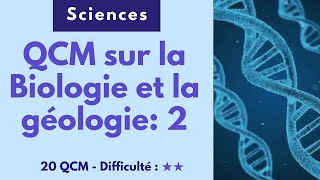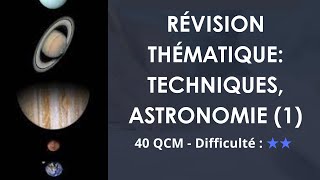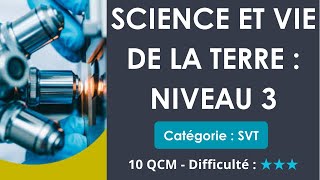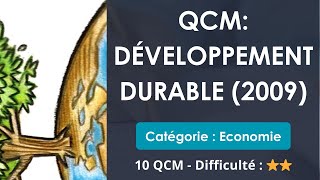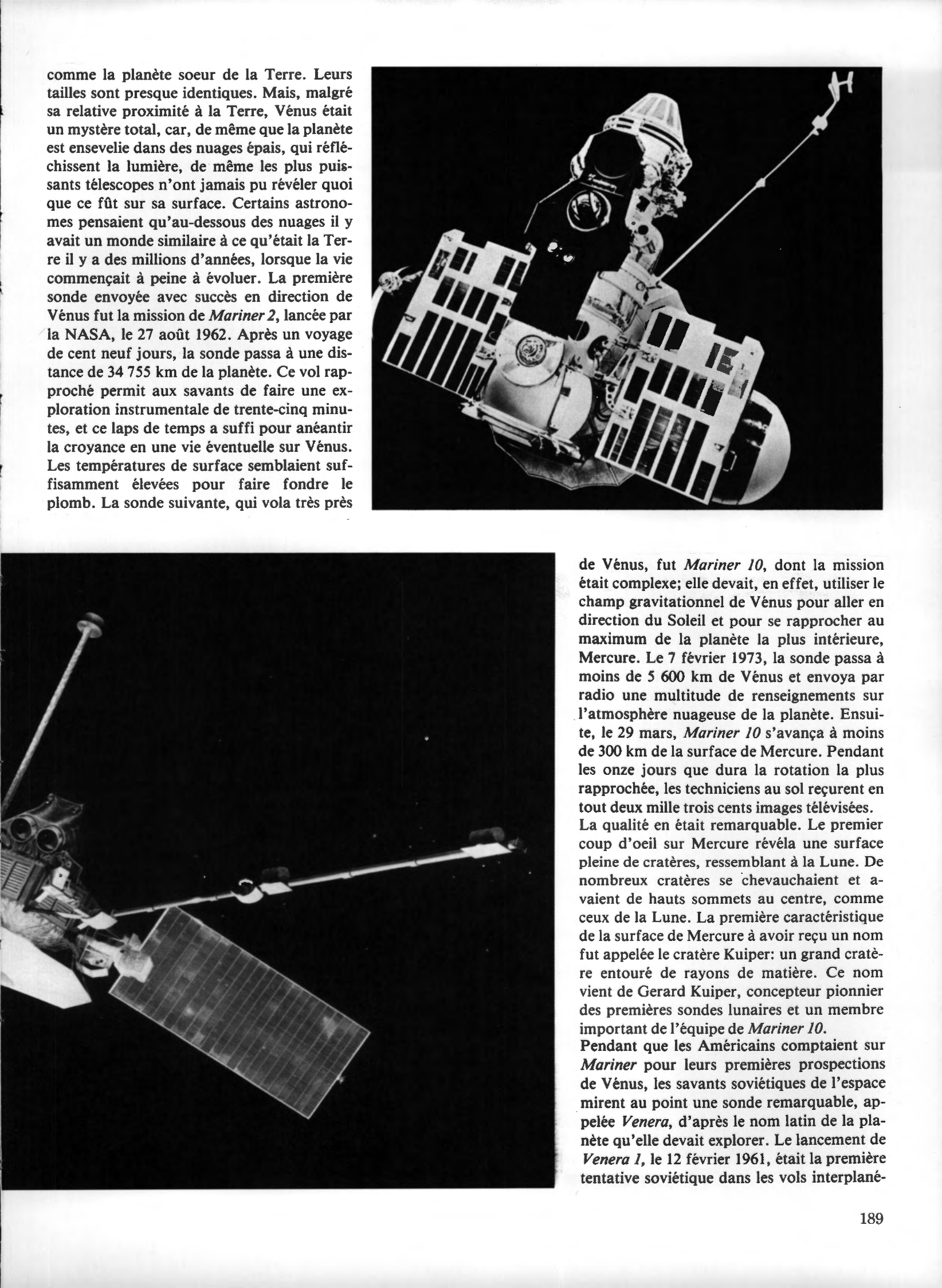Les sondes interplanétaires
Publié le 22/03/2012
Extrait du document
Venera 4 réussit à laisser tomber un conteneur de 180 kg avec des instruments, dans l'atmosphère vénusienne. Pendant la descente, qui dura quatre-vingt-quatorze minutes, les transmissions cessèrent. La capsule avait probablement été écrasée par la formidable pression atmosphérique proche de la surface de la planète. Les Russes tirèrent grand profit de cette première expérience et, par la suite, les capsules d'atterrissage furent beaucoup plus solides, permettant les transmissions à partir de la surface de Vénus. Plus tard, le 22 octobre 1975, la capsule de Venera 9 effectua une descente en parachute. Environ quinze minutes après le contact avec le sol, il fut possible de mettre un terme à des siècles de spéculations au moment de la transmission d'une unique photographie
«
comme la planète soeur de la Terre .
Leurs
tailles sont presque identiques.
Mais, malgré
sa relative proximité
à la Terre, Vénus était
un mystère total, car, de même que la planète
est ensevelie dans des nuages épais, qui réflé
chissent
la lumière, de même les plus pui!l
sants télescopes n'ont jamais pu révéler quoi
que ce fût sur sa surface.
Certains astrono
mes pensaient qu'au-dessous des nuages
il y
avait
un monde similaire à ce qu'était la Ter
re
il y a des millions d'années, lorsque la vie
commençait
à peine à évoluer.
La première
sonde envoyée avec succès en direction de
Vénus fut la mission de
Mariner 2, lancée par
la NASA, le 27 août 1962.
Après un voyage
de cent neuf jours, la sonde passa
à une dis
tance de 34
755 km de la planète.
Ce vol rap
proché permit aux savants de faire une ex
ploration instrumentale de trente-cinq minu
tes, et ce laps de temps a suffi pour anéantir
la croyance en une vie éventuelle sur Vénus.
Les températures de surface semblaient suf
fisamment élevées
pour faire fondre le
plomb.
La sonde suivante, qui vola très près
de Vénus, fut
Mariner JO, dont la mission
était complexe; elle devait, en effet, utiliser
le
champ gravitationnel de Vénus pour aller en
direction du
Soleil et pour se rapprocher au
maximum de la planète la plus intérieure,
Mercure.
Le 7 février
1973 , la sonde passa à
moins de 5 600 km de Vénus et envoya par
radio une multitude de renseignements sur
l'atmosphère nuageuse de la planète .
Ensui
te,
le 29 mars, Mariner JO s'avança à moins
de
300 km de la surface de Mercure.
Pendant
les onze jours que dura la rotation la plus
rapprochée, les techniciens
au sol reçurent en
tout deux mille trois cents images télévisées.
La qualité en était remarquable.
Le premier
coup d'oeil sur Mercure révéla une surface
pleine de cratère s, ressemblant
à la Lune.
De
nombreu x cratères
se chevauchaient et a
vaient de
haut s sommets au centre, comme
ceux de la Lune.
La première caractéristique
de la surface de Mercure
à avoir reçu un nom
fut appelée
le cratère Kuiper: un grand cratè
re entouré de rayons de matière.
Ce nom
vient de Gerard Kuiper, concepteur pionnier
de s première s sondes lunaires et un membre
important de l'équipe de
Mariner JO.
Pendant que les Américains comptaient sur
Mariner pour leurs premières prospections
de Vénus, les savants soviétiques de l'espace
mirent
au point une sonde remarquable, ap
pelée
Venera, d'après le nom latin de la pla
nète qu'elle devait explorer.
Le lancement de
Venera J, le 12 février 1961, était la première
tentative soviétique dans les vols interplané-
189.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Voyager (sondes spatiales) - astronomie.
- LES SONDES SPATIALES
- Les sondes Viking sur Mars
- Grand oral du bac : LES SONDES SPATIALES
- Sondes, orbiteurs et atterrisseurs