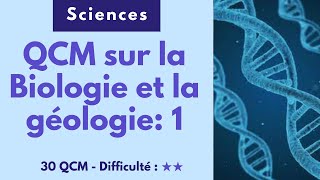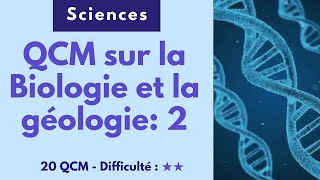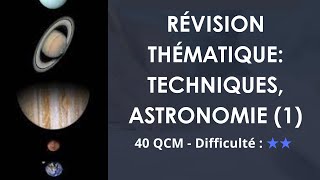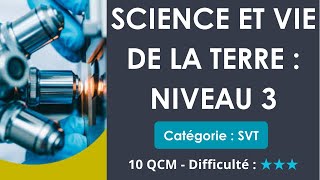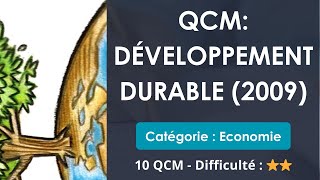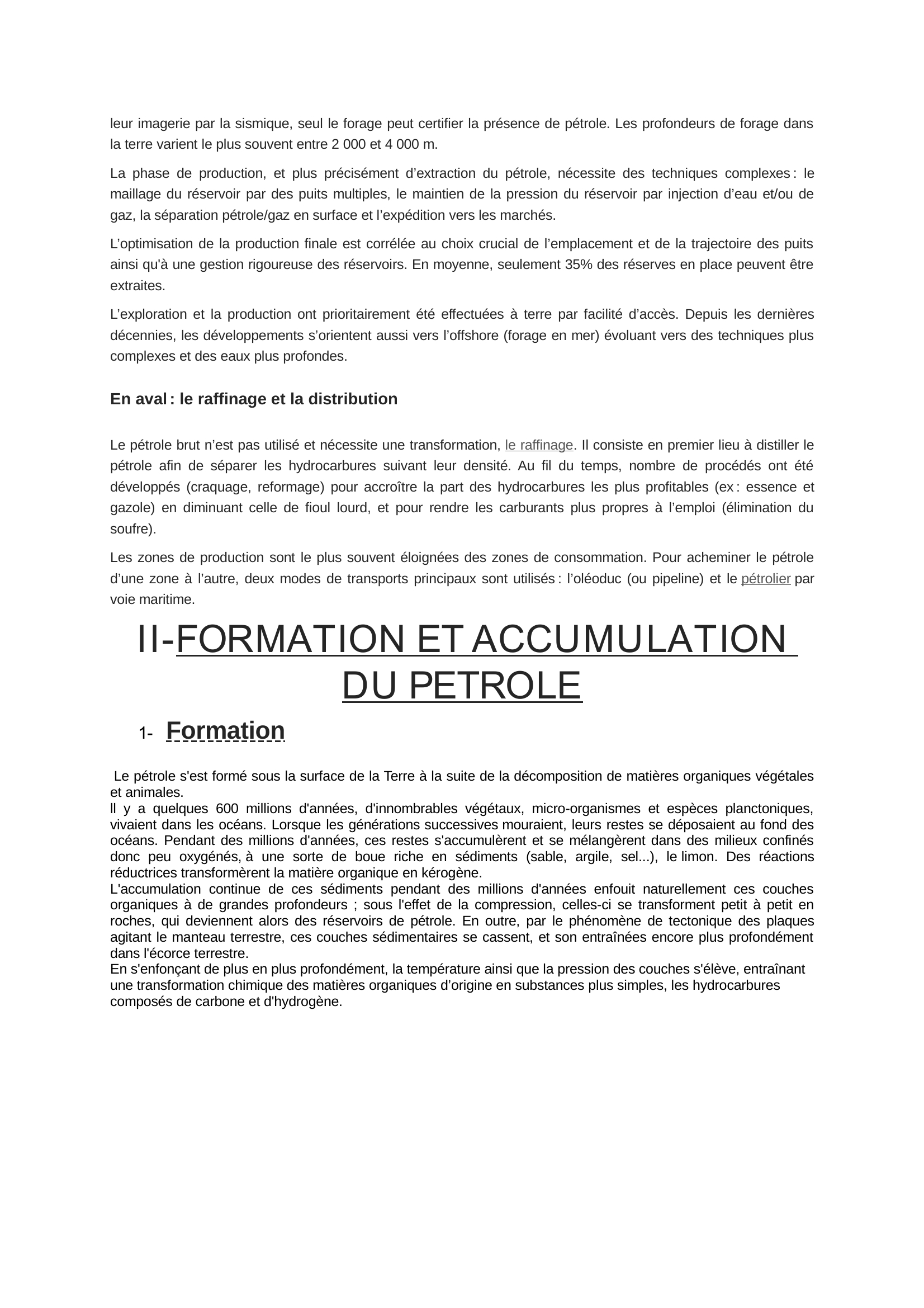Exploitation du pétrole brut
Publié le 30/12/2012

Extrait du document
THEME : Exploitation du pétrole brut Définition du pétrole Le pétrole, du latin petra et oleum, soit « huile de pierre « est une huile minérale naturelle utilisée comme source d'énergie. Il est issu d'un mélange variable d'hydrocarbures (molécules composées d'atomes de carbone et d'hydrogène) associé à d'autres atomes, principalement de soufre, d'azote et d'oxygène. Certains de ses composants peuvent être gazeux, liquides et parfois solides selon la température et la pression. Cela explique la consistance variable du pétrole, plus ou moins visqueuse ou liquide. L'exploitation du pétrole comme source d'énergie, dite fossile, est l'un des piliers de l'économie industrielle contemporaine. Dense, facilement stockable et transportable, le pétrole fournit la quasi-totalité des carburants liquides. Il est aussi fréquemment utilisé pour la pétrochimie (caoutchoucs, plastiques, textiles, chimie). Sa constitution est issue de la géologie sédimentaire d'un lieu et plus spécifiquement de la succession de trois phases : . La phase d'accumulation de matière organique dans les profondeurs lors de la sédimentation. Cette matière est essentiellement d'origine végétale. .La phase de maturation en hydrocarbures, moment où la matière se transforme avec l'augmentation de la pression et de la température. Elle est d'abord transformée en kérogène. A haute température, le kérogène subit une décomposition thermique, appelée pyrolyse, qui expulse les hydrocarbures. Plus le sédiment est profond et chaud, plus la part de gaz (hydrocarbures légers) est importante ; . La phase de migration et piégeage : sous la pression croissante, une partie des hydrocarbures migre vers la surface de la terre, où elle s'oxyde ou subit une biodégradation. L'autre partie migre jusqu'à rester piégée dans une roche poreuse et perméable, source d'un futur gisement de pétrole, si le piège est fermé. La naissance d'un gisement de pétrole (ou de gaz, les deux étant corrélés) résulte ainsi d'une conjonction favorable de facteurs géologiques. Cela influe sur la disparité des gisements dans le monde et les typologies de pétrole. Les pétroles sont généralement classés selon leur origine et leur composition (fluidité, densité mesurée en degrés API, teneur en soufre, etc.). Dans l'usage, on distingue aussi les pétroles « conventionnels « faciles à extraire et à raffiner parce qu'ils restent fluides et pompables du puits au stockage de surface, des pétroles « non-conventionnels « qui requièrent des techniques d'extraction plus sophistiquées. On peut citer parmi les pétroles non-conventionnels l'huile de schiste, le pétrole extra-lourd, les sables bitumineux et les schistes bitumineux. I-FONCTIONNEMENT L'exploitation du pétrole se subdivise schématiquement en deux étapes : l'amont et l'aval. En amont : l'exploration pétrolière et la production L'exploration consiste à rechercher des gisements. Géologues et géophysiciens collaborent à cette investigation chargée d'enjeux économiques. Après l'étude détaillée des structures géologiques en surface et en profondeur, et leur imagerie par la sismique, seul le forage peut certifier la présence de pétrole. Les profondeurs de forage dans la terre varient le plus souvent entre 2 000 et 4 000 m. La phase de production, et plus précisément d'extraction du pétrole, nécessite des techniques complexes : le maillage du réservoir par des puits multiples, le maintien de la pression du réservoir par injection d'eau et/ou de gaz, la séparation pétrole/gaz en surface et l'expédition vers les marchés. L'optimisation de la production finale est corrélée au choix crucial de l'emplacement et de la trajectoire des puits ainsi qu'à une gestion rigoureuse des réservoirs. En moyenne, seulement 35% des réserves en place peuvent être extraites. L'exploration et la production ont prioritairement été effectuées à terre par facilité d'accès. Depuis les dernières décennies, les développements s'orientent aussi vers l'offshore (forage en mer) évoluant vers des techniques plus complexes et des eaux plus profondes. En aval : le raffinage et la distribution Le pétrole brut n'est pas utilisé et nécessite une transformation, le raffinage. Il consiste en premier lieu à distiller le pétrole afin de séparer les hydrocarbures suivant leur densité. Au fil du temps, nombre de procédés ont été développés (craquage, reformage) pour accroître la part des hydrocarbures les plus profitables (ex : essence et gazole) en diminuant celle de fioul lourd, et pour rendre les carburants plus propres à l'emploi (élimination du soufre). Les zones de production sont le plus souvent éloignées des zones de consommation. Pour acheminer le pétrole d'une zone à l'autre, deux modes de transports principaux sont utilisés : l'oléoduc (ou pipeline) et le pétrolier par voie maritime. II-FORMATION ET ACCUMULATION DU PETROLE Formation Le pétrole s'est formé sous la surface de la Terre à la suite de la décomposition de matières organiques végétales et animales. ll y a quelques 600 millions d'années, d'innombrables végétaux, micro-organismes et espèces planctoniques, vivaient dans les océans. Lorsque les générations successives mouraient, leurs restes se déposaient au fond des océans. Pendant des millions d'années, ces restes s'accumulèrent et se mélangèrent dans des milieux confinés donc peu oxygénés, à une sorte de boue riche en sédiments (sable, argile, sel...), le limon. Des réactions réductrices transformèrent la matière organique en kérogène. L'accumulation continue de ces sédiments pendant des millions d'années enfouit naturellement ces couches organiques à de grandes profondeurs ; sous l'effet de la compression, celles-ci se transforment petit à petit en roches, qui deviennent alors des réservoirs de pétrole. En outre, par le phénomène de tectonique des plaques agitant le manteau terrestre, ces couches sédim...
«
leur imagerie par la sismique, seul le forage peut certifier la présence de pétrole.
Les profondeurs de forage dans
la terre varient le plus souvent entre 2 000 et 4 000 m.
La phase de production, et plus précisément d’extraction du pétrole, nécessite des techniques complexes : le
maillage du réservoir par des puits multiples, le maintien de la pression du réservoir par injection d’eau et/ou de
gaz, la séparation pétrole/gaz en surface et l’expédition vers les marchés.
L’optimisation de la production finale est corrélée au choix crucial de l’emplacement et de la trajectoire des puits
ainsi qu'à une gestion rigoureuse des réservoirs.
En moyenne, seulement 35% des réserves en place peuvent être
extraites.
L’exploration et la production ont prioritairement été effectuées à terre par facilité d’accès.
Depuis les dernières
décennies, les développements s’orientent aussi vers l’offshore (forage en mer) évoluant vers des techniques plus
complexes et des eaux plus profondes.
En aval : le raffinage et la distribution
Le pétrole brut n’est pas utilisé et nécessite une transformation, le raffinage .
Il consiste en premier lieu à distiller le
pétrole afin de séparer les hydrocarbures suivant leur densité.
Au fil du temps, nombre de procédés ont été
développés (craquage, reformage) pour accroître la part des hydrocarbures les plus profitables (ex : essence et
gazole) en diminuant celle de fioul lourd, et pour rendre les carburants plus propres à l’emploi (élimination du
soufre).
Les zones de production sont le plus souvent éloignées des zones de consommation.
Pour acheminer le pétrole
d’une zone à l’autre, deux modes de transports principaux sont utilisés : l’oléoduc (ou pipeline) et le pétrolier par
voie maritime.
I I- FORMATION ET ACCU MU LATION
DU PETROLE
1- Formation
Le pétrole s'est formé sous la surface de la Terre à la suite de la décomposition de matières organiques végétales
et animales.
ll y a quelques 600 millions d'années, d'innombrables végétaux, micro-organismes et espèces planctoniques,
vivaient dans les océans.
Lorsque les générations successives mouraient, leurs restes se déposaient au fond des
océans.
Pendant des millions d'années, ces restes s'accumulèrent et se mélangèrent dans des milieux confinés
donc peu oxygénés, à une sorte de boue riche en sédiments (sable, argile, sel...), le limon .
Des réactions
réductrices transformèrent la matière organique en kérogène .
L'accumulation continue de ces sédiments pendant des millions d'années enfouit naturellement ces couches
organiques à de grandes profondeurs ; sous l'effet de la compression, celles-ci se transforment petit à petit en
roches, qui deviennent alors des réservoirs de pétrole.
En outre, par le phénomène de tectonique des plaques
agitant le manteau terrestre, ces couches sédimentaires se cassent, et son entraînées encore plus profondément
dans l'écorce terrestre.
En s'enfonçant de plus en plus profondément, la température ainsi que la pression des couches s'élève, entraînant
une transformation chimique des matières organiques d’origine en substances plus simples, les hydrocarbures
composés de carbone et d'hydrogène..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Les conséquences de l'exploitation du pétrole Qu'est ce que le pétrole ?
- La découverte en 1966 d'importants gisements de gaz naturel et de pétrole en mer du Nord a permis à la Norvège d'assurer avec ses recettes un bon niveau de croissance, malgré les baisses successives du prix du brut.
- Agriculture : Revenu brut par exploitation
- Le Pétrole: recherche, volume et exploitation
- pétrole et gaz naturel