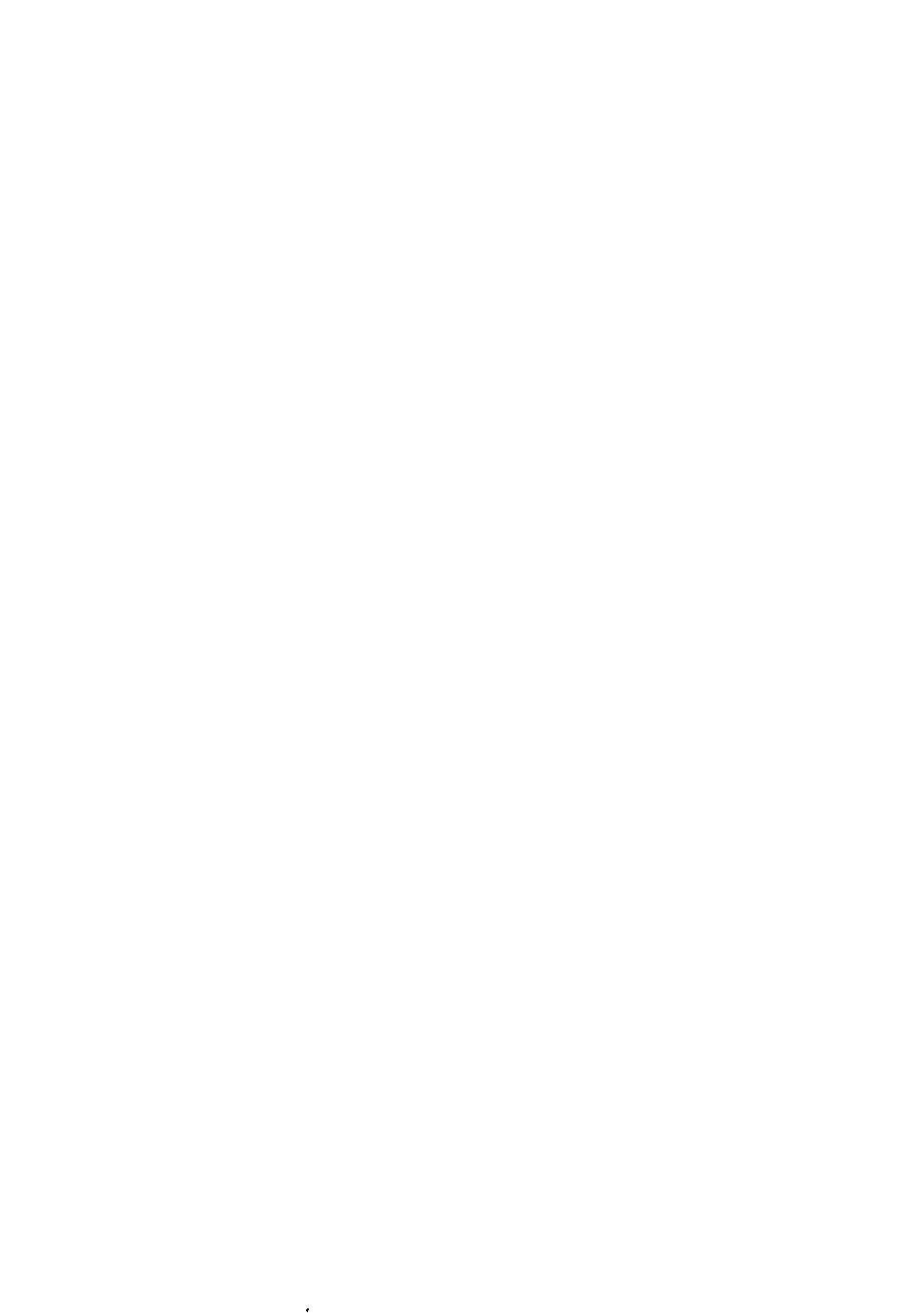QUELQUES TEXTES ET CITATIONS
Publié le 05/10/2017
Extrait du document
Ce n'est qu’avec notre mémoire, c’est-à-dire avec notre expérience que nous pouvons vraiment être attentifs à notre présent et l’attention pourrait être appelée la vigilance présente du passé [...] L’attention est essentiellement une fonction de la pensée. C’est une activité de synthèse et cette synthèse consiste d’abord à faire peser sur le présent toute l’expérience du passé.
Il suit qu’on ne peut guère non plus être attentif sans attendre (s'attendre à) et c’est une relation assez évidente pour s’être marquée jusque dans le terme même qui désigne la fonction. Être attentif, c’est épier dans le présent les signes d’un avenir anticipé.
PRADINES.
INTELLIGENCE (Chap. I).
Si nous pouvions nous dépouiller de tout orgueil, si, pour définir notre espèce, nous nous en tenions strictement à ce que l'histoire et la préhistoire nous présentent comme la caractéristique constante de l’homme et de l’intelligence, nous ne dirions peut-être pas Homo Sapiens mais Homo Faber. En définitive, l’intelligence, envisagée dans ce qui en paraît être la démarche originelle, est la faculté de fabriquer des outils artificiels, en particulier des outils à faire des outils, et d’en varier indéfiniment la fabrication.
Si l’on envisage dans l’instinct et dans l’intelligence ce qu’ils renferment de connaissance innée, on trouve que cette connaissance innée porte dans le premier cas sur des CHOSES et dans le second sur des RAPPORTS.
Notre intelligence, telle qu’elle sort des mains de la nature, a pour objet principal le solide inorganisé... Nous ne sommes à notre aise que dans le discontinu, dans l’immobile, dans le mort. L’intelligence est caractérisée par une incompréhension naturelle de la vie. C’est sur la fo^e même de la vie, au contraire, qu’est moulé l'instinct. Tandis que l’intelligence traite toutes choses mécaniquement, l’instinct procède, si l’on peut parler ainsi, organiquement.
L’intelligence est l’attention que l'esprit porte à la matière.
BERGSON.
LES MATHÉMATIQUES (Chap. VI).
L’espace n’est pas un concept empirique, dérivé d’expériences extérieures. En effet, pour que je puisse rapporter certaines sensations à quelque chose d’extérieur à moi (c’est-à-dire à quelque chose placé dans un autre lieu de l'espace que celui où je me trouve) et, de même, pour que je puisse me représenter les choses comme en dehors et à côté les unes des autres, et par conséquent comme n’étant pas seulement différentes, mais placées en des lieux différents, il faut que la représentation de l’espace soit déjà posée comme fondement. Cette représentation ne peut donc être tirée par l’expérience des rapport? des phénomènes extérieurs ; mais cette expérience extérieure n'est elle-même possible qu'au moyen de cette représentation.
On ne peut se représenter qu’un seul espace, et, quand on parle de plusieurs espaces, on n’entend par là que les parties d'un seul et même espace. Ces parties ne sauraient non plus être antérieures à cet espace unique qui comprend tout, comme si elles en étaient • les éléments (et qu’elles puissent le constituer par leur assemblage) ; elles ne sont au contraire pensées qu’en lui...
L’espace est représenté comme une grandeur infinie donnée.
Il est impossible de se représenter jamais qu’il n’y ait pas d'espace, quoiqu’on puisse bien concevoir qu’il n’y ait pas d’objets en lui. Il est donc considéré comme la condition de la possibilité des phénomènes, et non pas comme une détermination qui en dépende.
KANT.
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- QUELQUES TEXTES ET CITATIONS
- Recueil de textes météo
- Les textes et les images de l'art de la Renaissance
- Les 4 types de textes
- En vous appuyant sur une lecture attentive de "La Princesse de Clèves" et des autres textes du parcours associé, vous direz si, selon vous, l'intérêt d'un roman réside dans le caractère tragique de son intrigue.