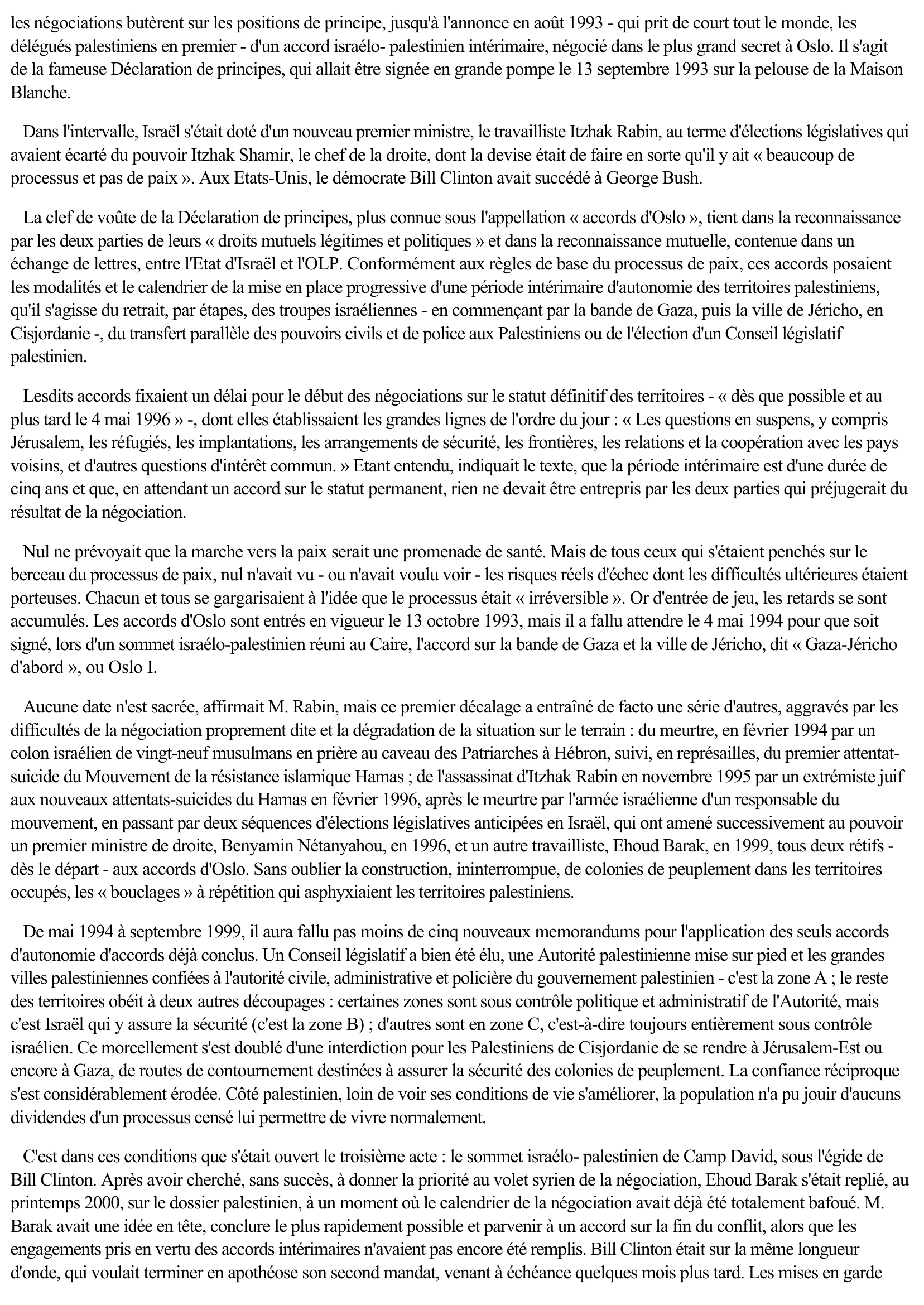Proche-Orient : la paix en fuite
Publié le 17/01/2022

Extrait du document
«
les négociations butèrent sur les positions de principe, jusqu'à l'annonce en août 1993 - qui prit de court tout le monde, lesdélégués palestiniens en premier - d'un accord israélo- palestinien intérimaire, négocié dans le plus grand secret à Oslo.
Il s'agitde la fameuse Déclaration de principes, qui allait être signée en grande pompe le 13 septembre 1993 sur la pelouse de la MaisonBlanche.
Dans l'intervalle, Israël s'était doté d'un nouveau premier ministre, le travailliste Itzhak Rabin, au terme d'élections législatives quiavaient écarté du pouvoir Itzhak Shamir, le chef de la droite, dont la devise était de faire en sorte qu'il y ait « beaucoup deprocessus et pas de paix ».
Aux Etats-Unis, le démocrate Bill Clinton avait succédé à George Bush.
La clef de voûte de la Déclaration de principes, plus connue sous l'appellation « accords d'Oslo », tient dans la reconnaissancepar les deux parties de leurs « droits mutuels légitimes et politiques » et dans la reconnaissance mutuelle, contenue dans unéchange de lettres, entre l'Etat d'Israël et l'OLP.
Conformément aux règles de base du processus de paix, ces accords posaientles modalités et le calendrier de la mise en place progressive d'une période intérimaire d'autonomie des territoires palestiniens,qu'il s'agisse du retrait, par étapes, des troupes israéliennes - en commençant par la bande de Gaza, puis la ville de Jéricho, enCisjordanie -, du transfert parallèle des pouvoirs civils et de police aux Palestiniens ou de l'élection d'un Conseil législatifpalestinien.
Lesdits accords fixaient un délai pour le début des négociations sur le statut définitif des territoires - « dès que possible et auplus tard le 4 mai 1996 » -, dont elles établissaient les grandes lignes de l'ordre du jour : « Les questions en suspens, y comprisJérusalem, les réfugiés, les implantations, les arrangements de sécurité, les frontières, les relations et la coopération avec les paysvoisins, et d'autres questions d'intérêt commun.
» Etant entendu, indiquait le texte, que la période intérimaire est d'une durée decinq ans et que, en attendant un accord sur le statut permanent, rien ne devait être entrepris par les deux parties qui préjugerait durésultat de la négociation.
Nul ne prévoyait que la marche vers la paix serait une promenade de santé.
Mais de tous ceux qui s'étaient penchés sur leberceau du processus de paix, nul n'avait vu - ou n'avait voulu voir - les risques réels d'échec dont les difficultés ultérieures étaientporteuses.
Chacun et tous se gargarisaient à l'idée que le processus était « irréversible ».
Or d'entrée de jeu, les retards se sontaccumulés.
Les accords d'Oslo sont entrés en vigueur le 13 octobre 1993, mais il a fallu attendre le 4 mai 1994 pour que soitsigné, lors d'un sommet israélo-palestinien réuni au Caire, l'accord sur la bande de Gaza et la ville de Jéricho, dit « Gaza-Jérichod'abord », ou Oslo I.
Aucune date n'est sacrée, affirmait M.
Rabin, mais ce premier décalage a entraîné de facto une série d'autres, aggravés par lesdifficultés de la négociation proprement dite et la dégradation de la situation sur le terrain : du meurtre, en février 1994 par uncolon israélien de vingt-neuf musulmans en prière au caveau des Patriarches à Hébron, suivi, en représailles, du premier attentat-suicide du Mouvement de la résistance islamique Hamas ; de l'assassinat d'Itzhak Rabin en novembre 1995 par un extrémiste juifaux nouveaux attentats-suicides du Hamas en février 1996, après le meurtre par l'armée israélienne d'un responsable dumouvement, en passant par deux séquences d'élections législatives anticipées en Israël, qui ont amené successivement au pouvoirun premier ministre de droite, Benyamin Nétanyahou, en 1996, et un autre travailliste, Ehoud Barak, en 1999, tous deux rétifs -dès le départ - aux accords d'Oslo.
Sans oublier la construction, ininterrompue, de colonies de peuplement dans les territoiresoccupés, les « bouclages » à répétition qui asphyxiaient les territoires palestiniens.
De mai 1994 à septembre 1999, il aura fallu pas moins de cinq nouveaux memorandums pour l'application des seuls accordsd'autonomie d'accords déjà conclus.
Un Conseil législatif a bien été élu, une Autorité palestinienne mise sur pied et les grandesvilles palestiniennes confiées à l'autorité civile, administrative et policière du gouvernement palestinien - c'est la zone A ; le restedes territoires obéit à deux autres découpages : certaines zones sont sous contrôle politique et administratif de l'Autorité, maisc'est Israël qui y assure la sécurité (c'est la zone B) ; d'autres sont en zone C, c'est-à-dire toujours entièrement sous contrôleisraélien.
Ce morcellement s'est doublé d'une interdiction pour les Palestiniens de Cisjordanie de se rendre à Jérusalem-Est ouencore à Gaza, de routes de contournement destinées à assurer la sécurité des colonies de peuplement.
La confiance réciproques'est considérablement érodée.
Côté palestinien, loin de voir ses conditions de vie s'améliorer, la population n'a pu jouir d'aucunsdividendes d'un processus censé lui permettre de vivre normalement.
C'est dans ces conditions que s'était ouvert le troisième acte : le sommet israélo- palestinien de Camp David, sous l'égide deBill Clinton.
Après avoir cherché, sans succès, à donner la priorité au volet syrien de la négociation, Ehoud Barak s'était replié, auprintemps 2000, sur le dossier palestinien, à un moment où le calendrier de la négociation avait déjà été totalement bafoué.
M.Barak avait une idée en tête, conclure le plus rapidement possible et parvenir à un accord sur la fin du conflit, alors que lesengagements pris en vertu des accords intérimaires n'avaient pas encore été remplis.
Bill Clinton était sur la même longueurd'onde, qui voulait terminer en apothéose son second mandat, venant à échéance quelques mois plus tard.
Les mises en garde.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- 1993: La paix progresse au Proche-Orient
- PROCHE-ORIENT: de la guerre... à la paix. LA GUERRE AU LIBAN. RÉVOLUTION EN IRAN.
- PROCHE-ORIENT: DE LA PAIX À L’INTIFADA
- Le Moyen-Orient vers la paix
- Les défis économiques du processus de paix au Proche-Orient