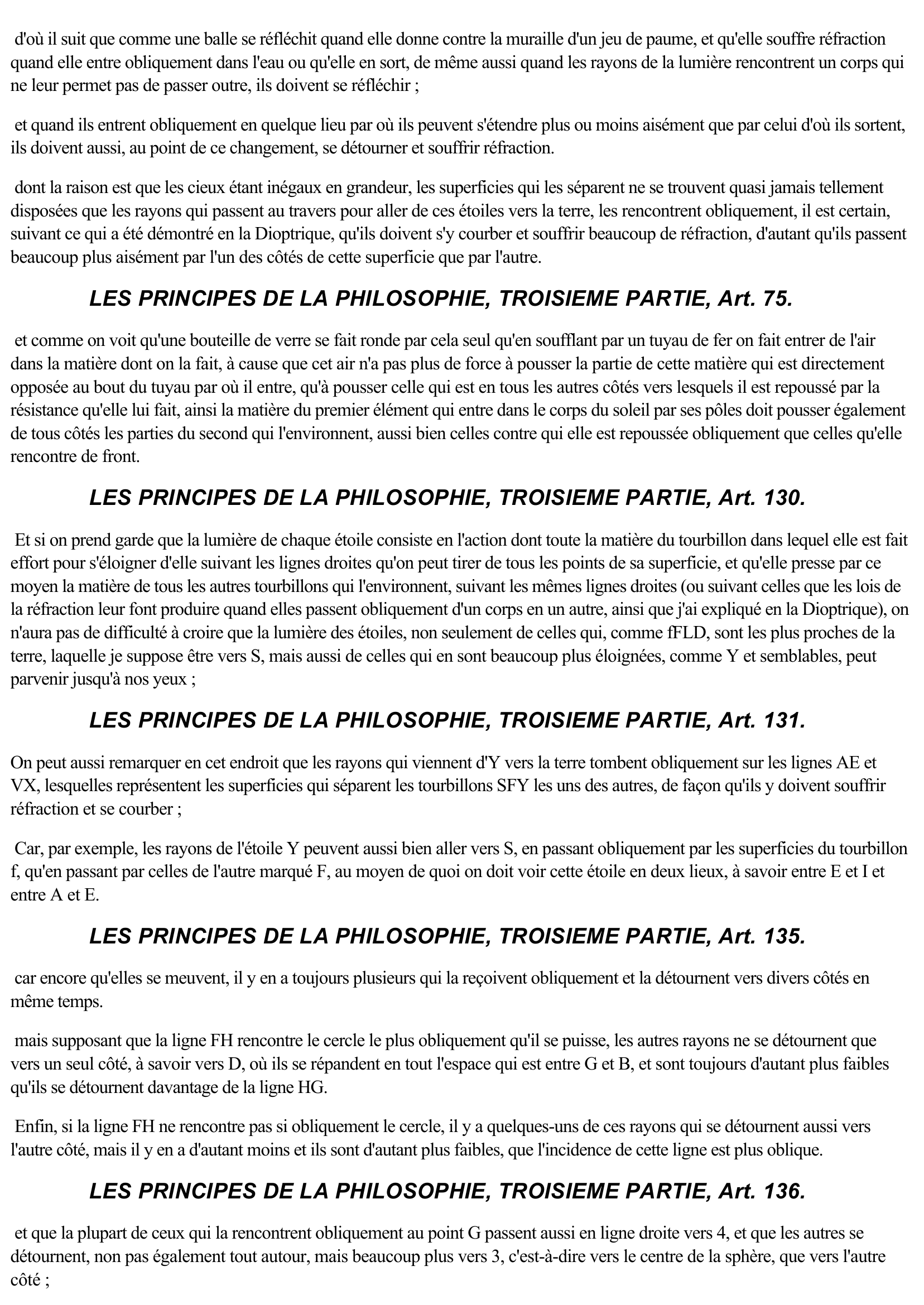Le mot "obliquement" dans l'oeuvre de DESCARTES
Publié le 21/07/2010
Extrait du document
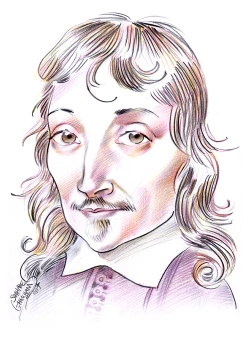
LA DIOPTRIQUE, DISCOURS PREMIER, DE LA LUMIERE.
Enfin, considérez que, si une balle qui se meut rencontre obliquement la superficie d'un corps liquide, par lequel elle puisse passer plus ou moins facilement que par celui d'où elle sort, elle se détourne et change son cours en y entrant :
Enfin, considérez que les rayons se détournent aussi, en même façon qu'il a été dit d'une balle quand ils rencontrent obliquement la superficie d'un corps transparent, par lequel ils pénètrent plus ou moins facilement que par celui d'où ils viennent, et cette façon de se détourner s'appelle en eux réfraction.
LA DIOPTRIQUE, DISCOURS SECOND, DE LA REFRACTION.
Eet on peut ici remarquer, qu'elle est d'autant plus détournée par la superficie de l'eau ou de la toile, qu'elle la rencontre plus obliquement, en sorte que, si elle la rencontre à angles droits, comme lorsqu'elle est poussée de H vers B, elle doit passer outre en ligne droite vers G, sans aucunement se détourner.
Enfin, d'autant que l'action de la lumière suit en ceci les mêmes lois que le mouvement de cette balle, il faut dire que, lorsque ses rayons passent obliquement d'un corps transparent dans un autre, qui les reçoit plus ou moins facilement que le premier, ils s'y détournent en telle sorte, qu'ils se trouvent toujours moins inclinés sur la superficie de ces corps, du côté où est celui qui les reçoit le plus aisément, que du côté où est l'autre ;
LA DIOPTRIQUE, DISCOURS HUITIÈME, DES FIGURES QUE DOIVENT AVOIR LES CORPS TRANSPARENTS POUR DÉTOURNER LES RAYONS PAR RÉFRACTION EN TOUTES LES FACONS QUI SERVENT A LA VUE.
Si bien que si pour tracer l'ellipse DBK, on donne aux lignes DK et HI, la proportion qu'on aura connue par expérience être celle qui sert à mesurer la réfraction de tous les rayons qui passent obliquement de l'air dans quelque verre, ou autre matière transparente qu'on veut employer :
LA DIOPTRIQUE, DISCOURS NEUVIEME, LA DESCRIPTION DES LUNETTES.
mais qu'elle ne sera pas si distincte, si on le rend par trop proche, à cause qu'il y aura plusieurs rayons qui tomberont trop obliquement sur sa superficie au prix des autres.
LA DIOPTRIQUE, DISCOURS DIXIEME, DE LA FACON DE TAILLER LES VERRES.
Mais étant parvenu au point B où il rencontre obliquement son autre superficie RP, il n'en peut sortir sans se courber vers quelque point de la planche EF, comme par exemple vers I.
LES METEORES, DISCOURS NEUVIEME , De la couleur des nues et des cercles ou couronnes qu'on voit quelquefois autour des astres.
car les rayons rencontrent alors trop obliquement les parcelles de glace pour les traverser ;
LES METEORES, DISCOURS DIXIEME, De l'apparition de plusieurs soleils.
au lieu que les parcelles de glace, étant plates, la causent d'autant plus grande, qu'elles sont regardées plus obliquement.
LE MONDE OU TRAITÉ DE LA LUMIERE, CHAPITRE XIII, De la lumière.
non plus qu'une pierre ne tend jamais à descendre obliquement vers le centre de la terre, lorsqu'elle y peut descendre en ligne droite.
LE MONDE OU TRAITÉ DE LA LUMIERE, CHAPITRE XIV, Des propriétés de la Lumière.
d'où il suit que comme une balle se réfléchit quand elle donne contre la muraille d'un jeu de paume, et qu'elle souffre réfraction quand elle entre obliquement dans l'eau ou qu'elle en sort, de même aussi quand les rayons de la lumière rencontrent un corps qui ne leur permet pas de passer outre, ils doivent se réfléchir ;
et quand ils entrent obliquement en quelque lieu par où ils peuvent s'étendre plus ou moins aisément que par celui d'où ils sortent, ils doivent aussi, au point de ce changement, se détourner et souffrir réfraction.
dont la raison est que les cieux étant inégaux en grandeur, les superficies qui les séparent ne se trouvent quasi jamais tellement disposées que les rayons qui passent au travers pour aller de ces étoiles vers la terre, les rencontrent obliquement, il est certain, suivant ce qui a été démontré en la Dioptrique, qu'ils doivent s'y courber et souffrir beaucoup de réfraction, d'autant qu'ils passent beaucoup plus aisément par l'un des côtés de cette superficie que par l'autre.
LES PRINCIPES DE LA PHILOSOPHIE, TROISIEME PARTIE, Art. 75.
et comme on voit qu'une bouteille de verre se fait ronde par cela seul qu'en soufflant par un tuyau de fer on fait entrer de l'air dans la matière dont on la fait, à cause que cet air n'a pas plus de force à pousser la partie de cette matière qui est directement opposée au bout du tuyau par où il entre, qu'à pousser celle qui est en tous les autres côtés vers lesquels il est repoussé par la résistance qu'elle lui fait, ainsi la matière du premier élément qui entre dans le corps du soleil par ses pôles doit pousser également de tous côtés les parties du second qui l'environnent, aussi bien celles contre qui elle est repoussée obliquement que celles qu'elle rencontre de front.
LES PRINCIPES DE LA PHILOSOPHIE, TROISIEME PARTIE, Art. 130.
Et si on prend garde que la lumière de chaque étoile consiste en l'action dont toute la matière du tourbillon dans lequel elle est fait effort pour s'éloigner d'elle suivant les lignes droites qu'on peut tirer de tous les points de sa superficie, et qu'elle presse par ce moyen la matière de tous les autres tourbillons qui l'environnent, suivant les mêmes lignes droites (ou suivant celles que les lois de la réfraction leur font produire quand elles passent obliquement d'un corps en un autre, ainsi que j'ai expliqué en la Dioptrique), on n'aura pas de difficulté à croire que la lumière des étoiles, non seulement de celles qui, comme fFLD, sont les plus proches de la terre, laquelle je suppose être vers S, mais aussi de celles qui en sont beaucoup plus éloignées, comme Y et semblables, peut parvenir jusqu'à nos yeux ;
LES PRINCIPES DE LA PHILOSOPHIE, TROISIEME PARTIE, Art. 131.
On peut aussi remarquer en cet endroit que les rayons qui viennent d'Y vers la terre tombent obliquement sur les lignes AE et VX, lesquelles représentent les superficies qui séparent les tourbillons SFY les uns des autres, de façon qu'ils y doivent souffrir réfraction et se courber ;
Car, par exemple, les rayons de l'étoile Y peuvent aussi bien aller vers S, en passant obliquement par les superficies du tourbillon f, qu'en passant par celles de l'autre marqué F, au moyen de quoi on doit voir cette étoile en deux lieux, à savoir entre E et I et entre A et E.
LES PRINCIPES DE LA PHILOSOPHIE, TROISIEME PARTIE, Art. 135.
car encore qu'elles se meuvent, il y en a toujours plusieurs qui la reçoivent obliquement et la détournent vers divers côtés en même temps.
mais supposant que la ligne FH rencontre le cercle le plus obliquement qu'il se puisse, les autres rayons ne se détournent que vers un seul côté, à savoir vers D, où ils se répandent en tout l'espace qui est entre G et B, et sont toujours d'autant plus faibles qu'ils se détournent davantage de la ligne HG.
Enfin, si la ligne FH ne rencontre pas si obliquement le cercle, il y a quelques-uns de ces rayons qui se détournent aussi vers l'autre côté, mais il y en a d'autant moins et ils sont d'autant plus faibles, que l'incidence de cette ligne est plus oblique.
LES PRINCIPES DE LA PHILOSOPHIE, TROISIEME PARTIE, Art. 136.
et que la plupart de ceux qui la rencontrent obliquement au point G passent aussi en ligne droite vers 4, et que les autres se détournent, non pas également tout autour, mais beaucoup plus vers 3, c'est-à-dire vers le centre de la sphère, que vers l'autre côté ;
Correspondance, année 1638, Au R. P. MERSENNE, 8 octobre 1638. (Les éditions contemporaines retiennent comme date le 11 octobre 1638).
Il est à remarquer qu'il prend la converse de sa proposition, sans la prouver ni l'expliquer à savoir, que, si le coup tiré horizontalement de B vers C suit la parabole BD, le coup tiré obliquement suivant la ligne DE doit suivre la même parabole DB ;
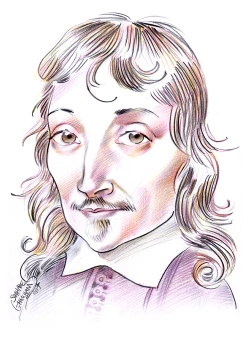
«
d'où il suit que comme une balle se réfléchit quand elle donne contre la muraille d'un jeu de paume, et qu'elle souffre réfractionquand elle entre obliquement dans l'eau ou qu'elle en sort, de même aussi quand les rayons de la lumière rencontrent un corps quine leur permet pas de passer outre, ils doivent se réfléchir ;
et quand ils entrent obliquement en quelque lieu par où ils peuvent s'étendre plus ou moins aisément que par celui d'où ils sortent,ils doivent aussi, au point de ce changement, se détourner et souffrir réfraction.
dont la raison est que les cieux étant inégaux en grandeur, les superficies qui les séparent ne se trouvent quasi jamais tellementdisposées que les rayons qui passent au travers pour aller de ces étoiles vers la terre, les rencontrent obliquement, il est certain,suivant ce qui a été démontré en la Dioptrique, qu'ils doivent s'y courber et souffrir beaucoup de réfraction, d'autant qu'ils passentbeaucoup plus aisément par l'un des côtés de cette superficie que par l'autre.
LES PRINCIPES DE LA PHILOSOPHIE, TROISIEME PARTIE, Art.
75.
et comme on voit qu'une bouteille de verre se fait ronde par cela seul qu'en soufflant par un tuyau de fer on fait entrer de l'airdans la matière dont on la fait, à cause que cet air n'a pas plus de force à pousser la partie de cette matière qui est directementopposée au bout du tuyau par où il entre, qu'à pousser celle qui est en tous les autres côtés vers lesquels il est repoussé par larésistance qu'elle lui fait, ainsi la matière du premier élément qui entre dans le corps du soleil par ses pôles doit pousser égalementde tous côtés les parties du second qui l'environnent, aussi bien celles contre qui elle est repoussée obliquement que celles qu'ellerencontre de front.
LES PRINCIPES DE LA PHILOSOPHIE, TROISIEME PARTIE, Art.
130.
Et si on prend garde que la lumière de chaque étoile consiste en l'action dont toute la matière du tourbillon dans lequel elle est faiteffort pour s'éloigner d'elle suivant les lignes droites qu'on peut tirer de tous les points de sa superficie, et qu'elle presse par cemoyen la matière de tous les autres tourbillons qui l'environnent, suivant les mêmes lignes droites (ou suivant celles que les lois dela réfraction leur font produire quand elles passent obliquement d'un corps en un autre, ainsi que j'ai expliqué en la Dioptrique), onn'aura pas de difficulté à croire que la lumière des étoiles, non seulement de celles qui, comme fFLD, sont les plus proches de laterre, laquelle je suppose être vers S, mais aussi de celles qui en sont beaucoup plus éloignées, comme Y et semblables, peutparvenir jusqu'à nos yeux ;
LES PRINCIPES DE LA PHILOSOPHIE, TROISIEME PARTIE, Art.
131.
On peut aussi remarquer en cet endroit que les rayons qui viennent d'Y vers la terre tombent obliquement sur les lignes AE etVX, lesquelles représentent les superficies qui séparent les tourbillons SFY les uns des autres, de façon qu'ils y doivent souffrirréfraction et se courber ;
Car, par exemple, les rayons de l'étoile Y peuvent aussi bien aller vers S, en passant obliquement par les superficies du tourbillonf, qu'en passant par celles de l'autre marqué F, au moyen de quoi on doit voir cette étoile en deux lieux, à savoir entre E et I etentre A et E.
LES PRINCIPES DE LA PHILOSOPHIE, TROISIEME PARTIE, Art.
135.
car encore qu'elles se meuvent, il y en a toujours plusieurs qui la reçoivent obliquement et la détournent vers divers côtés enmême temps.
mais supposant que la ligne FH rencontre le cercle le plus obliquement qu'il se puisse, les autres rayons ne se détournent quevers un seul côté, à savoir vers D, où ils se répandent en tout l'espace qui est entre G et B, et sont toujours d'autant plus faiblesqu'ils se détournent davantage de la ligne HG.
Enfin, si la ligne FH ne rencontre pas si obliquement le cercle, il y a quelques-uns de ces rayons qui se détournent aussi versl'autre côté, mais il y en a d'autant moins et ils sont d'autant plus faibles, que l'incidence de cette ligne est plus oblique.
LES PRINCIPES DE LA PHILOSOPHIE, TROISIEME PARTIE, Art.
136.
et que la plupart de ceux qui la rencontrent obliquement au point G passent aussi en ligne droite vers 4, et que les autres sedétournent, non pas également tout autour, mais beaucoup plus vers 3, c'est-à-dire vers le centre de la sphère, que vers l'autrecôté ;.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- PASSIONS DE L’ÂME (LES) ou TRAITÉ DES PASSIONS, René Descartes - résumé de l'oeuvre
- LETTRES A LA PRINCESSE ÉLISABETH, de 1643 à 1649. René Descartes - résumé de l'oeuvre
- PRINCIPES DE LA PHILOSOPHIE (Les) René Descartes (résumé et analyse de l’oeuvre)
- DESCARTES René : sa vie et son oeuvre et fiches de lecture
- L'OEUVRE SCIENTIFIQUE DE DESCARTES