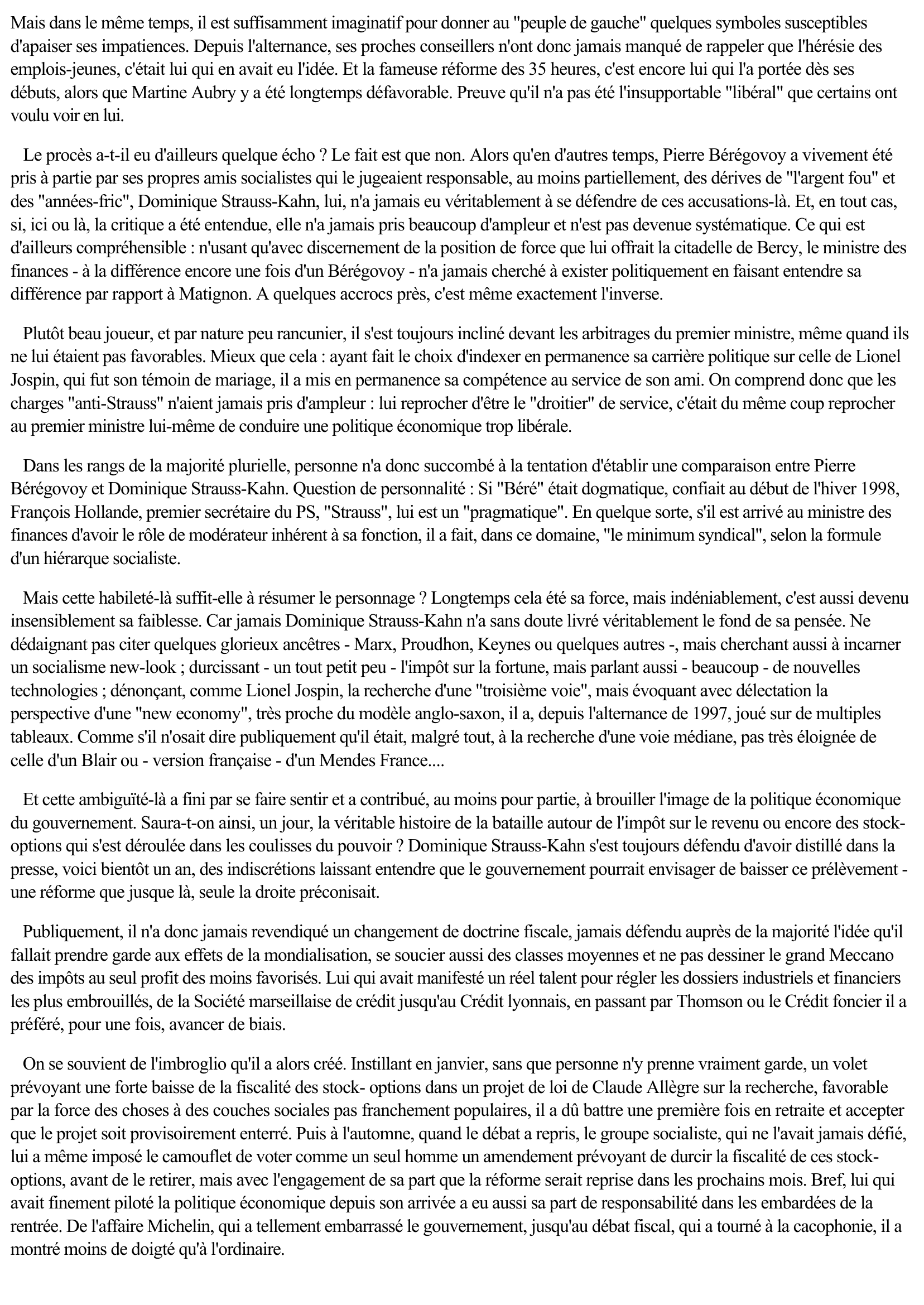La Russie ratifie le traité de désarmement nucléaire Start II
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
«
Mais dans le même temps, il est suffisamment imaginatif pour donner au "peuple de gauche" quelques symboles susceptiblesd'apaiser ses impatiences.
Depuis l'alternance, ses proches conseillers n'ont donc jamais manqué de rappeler que l'hérésie desemplois-jeunes, c'était lui qui en avait eu l'idée.
Et la fameuse réforme des 35 heures, c'est encore lui qui l'a portée dès sesdébuts, alors que Martine Aubry y a été longtemps défavorable.
Preuve qu'il n'a pas été l'insupportable "libéral" que certains ontvoulu voir en lui.
Le procès a-t-il eu d'ailleurs quelque écho ? Le fait est que non.
Alors qu'en d'autres temps, Pierre Bérégovoy a vivement étépris à partie par ses propres amis socialistes qui le jugeaient responsable, au moins partiellement, des dérives de "l'argent fou" etdes "années-fric", Dominique Strauss-Kahn, lui, n'a jamais eu véritablement à se défendre de ces accusations-là.
Et, en tout cas,si, ici ou là, la critique a été entendue, elle n'a jamais pris beaucoup d'ampleur et n'est pas devenue systématique.
Ce qui estd'ailleurs compréhensible : n'usant qu'avec discernement de la position de force que lui offrait la citadelle de Bercy, le ministre desfinances - à la différence encore une fois d'un Bérégovoy - n'a jamais cherché à exister politiquement en faisant entendre sadifférence par rapport à Matignon.
A quelques accrocs près, c'est même exactement l'inverse.
Plutôt beau joueur, et par nature peu rancunier, il s'est toujours incliné devant les arbitrages du premier ministre, même quand ilsne lui étaient pas favorables.
Mieux que cela : ayant fait le choix d'indexer en permanence sa carrière politique sur celle de LionelJospin, qui fut son témoin de mariage, il a mis en permanence sa compétence au service de son ami.
On comprend donc que lescharges "anti-Strauss" n'aient jamais pris d'ampleur : lui reprocher d'être le "droitier" de service, c'était du même coup reprocherau premier ministre lui-même de conduire une politique économique trop libérale.
Dans les rangs de la majorité plurielle, personne n'a donc succombé à la tentation d'établir une comparaison entre PierreBérégovoy et Dominique Strauss-Kahn.
Question de personnalité : Si "Béré" était dogmatique, confiait au début de l'hiver 1998,François Hollande, premier secrétaire du PS, "Strauss", lui est un "pragmatique".
En quelque sorte, s'il est arrivé au ministre desfinances d'avoir le rôle de modérateur inhérent à sa fonction, il a fait, dans ce domaine, "le minimum syndical", selon la formuled'un hiérarque socialiste.
Mais cette habileté-là suffit-elle à résumer le personnage ? Longtemps cela été sa force, mais indéniablement, c'est aussi devenuinsensiblement sa faiblesse.
Car jamais Dominique Strauss-Kahn n'a sans doute livré véritablement le fond de sa pensée.
Nedédaignant pas citer quelques glorieux ancêtres - Marx, Proudhon, Keynes ou quelques autres -, mais cherchant aussi à incarnerun socialisme new-look ; durcissant - un tout petit peu - l'impôt sur la fortune, mais parlant aussi - beaucoup - de nouvellestechnologies ; dénonçant, comme Lionel Jospin, la recherche d'une "troisième voie", mais évoquant avec délectation laperspective d'une "new economy", très proche du modèle anglo-saxon, il a, depuis l'alternance de 1997, joué sur de multiplestableaux.
Comme s'il n'osait dire publiquement qu'il était, malgré tout, à la recherche d'une voie médiane, pas très éloignée decelle d'un Blair ou - version française - d'un Mendes France....
Et cette ambiguïté-là a fini par se faire sentir et a contribué, au moins pour partie, à brouiller l'image de la politique économiquedu gouvernement.
Saura-t-on ainsi, un jour, la véritable histoire de la bataille autour de l'impôt sur le revenu ou encore des stock-options qui s'est déroulée dans les coulisses du pouvoir ? Dominique Strauss-Kahn s'est toujours défendu d'avoir distillé dans lapresse, voici bientôt un an, des indiscrétions laissant entendre que le gouvernement pourrait envisager de baisser ce prélèvement -une réforme que jusque là, seule la droite préconisait.
Publiquement, il n'a donc jamais revendiqué un changement de doctrine fiscale, jamais défendu auprès de la majorité l'idée qu'ilfallait prendre garde aux effets de la mondialisation, se soucier aussi des classes moyennes et ne pas dessiner le grand Meccanodes impôts au seul profit des moins favorisés.
Lui qui avait manifesté un réel talent pour régler les dossiers industriels et financiersles plus embrouillés, de la Société marseillaise de crédit jusqu'au Crédit lyonnais, en passant par Thomson ou le Crédit foncier il apréféré, pour une fois, avancer de biais.
On se souvient de l'imbroglio qu'il a alors créé.
Instillant en janvier, sans que personne n'y prenne vraiment garde, un voletprévoyant une forte baisse de la fiscalité des stock- options dans un projet de loi de Claude Allègre sur la recherche, favorablepar la force des choses à des couches sociales pas franchement populaires, il a dû battre une première fois en retraite et accepterque le projet soit provisoirement enterré.
Puis à l'automne, quand le débat a repris, le groupe socialiste, qui ne l'avait jamais défié,lui a même imposé le camouflet de voter comme un seul homme un amendement prévoyant de durcir la fiscalité de ces stock-options, avant de le retirer, mais avec l'engagement de sa part que la réforme serait reprise dans les prochains mois.
Bref, lui quiavait finement piloté la politique économique depuis son arrivée a eu aussi sa part de responsabilité dans les embardées de larentrée.
De l'affaire Michelin, qui a tellement embarrassé le gouvernement, jusqu'au débat fiscal, qui a tourné à la cacophonie, il amontré moins de doigté qu'à l'ordinaire..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- RICHELIEU, Armand Emmanuel du Plessis, duc de (1766-1822) Homme politique, il émigre en Russie pendant la révolution et devient Premier ministre sous la Restauration : il signe le second traité de Paris et obtient la libération du territoire national en 1818.
- RICHELIEU, Armand Emmanuel du Plessis, duc de (1766-1822) Homme politique, il émigre en Russie pendant la révolution et devient Premier ministre sous la Restauration : il signe le second traité de Paris et obtient la libération du territoire national en 1818.
- Le traité START 2
- 1968 Traité de non-prolifération nucléaire
- Traité de non-prolifération nucléaire