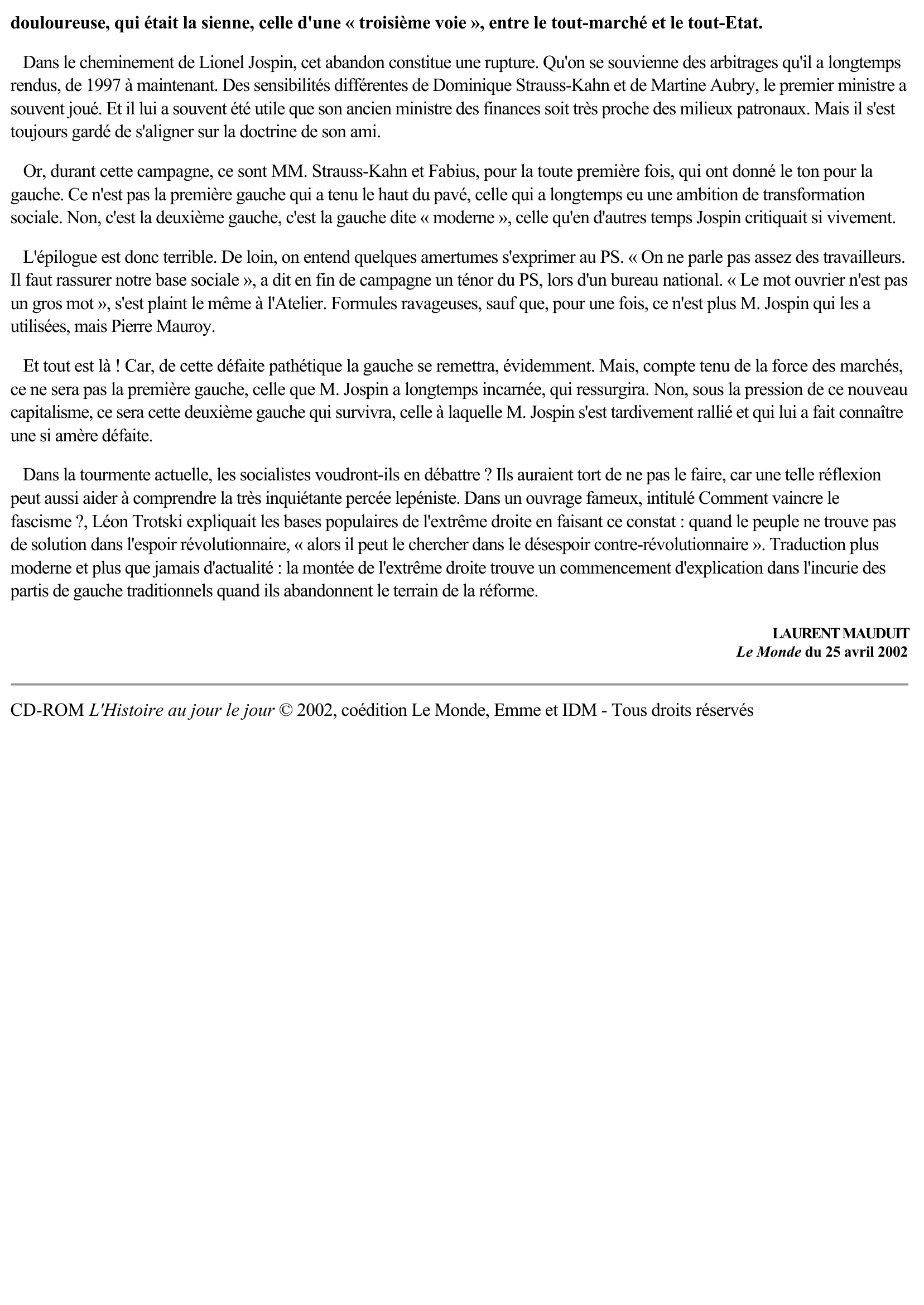La « première gauche » vient-elle de mourir ?
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
«
douloureuse, qui était la sienne, celle d'une « troisième voie », entre le tout-marché et le tout-Etat.
Dans le cheminement de Lionel Jospin, cet abandon constitue une rupture.
Qu'on se souvienne des arbitrages qu'il a longtempsrendus, de 1997 à maintenant.
Des sensibilités différentes de Dominique Strauss-Kahn et de Martine Aubry, le premier ministre asouvent joué.
Et il lui a souvent été utile que son ancien ministre des finances soit très proche des milieux patronaux.
Mais il s'esttoujours gardé de s'aligner sur la doctrine de son ami.
Or, durant cette campagne, ce sont MM.
Strauss-Kahn et Fabius, pour la toute première fois, qui ont donné le ton pour lagauche.
Ce n'est pas la première gauche qui a tenu le haut du pavé, celle qui a longtemps eu une ambition de transformationsociale.
Non, c'est la deuxième gauche, c'est la gauche dite « moderne », celle qu'en d'autres temps Jospin critiquait si vivement.
L'épilogue est donc terrible.
De loin, on entend quelques amertumes s'exprimer au PS.
« On ne parle pas assez des travailleurs.Il faut rassurer notre base sociale », a dit en fin de campagne un ténor du PS, lors d'un bureau national.
« Le mot ouvrier n'est pasun gros mot », s'est plaint le même à l'Atelier.
Formules ravageuses, sauf que, pour une fois, ce n'est plus M.
Jospin qui les autilisées, mais Pierre Mauroy.
Et tout est là ! Car, de cette défaite pathétique la gauche se remettra, évidemment.
Mais, compte tenu de la force des marchés,ce ne sera pas la première gauche, celle que M.
Jospin a longtemps incarnée, qui ressurgira.
Non, sous la pression de ce nouveaucapitalisme, ce sera cette deuxième gauche qui survivra, celle à laquelle M.
Jospin s'est tardivement rallié et qui lui a fait connaîtreune si amère défaite.
Dans la tourmente actuelle, les socialistes voudront-ils en débattre ? Ils auraient tort de ne pas le faire, car une telle réflexionpeut aussi aider à comprendre la très inquiétante percée lepéniste.
Dans un ouvrage fameux, intitulé Comment vaincre lefascisme ?, Léon Trotski expliquait les bases populaires de l'extrême droite en faisant ce constat : quand le peuple ne trouve pasde solution dans l'espoir révolutionnaire, « alors il peut le chercher dans le désespoir contre-révolutionnaire ».
Traduction plusmoderne et plus que jamais d'actualité : la montée de l'extrême droite trouve un commencement d'explication dans l'incurie despartis de gauche traditionnels quand ils abandonnent le terrain de la réforme.
LAURENT MAUDUIT Le Monde du 25 avril 2002
CD-ROM L'Histoire au jour le jour © 2002, coédition Le Monde, Emme et IDM - Tous droits réservés.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Question 99 Alors qu'elle vient d'enregistrer une indéniable victoire aux élections municipales, la gauche semble se saborder, en septembre 1977, en achoppant sur: A.
- « Mes amis, au secours ! Une femme vient de mourir gelée. » L'ABBÉ PIERRE, en 1954. Commentez.
- « Dès qu'un humain vient à la vie, il est déjà assez vieux pour mourir. » Heidegger, Être et Temps, 1927. Commentez cette citation.
- Le mot travail vient de tripalium, qui est un instrument de torture.
- Mettre avant ce qui vient après