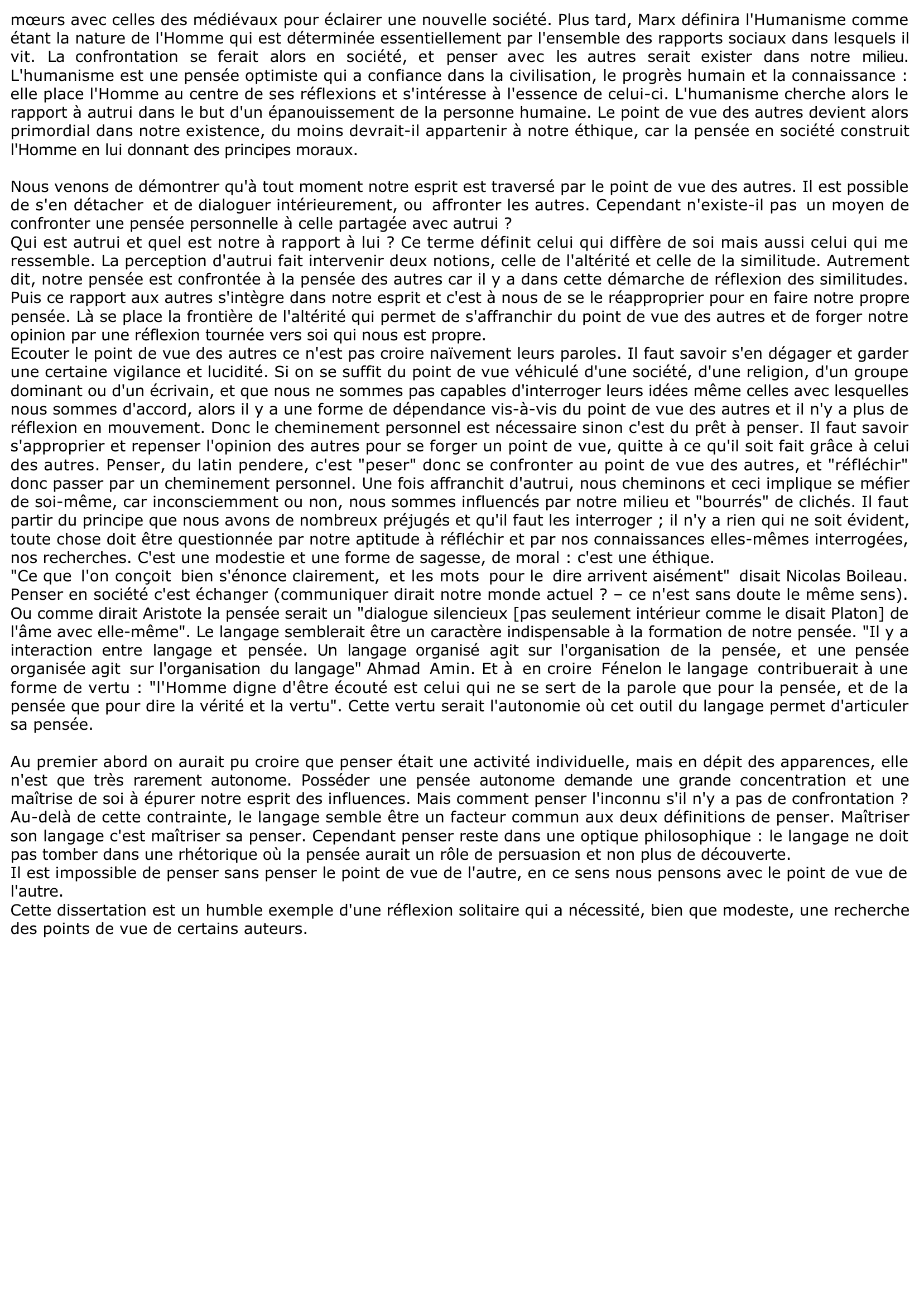La Politique nous concerne-t-elle tous ?
Publié le 22/07/2010
Extrait du document
Depuis sa naissance l'Homme est apte à réfléchir et ainsi à penser sur le monde qui l'entoure et sur sa propre existence. Exposé à la société et ses institutions, il est à tout moment influencé par l'autre. Pour penser par soi-même, faut-il oublier le point de vue des autres ? Penser est une activité spirituelle tournée volontairement vers la réflexion et la connaissance. Notre pensée suit un cheminement pour élaborer un système d'idées et de concepts généraux. Penser apparaît donc comme une activité solitaire où seule notre capacité de raisonnement entre en jeu. Cependant penser reflète aussi une sagesse intellectuelle avec laquelle il ne faut pas oublier que si le point de vue des autres existe, ce n'est pas pour nous concurrencer mais pour éclairer notre cheminement de réflexion personnelle. Le point de vue des autres serait alors une source d'informations qui permettrait de forger notre pensée. Peut-on admettre que penser s'active nécessairement aux dépends d'autrui alors même que par essence, penser naît d'une volonté de soi à s'interroger ? Platon dit que penser est un "dialogue intérieur de l'âme avec elle-même". Penser serait alors s'isoler ? Ou bien penser est-ce entretenir un rapport avec les autres ? N'y aurait-t-il pas possibilité de concilier l'un et l'autre ? Penser seul est une activité possible. Selon Platon, cet échange en dia (deux) – logue (logos, la parole) serait entre sa propre âme et soi. L'âme serait-elle l'esprit ? la conscience ? Ce souffle (du grec anemos) qui désigne le principe de l'activité consciente de l'homme et de façon plus large le principe de vie de tout être vivant ou animé. Mais cette activité intérieure demande une grande maîtrise car notre esprit est en permanence traversé par le point de vue des autres qu'on le veuille ou non. Penser est donc avant tout un apprentissage qui consiste à épurer notre esprit et à revenir à la spontanéité de notre réflexion : une pensée "sauvage". L'Homme est apte à réfléchir (qualité innée), penser est alors un réapprentissage de soi qui vise à rechercher notre essence spirituelle. Penser naît d'une volonté qui nous tourne vers une réflexion personnelle ; on utilise donc notre propre raison et donnons ainsi une certaine singularité à notre pensée. Si penser est une activité purement solitaire nos connaissances et nos idées naissent alors de nos sensations et de notre vécu. Cependant le déterminisme du milieu nous empêche de retrouver une pensée virginale, et oriente notre cheminement de réflexion vers nos centres d'intérêts sur lesquels ce sont forgés nos valeurs. Penser est alors pratiquer nos choix et nos valeurs pour se connaître soi-même au plus profond : le "connais-toi toi-même" de Socrate. Notre cheminement s'appuie donc sur nos expériences et des faits qui constituent un système d'idées personnel soumis à nos sens. Cette pensée singulière s'inscrit dans l'expérience du cogito (du latin, "penser") de Descartes. C'est une action en soi qui lie la pensée à la conscience de façon à saisir le plus subjectif en soi. Cette expérience individuelle démontre que notre pensée la plus subjective arrive à une certitude absolue qui révèle une vérité objective. Et ainsi nous arrivons à la conclusion que parce que nous pensons alors nous existons. Cette affirmation posée, Descartes nous dit que cette pensée solitaire est tout à fait envisageable et qu'elle est même primordiale pour exister. Penser seul se limiterait alors à la seule découverte de soi ou à une vérité, certes objective mais qui n'a de sens que dans notre subjectivité. Socrate cherchait lui aussi à atteindre une vérité. Se donnant le rôle de maître il ne cherchait pas à imposer ses idées à ses élèves mais à les conduire par une série de questions, à "accoucher" eux-mêmes des vérités qu'ils portaient en eux sans le savoir. Cette méthode appelée maïeutique (du grec maieutiké, l'art de faire accoucher les esprits) est alors un éclairage dans notre démarche de réflexion qui reste personnelle. La pensée est alors simplement orientée vers un sujet mais n'est pas influencée par un point de vue extérieur. C'est une habile méthode pédagogique qui consiste, par extension, à faire penser le disciple par lui-même, à ne pas le détourner de son cheminement d'une rhétorique séduisante du Maître. Les différents points de vue des autres englobent celui des autres êtres pensant comme nous tels que notre entourage ou les auteurs. Mais ils sont emprunts aussi les idées véhiculées par la société, le milieu, l'éducation. L'Homme est destiné à vivre en société : il naît en société, il grandit en société, il apprend et parle en société. Il est donc traversé en permanence par le point de vue des autres, il écoute et observe : il pense avec autrui. Si penser est une volonté de soi qui se tourne vers la connaissance, alors penser c'est avoir une certaine curiosité qui nous pousse à se renseigner et à chercher la confrontation avec autrui. La curiosité (du latin, "qui cherche à connaître") est une ouverture sur le monde. Bien que Socrate encourageât la réflexion personnelle, il cherchait cependant une confrontation (du latin, confrontare, "mettre face à face") : mettre des personnes en présence pour comparer leurs dires. Il affirmait même "je sais que je ne sais rien" : une sagesse intellectuelle où il faut accepter d'être guider vers la connaissance. Penser avec autrui serait alors vivre en société. Nietzsche disait que "penser est une action". S'informer permet d'acquérir de la matière : des références essentielles qui permettent d'articuler une réflexion et de se forger un point de vue, une opinion. La pensée n'est pas innée, c'est une chose qui s'acquiert pas un cheminement de réflexion où l'on interroge les mots, les concepts et les points de vue des autres et des Anciens. Il faut être devant les choses comme si elles n'étaient pas évidentes, même si notre premier élan nous dit le contraire. Notre pensée n'est pas virginale car c'est au fur et à mesure en se forgeant sa personnalité par ces interrogations que l'on se fait son propre point de vue à la façon des humanistes qui nous conseillent d'écouter, d'étudier, de comparer. C'est à nous ensuite de confronter ces idées à notre époque : les garder vivantes pour permettre son propre point de vue. Vauvenargues disait que "ceux qui croient n'avoir plus besoin d'autrui deviennent intraitables". Le point de vue des autres éclaire le notre. Et ne pas en tenir compte serait se limiter dans notre réflexion. S'isoler serait alors supprimer toute une pensée humaniste qui permet le partage et la sociabilité. Les humanistes souhaitaient restituer les textes médiévaux dans leur forme originelle pour récupérer le sens authentique de cette civilisation, se confronter à elle pour donner vie à un nouveau modèle de culture, à une humanité nouvelle. Ces humanistes comparaient alors leurs mœurs avec celles des médiévaux pour éclairer une nouvelle société. Plus tard, Marx définira l'Humanisme comme étant la nature de l'Homme qui est déterminée essentiellement par l'ensemble des rapports sociaux dans lesquels il vit. La confrontation se ferait alors en société, et penser avec les autres serait exister dans notre milieu. L'humanisme est une pensée optimiste qui a confiance dans la civilisation, le progrès humain et la connaissance : elle place l'Homme au centre de ses réflexions et s'intéresse à l'essence de celui-ci. L'humanisme cherche alors le rapport à autrui dans le but d'un épanouissement de la personne humaine. Le point de vue des autres devient alors primordial dans notre existence, du moins devrait-il appartenir à notre éthique, car la pensée en société construit l'Homme en lui donnant des principes moraux. Nous venons de démontrer qu'à tout moment notre esprit est traversé par le point de vue des autres. Il est possible de s'en détacher et de dialoguer intérieurement, ou affronter les autres. Cependant n'existe-il pas un moyen de confronter une pensée personnelle à celle partagée avec autrui ? Qui est autrui et quel est notre à rapport à lui ? Ce terme définit celui qui diffère de soi mais aussi celui qui me ressemble. La perception d'autrui fait intervenir deux notions, celle de l'altérité et celle de la similitude. Autrement dit, notre pensée est confrontée à la pensée des autres car il y a dans cette démarche de réflexion des similitudes. Puis ce rapport aux autres s'intègre dans notre esprit et c'est à nous de se le réapproprier pour en faire notre propre pensée. Là se place la frontière de l'altérité qui permet de s'affranchir du point de vue des autres et de forger notre opinion par une réflexion tournée vers soi qui nous est propre. Ecouter le point de vue des autres ce n'est pas croire naïvement leurs paroles. Il faut savoir s'en dégager et garder une certaine vigilance et lucidité. Si on se suffit du point de vue véhiculé d'une société, d'une religion, d'un groupe dominant ou d'un écrivain, et que nous ne sommes pas capables d'interroger leurs idées même celles avec lesquelles nous sommes d'accord, alors il y a une forme de dépendance vis-à-vis du point de vue des autres et il n'y a plus de réflexion en mouvement. Donc le cheminement personnel est nécessaire sinon c'est du prêt à penser. Il faut savoir s'approprier et repenser l'opinion des autres pour se forger un point de vue, quitte à ce qu'il soit fait grâce à celui des autres. Penser, du latin pendere, c'est "peser" donc se confronter au point de vue des autres, et "réfléchir" donc passer par un cheminement personnel. Une fois affranchit d'autrui, nous cheminons et ceci implique se méfier de soi-même, car inconsciemment ou non, nous sommes influencés par notre milieu et "bourrés" de clichés. Il faut partir du principe que nous avons de nombreux préjugés et qu'il faut les interroger ; il n'y a rien qui ne soit évident, toute chose doit être questionnée par notre aptitude à réfléchir et par nos connaissances elles-mêmes interrogées, nos recherches. C'est une modestie et une forme de sagesse, de moral : c'est une éthique. "Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément" disait Nicolas Boileau. Penser en société c'est échanger (communiquer dirait notre monde actuel ? – ce n'est sans doute le même sens). Ou comme dirait Aristote la pensée serait un "dialogue silencieux [pas seulement intérieur comme le disait Platon] de l'âme avec elle-même". Le langage semblerait être un caractère indispensable à la formation de notre pensée. "Il y a interaction entre langage et pensée. Un langage organisé agit sur l'organisation de la pensée, et une pensée organisée agit sur l'organisation du langage" Ahmad Amin. Et à en croire Fénelon le langage contribuerait à une forme de vertu : "l'Homme digne d'être écouté est celui qui ne se sert de la parole que pour la pensée, et de la pensée que pour dire la vérité et la vertu". Cette vertu serait l'autonomie où cet outil du langage permet d'articuler sa pensée. Au premier abord on aurait pu croire que penser était une activité individuelle, mais en dépit des apparences, elle n'est que très rarement autonome. Posséder une pensée autonome demande une grande concentration et une maîtrise de soi à épurer notre esprit des influences. Mais comment penser l'inconnu s'il n'y a pas de confrontation ? Au-delà de cette contrainte, le langage semble être un facteur commun aux deux définitions de penser. Maîtriser son langage c'est maîtriser sa penser. Cependant penser reste dans une optique philosophique : le langage ne doit pas tomber dans une rhétorique où la pensée aurait un rôle de persuasion et non plus de découverte. Il est impossible de penser sans penser le point de vue de l'autre, en ce sens nous pensons avec le point de vue de l'autre. Cette dissertation est un humble exemple d'une réflexion solitaire qui a nécessité, bien que modeste, une recherche des points de vue de certains auteurs.
«
mœurs avec celles des médiévaux pour éclairer une nouvelle société.
Plus tard, Marx définira l'Humanisme commeétant la nature de l'Homme qui est déterminée essentiellement par l'ensemble des rapports sociaux dans lesquels ilvit.
La confrontation se ferait alors en société, et penser avec les autres serait exister dans notre milieu.L'humanisme est une pensée optimiste qui a confiance dans la civilisation, le progrès humain et la connaissance :elle place l'Homme au centre de ses réflexions et s'intéresse à l'essence de celui-ci.
L'humanisme cherche alors lerapport à autrui dans le but d'un épanouissement de la personne humaine.
Le point de vue des autres devient alorsprimordial dans notre existence, du moins devrait-il appartenir à notre éthique, car la pensée en société construitl'Homme en lui donnant des principes moraux.
Nous venons de démontrer qu'à tout moment notre esprit est traversé par le point de vue des autres.
Il est possiblede s'en détacher et de dialoguer intérieurement, ou affronter les autres.
Cependant n'existe-il pas un moyen deconfronter une pensée personnelle à celle partagée avec autrui ?Qui est autrui et quel est notre à rapport à lui ? Ce terme définit celui qui diffère de soi mais aussi celui qui meressemble.
La perception d'autrui fait intervenir deux notions, celle de l'altérité et celle de la similitude.
Autrementdit, notre pensée est confrontée à la pensée des autres car il y a dans cette démarche de réflexion des similitudes.Puis ce rapport aux autres s'intègre dans notre esprit et c'est à nous de se le réapproprier pour en faire notre proprepensée.
Là se place la frontière de l'altérité qui permet de s'affranchir du point de vue des autres et de forger notreopinion par une réflexion tournée vers soi qui nous est propre.Ecouter le point de vue des autres ce n'est pas croire naïvement leurs paroles.
Il faut savoir s'en dégager et garderune certaine vigilance et lucidité.
Si on se suffit du point de vue véhiculé d'une société, d'une religion, d'un groupedominant ou d'un écrivain, et que nous ne sommes pas capables d'interroger leurs idées même celles avec lesquellesnous sommes d'accord, alors il y a une forme de dépendance vis-à-vis du point de vue des autres et il n'y a plus deréflexion en mouvement.
Donc le cheminement personnel est nécessaire sinon c'est du prêt à penser.
Il faut savoirs'approprier et repenser l'opinion des autres pour se forger un point de vue, quitte à ce qu'il soit fait grâce à celuides autres.
Penser, du latin pendere, c'est "peser" donc se confronter au point de vue des autres, et "réfléchir"donc passer par un cheminement personnel.
Une fois affranchit d'autrui, nous cheminons et ceci implique se méfierde soi-même, car inconsciemment ou non, nous sommes influencés par notre milieu et "bourrés" de clichés.
Il fautpartir du principe que nous avons de nombreux préjugés et qu'il faut les interroger ; il n'y a rien qui ne soit évident,toute chose doit être questionnée par notre aptitude à réfléchir et par nos connaissances elles-mêmes interrogées,nos recherches.
C'est une modestie et une forme de sagesse, de moral : c'est une éthique."Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément" disait Nicolas Boileau.Penser en société c'est échanger (communiquer dirait notre monde actuel ? – ce n'est sans doute le même sens).Ou comme dirait Aristote la pensée serait un "dialogue silencieux [pas seulement intérieur comme le disait Platon] del'âme avec elle-même".
Le langage semblerait être un caractère indispensable à la formation de notre pensée.
"Il y ainteraction entre langage et pensée.
Un langage organisé agit sur l'organisation de la pensée, et une penséeorganisée agit sur l'organisation du langage" Ahmad Amin.
Et à en croire Fénelon le langage contribuerait à uneforme de vertu : "l'Homme digne d'être écouté est celui qui ne se sert de la parole que pour la pensée, et de lapensée que pour dire la vérité et la vertu".
Cette vertu serait l'autonomie où cet outil du langage permet d'articulersa pensée.
Au premier abord on aurait pu croire que penser était une activité individuelle, mais en dépit des apparences, ellen'est que très rarement autonome.
Posséder une pensée autonome demande une grande concentration et unemaîtrise de soi à épurer notre esprit des influences.
Mais comment penser l'inconnu s'il n'y a pas de confrontation ?Au-delà de cette contrainte, le langage semble être un facteur commun aux deux définitions de penser.
Maîtriserson langage c'est maîtriser sa penser.
Cependant penser reste dans une optique philosophique : le langage ne doitpas tomber dans une rhétorique où la pensée aurait un rôle de persuasion et non plus de découverte.Il est impossible de penser sans penser le point de vue de l'autre, en ce sens nous pensons avec le point de vue del'autre.Cette dissertation est un humble exemple d'une réflexion solitaire qui a nécessité, bien que modeste, une recherchedes points de vue de certains auteurs..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La politique nous concerne-t-elle tous ?
- La politique nous concerne-t-elle tous ?
- Peut-on définir la politique: toute activité qui concerne le pouvoir ?
- « La politique de la littérature n'est pas la politique des écrivains. Elle ne concerne pas leurs engagements personnels dans les luttes politiques et sociales de leur temps. Elle ne concerne pas non plus la manière dont ils représentent dans leurs livres les structures sociales, les mouvements politiques ou les identités diverses. L'expression « politique de la littérature » implique que la littérature fait de la politique en tant que littérature. Elle suppose qu'il n'y a pas à se dem
- La politique, c'est la distinction de l'ami et l'ennemi de Schmitt