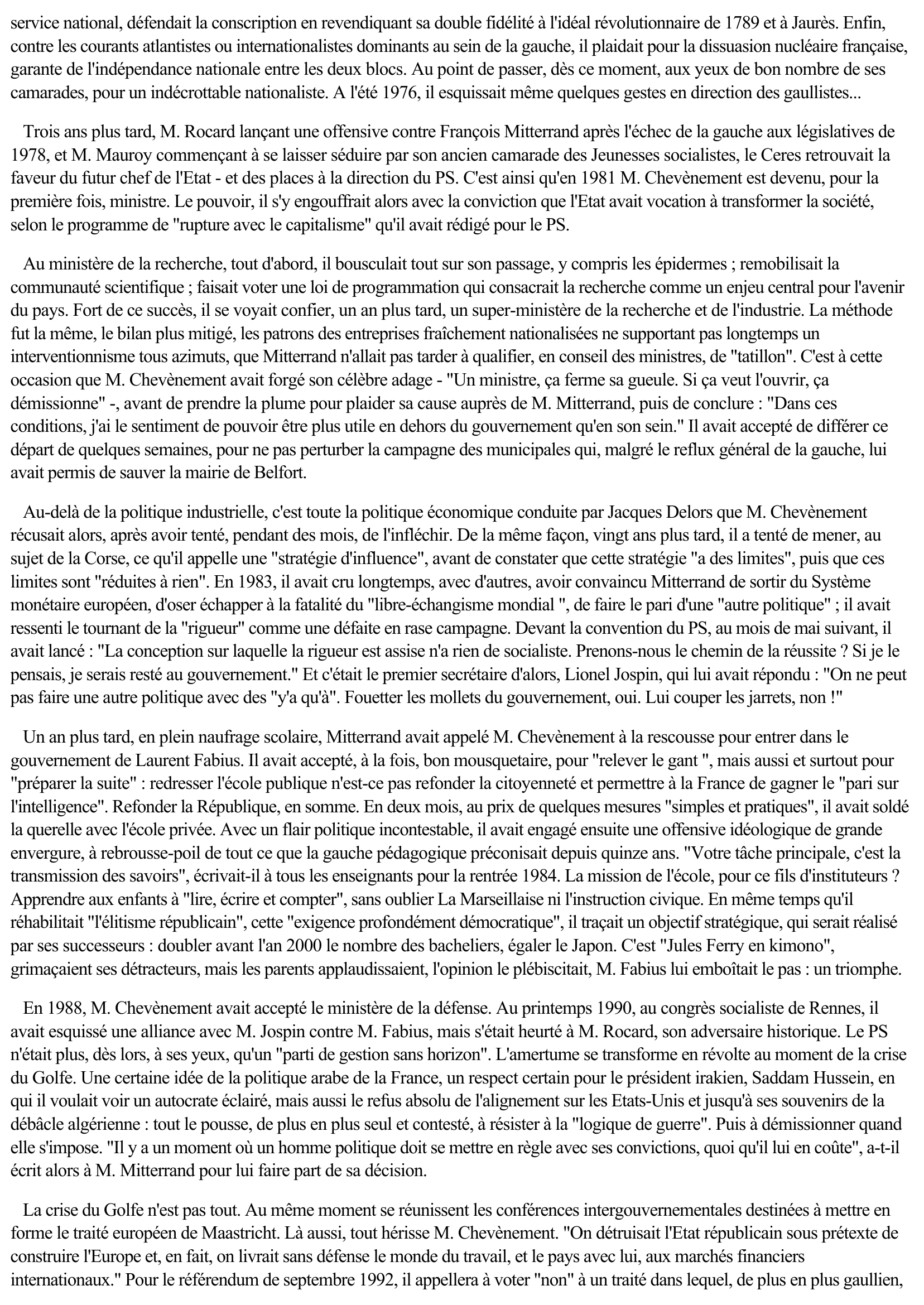JEAN - PIERRE CHEVENEMENT Un nationalisme républicain dirigé contre les particularismes
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
«
service national, défendait la conscription en revendiquant sa double fidélité à l'idéal révolutionnaire de 1789 et à Jaurès.
Enfin,contre les courants atlantistes ou internationalistes dominants au sein de la gauche, il plaidait pour la dissuasion nucléaire française,garante de l'indépendance nationale entre les deux blocs.
Au point de passer, dès ce moment, aux yeux de bon nombre de sescamarades, pour un indécrottable nationaliste.
A l'été 1976, il esquissait même quelques gestes en direction des gaullistes...
Trois ans plus tard, M.
Rocard lançant une offensive contre François Mitterrand après l'échec de la gauche aux législatives de1978, et M.
Mauroy commençant à se laisser séduire par son ancien camarade des Jeunesses socialistes, le Ceres retrouvait lafaveur du futur chef de l'Etat - et des places à la direction du PS.
C'est ainsi qu'en 1981 M.
Chevènement est devenu, pour lapremière fois, ministre.
Le pouvoir, il s'y engouffrait alors avec la conviction que l'Etat avait vocation à transformer la société,selon le programme de "rupture avec le capitalisme" qu'il avait rédigé pour le PS.
Au ministère de la recherche, tout d'abord, il bousculait tout sur son passage, y compris les épidermes ; remobilisait lacommunauté scientifique ; faisait voter une loi de programmation qui consacrait la recherche comme un enjeu central pour l'avenirdu pays.
Fort de ce succès, il se voyait confier, un an plus tard, un super-ministère de la recherche et de l'industrie.
La méthodefut la même, le bilan plus mitigé, les patrons des entreprises fraîchement nationalisées ne supportant pas longtemps uninterventionnisme tous azimuts, que Mitterrand n'allait pas tarder à qualifier, en conseil des ministres, de "tatillon".
C'est à cetteoccasion que M.
Chevènement avait forgé son célèbre adage - "Un ministre, ça ferme sa gueule.
Si ça veut l'ouvrir, çadémissionne" -, avant de prendre la plume pour plaider sa cause auprès de M.
Mitterrand, puis de conclure : "Dans cesconditions, j'ai le sentiment de pouvoir être plus utile en dehors du gouvernement qu'en son sein." Il avait accepté de différer cedépart de quelques semaines, pour ne pas perturber la campagne des municipales qui, malgré le reflux général de la gauche, luiavait permis de sauver la mairie de Belfort.
Au-delà de la politique industrielle, c'est toute la politique économique conduite par Jacques Delors que M.
Chevènementrécusait alors, après avoir tenté, pendant des mois, de l'infléchir.
De la même façon, vingt ans plus tard, il a tenté de mener, ausujet de la Corse, ce qu'il appelle une "stratégie d'influence", avant de constater que cette stratégie "a des limites", puis que ceslimites sont "réduites à rien".
En 1983, il avait cru longtemps, avec d'autres, avoir convaincu Mitterrand de sortir du Systèmemonétaire européen, d'oser échapper à la fatalité du "libre-échangisme mondial ", de faire le pari d'une "autre politique" ; il avaitressenti le tournant de la "rigueur" comme une défaite en rase campagne.
Devant la convention du PS, au mois de mai suivant, ilavait lancé : "La conception sur laquelle la rigueur est assise n'a rien de socialiste.
Prenons-nous le chemin de la réussite ? Si je lepensais, je serais resté au gouvernement." Et c'était le premier secrétaire d'alors, Lionel Jospin, qui lui avait répondu : "On ne peutpas faire une autre politique avec des "y'a qu'à".
Fouetter les mollets du gouvernement, oui.
Lui couper les jarrets, non !"
Un an plus tard, en plein naufrage scolaire, Mitterrand avait appelé M.
Chevènement à la rescousse pour entrer dans legouvernement de Laurent Fabius.
Il avait accepté, à la fois, bon mousquetaire, pour "relever le gant ", mais aussi et surtout pour"préparer la suite" : redresser l'école publique n'est-ce pas refonder la citoyenneté et permettre à la France de gagner le "pari surl'intelligence".
Refonder la République, en somme.
En deux mois, au prix de quelques mesures "simples et pratiques", il avait soldéla querelle avec l'école privée.
Avec un flair politique incontestable, il avait engagé ensuite une offensive idéologique de grandeenvergure, à rebrousse-poil de tout ce que la gauche pédagogique préconisait depuis quinze ans.
"Votre tâche principale, c'est latransmission des savoirs", écrivait-il à tous les enseignants pour la rentrée 1984.
La mission de l'école, pour ce fils d'instituteurs ?Apprendre aux enfants à "lire, écrire et compter", sans oublier La Marseillaise ni l'instruction civique.
En même temps qu'ilréhabilitait "l'élitisme républicain", cette "exigence profondément démocratique", il traçait un objectif stratégique, qui serait réalisépar ses successeurs : doubler avant l'an 2000 le nombre des bacheliers, égaler le Japon.
C'est "Jules Ferry en kimono",grimaçaient ses détracteurs, mais les parents applaudissaient, l'opinion le plébiscitait, M.
Fabius lui emboîtait le pas : un triomphe.
En 1988, M.
Chevènement avait accepté le ministère de la défense.
Au printemps 1990, au congrès socialiste de Rennes, ilavait esquissé une alliance avec M.
Jospin contre M.
Fabius, mais s'était heurté à M.
Rocard, son adversaire historique.
Le PSn'était plus, dès lors, à ses yeux, qu'un "parti de gestion sans horizon".
L'amertume se transforme en révolte au moment de la crisedu Golfe.
Une certaine idée de la politique arabe de la France, un respect certain pour le président irakien, Saddam Hussein, enqui il voulait voir un autocrate éclairé, mais aussi le refus absolu de l'alignement sur les Etats-Unis et jusqu'à ses souvenirs de ladébâcle algérienne : tout le pousse, de plus en plus seul et contesté, à résister à la "logique de guerre".
Puis à démissionner quandelle s'impose.
"Il y a un moment où un homme politique doit se mettre en règle avec ses convictions, quoi qu'il lui en coûte", a-t-ilécrit alors à M.
Mitterrand pour lui faire part de sa décision.
La crise du Golfe n'est pas tout.
Au même moment se réunissent les conférences intergouvernementales destinées à mettre enforme le traité européen de Maastricht.
Là aussi, tout hérisse M.
Chevènement.
"On détruisait l'Etat républicain sous prétexte deconstruire l'Europe et, en fait, on livrait sans défense le monde du travail, et le pays avec lui, aux marchés financiersinternationaux." Pour le référendum de septembre 1992, il appellera à voter "non" à un traité dans lequel, de plus en plus gaullien,.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Commentaire Pierre et Jean
- SUEUR DE SANG de Pierre-Jean Jouve (résumé & analyse)
- MÉLODRAME de Pierre-Jean Jouve (résumé)
- HÉRITIERS: LES ÉTUDIANTS ET LA CULTURE (Les) Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron
- PORCHE À LA NUIT DES SAINTS de Pierre-Jean Jouve (résumé & analyse)