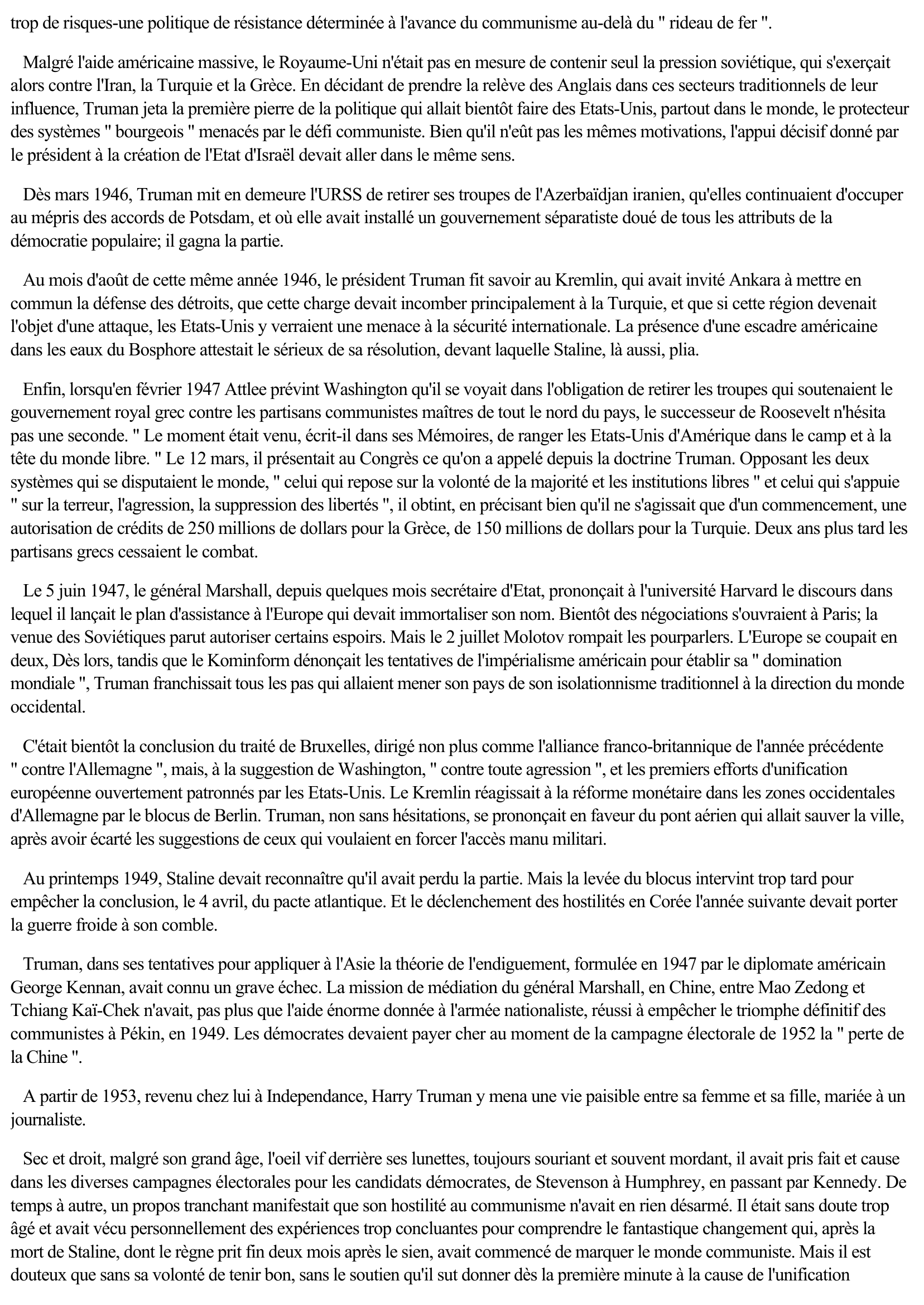Harry Truman, le capitaine de la guerre froide
Publié le 17/01/2022

Extrait du document
«
trop de risques-une politique de résistance déterminée à l'avance du communisme au-delà du " rideau de fer ".
Malgré l'aide américaine massive, le Royaume-Uni n'était pas en mesure de contenir seul la pression soviétique, qui s'exerçaitalors contre l'Iran, la Turquie et la Grèce.
En décidant de prendre la relève des Anglais dans ces secteurs traditionnels de leurinfluence, Truman jeta la première pierre de la politique qui allait bientôt faire des Etats-Unis, partout dans le monde, le protecteurdes systèmes " bourgeois " menacés par le défi communiste.
Bien qu'il n'eût pas les mêmes motivations, l'appui décisif donné parle président à la création de l'Etat d'Israël devait aller dans le même sens.
Dès mars 1946, Truman mit en demeure l'URSS de retirer ses troupes de l'Azerbaïdjan iranien, qu'elles continuaient d'occuperau mépris des accords de Potsdam, et où elle avait installé un gouvernement séparatiste doué de tous les attributs de ladémocratie populaire; il gagna la partie.
Au mois d'août de cette même année 1946, le président Truman fit savoir au Kremlin, qui avait invité Ankara à mettre encommun la défense des détroits, que cette charge devait incomber principalement à la Turquie, et que si cette région devenaitl'objet d'une attaque, les Etats-Unis y verraient une menace à la sécurité internationale.
La présence d'une escadre américainedans les eaux du Bosphore attestait le sérieux de sa résolution, devant laquelle Staline, là aussi, plia.
Enfin, lorsqu'en février 1947 Attlee prévint Washington qu'il se voyait dans l'obligation de retirer les troupes qui soutenaient legouvernement royal grec contre les partisans communistes maîtres de tout le nord du pays, le successeur de Roosevelt n'hésitapas une seconde.
" Le moment était venu, écrit-il dans ses Mémoires, de ranger les Etats-Unis d'Amérique dans le camp et à latête du monde libre.
" Le 12 mars, il présentait au Congrès ce qu'on a appelé depuis la doctrine Truman.
Opposant les deuxsystèmes qui se disputaient le monde, " celui qui repose sur la volonté de la majorité et les institutions libres " et celui qui s'appuie" sur la terreur, l'agression, la suppression des libertés ", il obtint, en précisant bien qu'il ne s'agissait que d'un commencement, uneautorisation de crédits de 250 millions de dollars pour la Grèce, de 150 millions de dollars pour la Turquie.
Deux ans plus tard lespartisans grecs cessaient le combat.
Le 5 juin 1947, le général Marshall, depuis quelques mois secrétaire d'Etat, prononçait à l'université Harvard le discours danslequel il lançait le plan d'assistance à l'Europe qui devait immortaliser son nom.
Bientôt des négociations s'ouvraient à Paris; lavenue des Soviétiques parut autoriser certains espoirs.
Mais le 2 juillet Molotov rompait les pourparlers.
L'Europe se coupait endeux, Dès lors, tandis que le Kominform dénonçait les tentatives de l'impérialisme américain pour établir sa " dominationmondiale ", Truman franchissait tous les pas qui allaient mener son pays de son isolationnisme traditionnel à la direction du mondeoccidental.
C'était bientôt la conclusion du traité de Bruxelles, dirigé non plus comme l'alliance franco-britannique de l'année précédente" contre l'Allemagne ", mais, à la suggestion de Washington, " contre toute agression ", et les premiers efforts d'unificationeuropéenne ouvertement patronnés par les Etats-Unis.
Le Kremlin réagissait à la réforme monétaire dans les zones occidentalesd'Allemagne par le blocus de Berlin.
Truman, non sans hésitations, se prononçait en faveur du pont aérien qui allait sauver la ville,après avoir écarté les suggestions de ceux qui voulaient en forcer l'accès manu militari.
Au printemps 1949, Staline devait reconnaître qu'il avait perdu la partie.
Mais la levée du blocus intervint trop tard pourempêcher la conclusion, le 4 avril, du pacte atlantique.
Et le déclenchement des hostilités en Corée l'année suivante devait porterla guerre froide à son comble.
Truman, dans ses tentatives pour appliquer à l'Asie la théorie de l'endiguement, formulée en 1947 par le diplomate américainGeorge Kennan, avait connu un grave échec.
La mission de médiation du général Marshall, en Chine, entre Mao Zedong etTchiang Kaï-Chek n'avait, pas plus que l'aide énorme donnée à l'armée nationaliste, réussi à empêcher le triomphe définitif descommunistes à Pékin, en 1949.
Les démocrates devaient payer cher au moment de la campagne électorale de 1952 la " perte dela Chine ".
A partir de 1953, revenu chez lui à Independance, Harry Truman y mena une vie paisible entre sa femme et sa fille, mariée à unjournaliste.
Sec et droit, malgré son grand âge, l'oeil vif derrière ses lunettes, toujours souriant et souvent mordant, il avait pris fait et causedans les diverses campagnes électorales pour les candidats démocrates, de Stevenson à Humphrey, en passant par Kennedy.
Detemps à autre, un propos tranchant manifestait que son hostilité au communisme n'avait en rien désarmé.
Il était sans doute tropâgé et avait vécu personnellement des expériences trop concluantes pour comprendre le fantastique changement qui, après lamort de Staline, dont le règne prit fin deux mois après le sien, avait commencé de marquer le monde communiste.
Mais il estdouteux que sans sa volonté de tenir bon, sans le soutien qu'il sut donner dès la première minute à la cause de l'unification.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Truman craint que Mac Arthur ne lui désobéisse La guerre de Corée opposera violemment Harry Truman et Douglas Mac Arthur (1880-1964).
- La guerre froide résumé
- Guerre Froide et Décolonisation : Quels liens ?
- La frontière coréenne n'est-elle qu'un héritage de la Guerre Froide ?
- La guerre froide