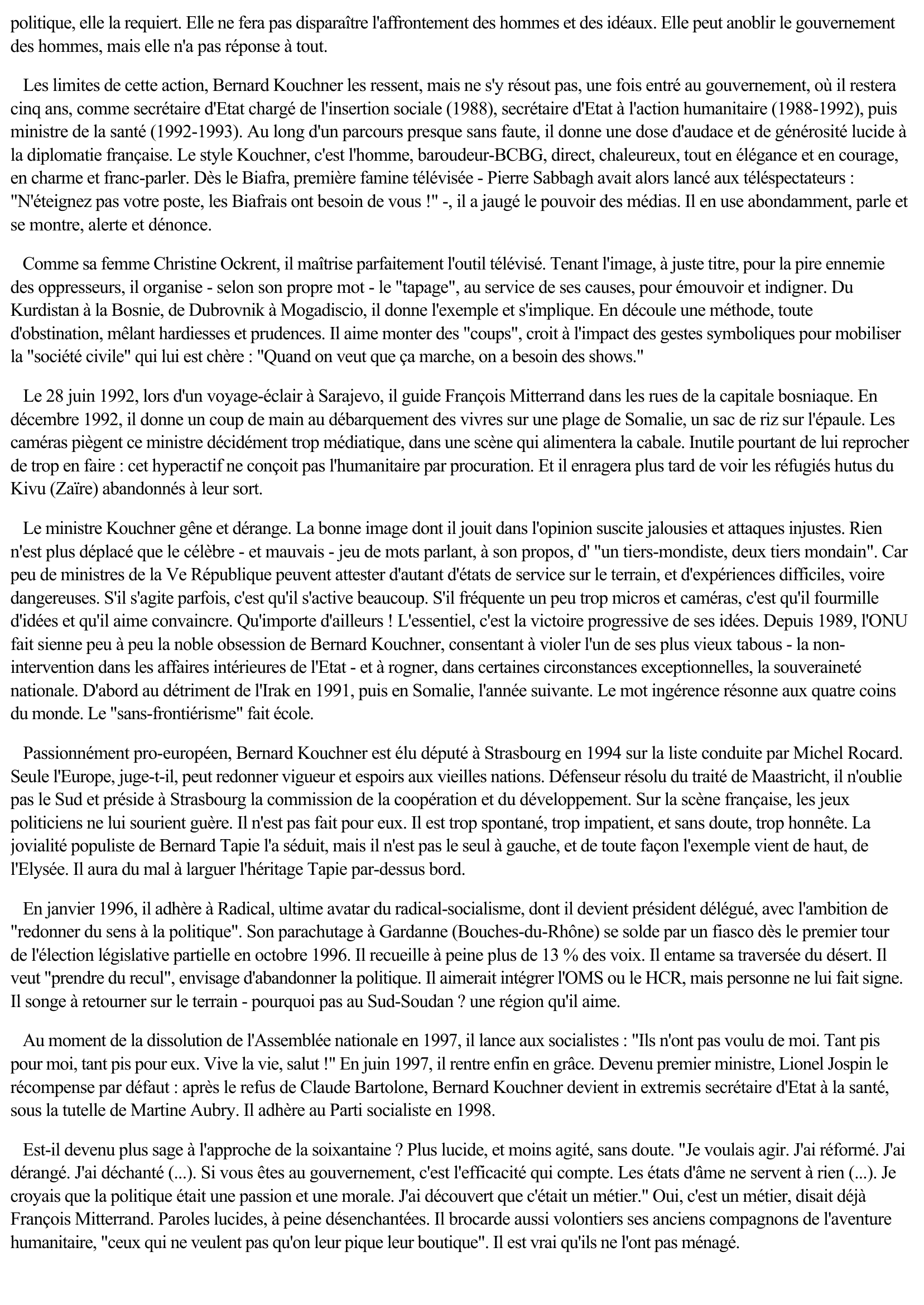Bernard Kouchner, du Biafra au Kosovo
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
«
politique, elle la requiert.
Elle ne fera pas disparaître l'affrontement des hommes et des idéaux.
Elle peut anoblir le gouvernementdes hommes, mais elle n'a pas réponse à tout.
Les limites de cette action, Bernard Kouchner les ressent, mais ne s'y résout pas, une fois entré au gouvernement, où il resteracinq ans, comme secrétaire d'Etat chargé de l'insertion sociale (1988), secrétaire d'Etat à l'action humanitaire (1988-1992), puisministre de la santé (1992-1993).
Au long d'un parcours presque sans faute, il donne une dose d'audace et de générosité lucide àla diplomatie française.
Le style Kouchner, c'est l'homme, baroudeur-BCBG, direct, chaleureux, tout en élégance et en courage,en charme et franc-parler.
Dès le Biafra, première famine télévisée - Pierre Sabbagh avait alors lancé aux téléspectateurs :"N'éteignez pas votre poste, les Biafrais ont besoin de vous !" -, il a jaugé le pouvoir des médias.
Il en use abondamment, parle etse montre, alerte et dénonce.
Comme sa femme Christine Ockrent, il maîtrise parfaitement l'outil télévisé.
Tenant l'image, à juste titre, pour la pire ennemiedes oppresseurs, il organise - selon son propre mot - le "tapage", au service de ses causes, pour émouvoir et indigner.
DuKurdistan à la Bosnie, de Dubrovnik à Mogadiscio, il donne l'exemple et s'implique.
En découle une méthode, touted'obstination, mêlant hardiesses et prudences.
Il aime monter des "coups", croit à l'impact des gestes symboliques pour mobiliserla "société civile" qui lui est chère : "Quand on veut que ça marche, on a besoin des shows."
Le 28 juin 1992, lors d'un voyage-éclair à Sarajevo, il guide François Mitterrand dans les rues de la capitale bosniaque.
Endécembre 1992, il donne un coup de main au débarquement des vivres sur une plage de Somalie, un sac de riz sur l'épaule.
Lescaméras piègent ce ministre décidément trop médiatique, dans une scène qui alimentera la cabale.
Inutile pourtant de lui reprocherde trop en faire : cet hyperactif ne conçoit pas l'humanitaire par procuration.
Et il enragera plus tard de voir les réfugiés hutus duKivu (Zaïre) abandonnés à leur sort.
Le ministre Kouchner gêne et dérange.
La bonne image dont il jouit dans l'opinion suscite jalousies et attaques injustes.
Rienn'est plus déplacé que le célèbre - et mauvais - jeu de mots parlant, à son propos, d' "un tiers-mondiste, deux tiers mondain".
Carpeu de ministres de la Ve République peuvent attester d'autant d'états de service sur le terrain, et d'expériences difficiles, voiredangereuses.
S'il s'agite parfois, c'est qu'il s'active beaucoup.
S'il fréquente un peu trop micros et caméras, c'est qu'il fourmilled'idées et qu'il aime convaincre.
Qu'importe d'ailleurs ! L'essentiel, c'est la victoire progressive de ses idées.
Depuis 1989, l'ONUfait sienne peu à peu la noble obsession de Bernard Kouchner, consentant à violer l'un de ses plus vieux tabous - la non-intervention dans les affaires intérieures de l'Etat - et à rogner, dans certaines circonstances exceptionnelles, la souveraineténationale.
D'abord au détriment de l'Irak en 1991, puis en Somalie, l'année suivante.
Le mot ingérence résonne aux quatre coinsdu monde.
Le "sans-frontiérisme" fait école.
Passionnément pro-européen, Bernard Kouchner est élu député à Strasbourg en 1994 sur la liste conduite par Michel Rocard.Seule l'Europe, juge-t-il, peut redonner vigueur et espoirs aux vieilles nations.
Défenseur résolu du traité de Maastricht, il n'oubliepas le Sud et préside à Strasbourg la commission de la coopération et du développement.
Sur la scène française, les jeuxpoliticiens ne lui sourient guère.
Il n'est pas fait pour eux.
Il est trop spontané, trop impatient, et sans doute, trop honnête.
Lajovialité populiste de Bernard Tapie l'a séduit, mais il n'est pas le seul à gauche, et de toute façon l'exemple vient de haut, del'Elysée.
Il aura du mal à larguer l'héritage Tapie par-dessus bord.
En janvier 1996, il adhère à Radical, ultime avatar du radical-socialisme, dont il devient président délégué, avec l'ambition de"redonner du sens à la politique".
Son parachutage à Gardanne (Bouches-du-Rhône) se solde par un fiasco dès le premier tourde l'élection législative partielle en octobre 1996.
Il recueille à peine plus de 13 % des voix.
Il entame sa traversée du désert.
Ilveut "prendre du recul", envisage d'abandonner la politique.
Il aimerait intégrer l'OMS ou le HCR, mais personne ne lui fait signe.Il songe à retourner sur le terrain - pourquoi pas au Sud-Soudan ? une région qu'il aime.
Au moment de la dissolution de l'Assemblée nationale en 1997, il lance aux socialistes : "Ils n'ont pas voulu de moi.
Tant pispour moi, tant pis pour eux.
Vive la vie, salut !" En juin 1997, il rentre enfin en grâce.
Devenu premier ministre, Lionel Jospin lerécompense par défaut : après le refus de Claude Bartolone, Bernard Kouchner devient in extremis secrétaire d'Etat à la santé,sous la tutelle de Martine Aubry.
Il adhère au Parti socialiste en 1998.
Est-il devenu plus sage à l'approche de la soixantaine ? Plus lucide, et moins agité, sans doute.
"Je voulais agir.
J'ai réformé.
J'aidérangé.
J'ai déchanté (...).
Si vous êtes au gouvernement, c'est l'efficacité qui compte.
Les états d'âme ne servent à rien (...).
Jecroyais que la politique était une passion et une morale.
J'ai découvert que c'était un métier." Oui, c'est un métier, disait déjàFrançois Mitterrand.
Paroles lucides, à peine désenchantées.
Il brocarde aussi volontiers ses anciens compagnons de l'aventurehumanitaire, "ceux qui ne veulent pas qu'on leur pique leur boutique".
Il est vrai qu'ils ne l'ont pas ménagé..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Kouchner, Bernard : L'avenir est mondial (Podcast)
- Bernard Lahire Commentaire
- Claude Bernard : Introduction à l'étude de la médecine expérimentale (fiche de lecture)
- Bernard, Les Faux Monnayeurs
- PREMIERS MOTS (Les) de Bernard Noël