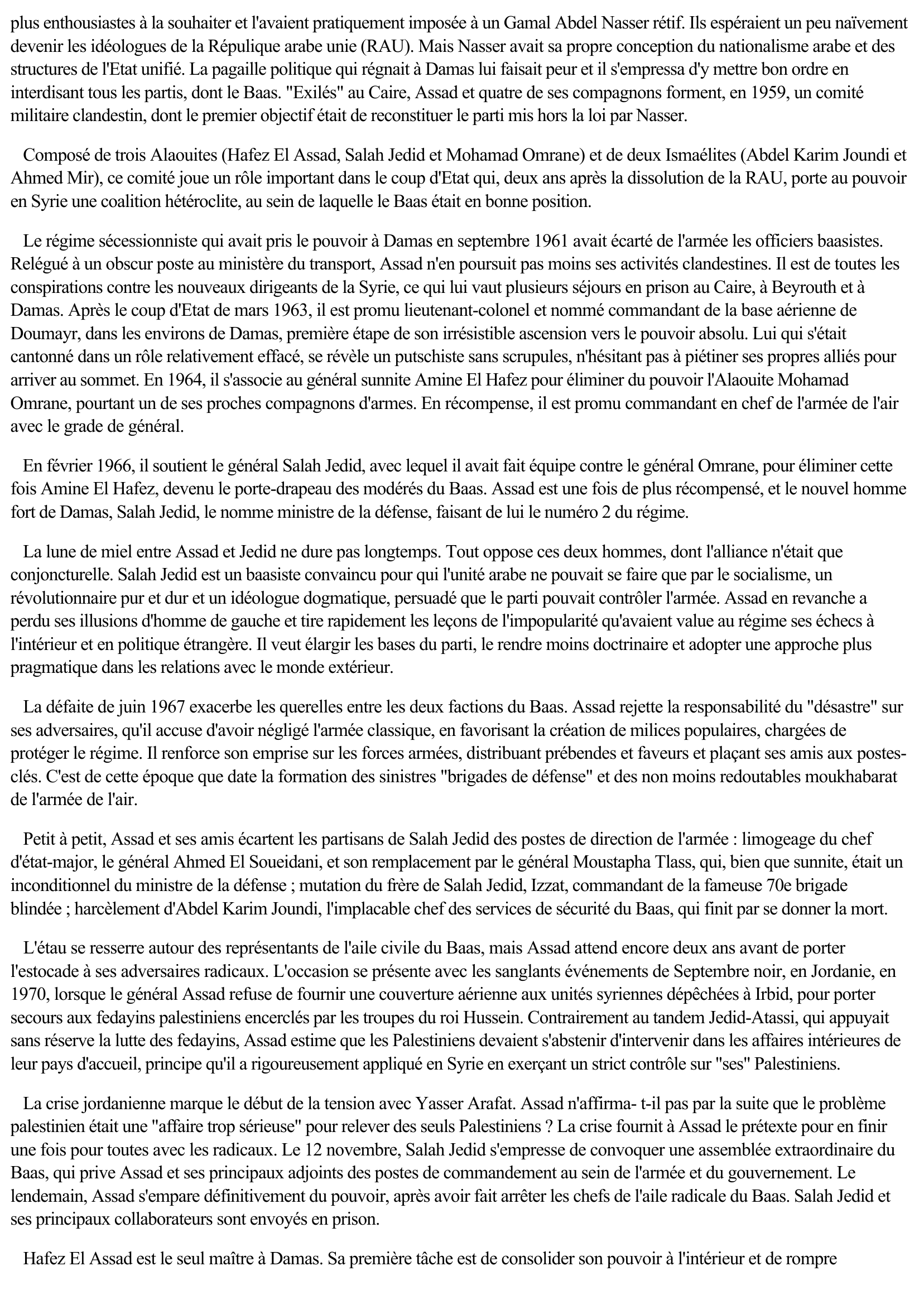10 juin 2000
Silhouette légèrement courbée par les ans, visage oblong surplombé d'un large front, menton autoritaire, traits tirés et teint blafard, Hafez El Assad semblait avoir vieilli avant l'âge. "Bismarck des Arabes" ou "successeur des Ommeyades" pour ses admirateurs, "despote sanguinaire" pour ses détracteurs, l'homme qui a régné sans partage en Syrie pendant trente ans est demeuré une énigme. Modeste et réservé par nature, il fuyait les contacts avec le peuple et gouvernait à partir de son bureau situé dans un quartier résidentiel du centre de Damas. Hors la grande politique, rien ne le passionnait. A l'inverse de certains de ses proches, il n'a jamais songé à s'enrichir. Son mode de vie austère ne l'a pas empêché d'encourager un culte de la personnalité, qui le hissait au-dessus de l'ensemble de l'appareil politique syrien.
Devenu au fil des ans le pilier central du régime, Hafez El Assad, en disparaissant, a laissé dans son pays un vide politique difficile à remplir. S'il a incontestablement réussi à créer un Etat fortement centralisé et stable, dans un pays jadis voué aux coups d'Etat, et à en faire une puissance régionale incontournable au Proche-Orient, le président syrien n'a pas su ou voulu ouvrir son pays, notamment dans le domaine économique, le laissant à la traîne d'un monde en constante évolution. Le président syrien s'est surtout révélé être un stratège incomparable, doublé d'un redoutable négociateur et d'un maître dans l'art de la manoeuvre.
Convaincu d'avoir toujours raison contre les autres, il n'a jamais désespéré de réaliser ses objectifs, dont le principal a été d'effacer la honte de la défaite subie par les Arabes en 1967, lors de la guerre dite de six jours. L'un des soucis permanents de son règne a été la création d'une force militaire suffisamment puissante, l'objectif étant de négocier la récupération des hauteurs du Golan, dont la perte, en 1967, n'a jamais cessé de le hanter. La guerre d'octobre 1973, qu'il a menée conjointement avec Anouar El Sadate, lui a certes permis de récupérer une partie du plateau, mais cette souveraineté tronquée était, à ses yeux, bien en deçà des conditions d'une vraie paix avec l'Etat hébreu, paix dont il entendait être l'emblème.
Alors que, dans la foulée de la guerre, Anouar El Sadate s'engageait dans un processus qui a abouti, en 1979, à un traité de paix séparé avec Israël, Assad décidait de poursuivre le combat, estimant que la paix avec l'Etat juif devait être fondée sur le retrait total des Israéliens des territoires occupés en 1967 et l'entière satisfaction des droits du peuple palestinien. C'est pour cela qu'il demeura indifférent à la politique des "petits pas" de l'ancien secrétaire d'Etat américain Henry Kissinger et qu'il réussit à empêcher le Liban et la Jordanie de suivre l'exemple de l'Egypte. A l'intérieur de la Syrie, les acquis demeurent fragiles, car ils ont surtout été l'oeuvre d'un seul homme, un dictateur, qui n'a jamais hésité à recourir aux moyens les plus répressifs, y compris la terreur, pour asseoir son pouvoir. Secondé par une multitude de services secrets confiés à ses proches parents et amis, pour la plupart alaouites comme lui, il a étouffé dans l'oeuf toute velléité d'opposition. L'appareil de répression tentaculaire qu'il a créé pour protéger son pouvoir n'est cependant pas sans faille.
En novembre 1983, lorsqu'une crise cardiaque l'a tenu éloigné de la direction de l'Etat pendant trois semaines, une véritable petite guerre de succession, qui a failli emporter le régime, a opposé ceux qui, à l'intérieur de la nomenklatura, étaient précisément chargés d'assurer la pérennité de l'Etat. C'est lui, une fois rétabli, qui a mis tout le monde d'accord, en écartant ceux qui convoitaient sa succession, à commencer par son frère, Rifaat, le redoutable et sanglant chef des "brigades de défense". Il préparait son fils Bassel à lui succéder, mais celui-ci s'est tué dans un accident de la route le 21 janvier 1994 à Damas.
Né le 6 octobre 1930 à Kardaha, une petite bourgade située au coeur du pays alaouite, Hafez El Assad s'efforce, dès son accession au pouvoir, de se débarrasser de son complexe minoritaire, en s'entourant d'un grand nombre de personnalités sunnites. Membres d'une secte d'origine chiite, généralement considérée par les musulmans sunnites comme hétérodoxe, les Alaouites représentent 12 % de la population. Méprisés et persécutés dans le passé par la majorité sunnite de leurs compatriotes, ces mal-aimés de la Syrie éprouvaient un certain ressentiment, voire une sourde hostilité, à l'égard du pouvoir central. C'est donc dans ce climat conflictuel, fait de rancoeurs et de récriminations, que grandit le jeune Hafez.
I SSU d'une famille de paysans relativement aisée, il poursuit ses études secondaires à Lattakié où, à l'âge de seize ans, il adhère au Baas, parti socialiste de "la renaissance" arabe, fondé en 1940 par le chrétien Michel Aflak et le musulman Salah Bitar. Il partage alors son temps entre ses études et ses activités politiques clandestines. Comme la plupart des jeunes alaouites désireux de transcender leur statut de minoritaire, il choisit en 1952 la carrière militaire, dédaignée par la bourgeoisie sunnite et qui constitue l'unique moyen de se trouver une place parmi les élites du pays. Pour le jeune Assad, l'armée est également le tremplin idéal en vue d'une conquête éventuelle du pouvoir. Son passage à l'académie militaire de Homs, où il entre en 1952, lui permet de nouer des liens étroits avec d'autres cadets alaouites, qui allaient être ses futurs compagnons de combat. Après avoir décroché, en 1955, son brevet de pilote de guerre, il effectue, en 1958, plusieurs stages de formation en URSS. Ce fut son premier contact avec la grande puissance qui devait devenir son principal allié.
La création de l'éphémère union syro-égyptienne (1958-1961) déçut les jeunes officiers baasistes, qui avaient été pourtant les plus enthousiastes à la souhaiter et l'avaient pratiquement imposée à un Gamal Abdel Nasser rétif. Ils espéraient un peu naïvement devenir les idéologues de la Répulique arabe unie (RAU). Mais Nasser avait sa propre conception du nationalisme arabe et des structures de l'Etat unifié. La pagaille politique qui régnait à Damas lui faisait peur et il s'empressa d'y mettre bon ordre en interdisant tous les partis, dont le Baas. "Exilés" au Caire, Assad et quatre de ses compagnons forment, en 1959, un comité militaire clandestin, dont le premier objectif était de reconstituer le parti mis hors la loi par Nasser.
Composé de trois Alaouites (Hafez El Assad, Salah Jedid et Mohamad Omrane) et de deux Ismaélites (Abdel Karim Joundi et Ahmed Mir), ce comité joue un rôle important dans le coup d'Etat qui, deux ans après la dissolution de la RAU, porte au pouvoir en Syrie une coalition hétéroclite, au sein de laquelle le Baas était en bonne position.
Le régime sécessionniste qui avait pris le pouvoir à Damas en septembre 1961 avait écarté de l'armée les officiers baasistes. Relégué à un obscur poste au ministère du transport, Assad n'en poursuit pas moins ses activités clandestines. Il est de toutes les conspirations contre les nouveaux dirigeants de la Syrie, ce qui lui vaut plusieurs séjours en prison au Caire, à Beyrouth et à Damas. Après le coup d'Etat de mars 1963, il est promu lieutenant-colonel et nommé commandant de la base aérienne de Doumayr, dans les environs de Damas, première étape de son irrésistible ascension vers le pouvoir absolu. Lui qui s'était cantonné dans un rôle relativement effacé, se révèle un putschiste sans scrupules, n'hésitant pas à piétiner ses propres alliés pour arriver au sommet. En 1964, il s'associe au général sunnite Amine El Hafez pour éliminer du pouvoir l'Alaouite Mohamad Omrane, pourtant un de ses proches compagnons d'armes. En récompense, il est promu commandant en chef de l'armée de l'air avec le grade de général.
En février 1966, il soutient le général Salah Jedid, avec lequel il avait fait équipe contre le général Omrane, pour éliminer cette fois Amine El Hafez, devenu le porte-drapeau des modérés du Baas. Assad est une fois de plus récompensé, et le nouvel homme fort de Damas, Salah Jedid, le nomme ministre de la défense, faisant de lui le numéro 2 du régime.
La lune de miel entre Assad et Jedid ne dure pas longtemps. Tout oppose ces deux hommes, dont l'alliance n'était que conjoncturelle. Salah Jedid est un baasiste convaincu pour qui l'unité arabe ne pouvait se faire que par le socialisme, un révolutionnaire pur et dur et un idéologue dogmatique, persuadé que le parti pouvait contrôler l'armée. Assad en revanche a perdu ses illusions d'homme de gauche et tire rapidement les leçons de l'impopularité qu'avaient value au régime ses échecs à l'intérieur et en politique étrangère. Il veut élargir les bases du parti, le rendre moins doctrinaire et adopter une approche plus pragmatique dans les relations avec le monde extérieur.
La défaite de juin 1967 exacerbe les querelles entre les deux factions du Baas. Assad rejette la responsabilité du "désastre" sur ses adversaires, qu'il accuse d'avoir négligé l'armée classique, en favorisant la création de milices populaires, chargées de protéger le régime. Il renforce son emprise sur les forces armées, distribuant prébendes et faveurs et plaçant ses amis aux postes-clés. C'est de cette époque que date la formation des sinistres "brigades de défense" et des non moins redoutables moukhabarat de l'armée de l'air.
Petit à petit, Assad et ses amis écartent les partisans de Salah Jedid des postes de direction de l'armée : limogeage du chef d'état-major, le général Ahmed El Soueidani, et son remplacement par le général Moustapha Tlass, qui, bien que sunnite, était un inconditionnel du ministre de la défense ; mutation du frère de Salah Jedid, Izzat, commandant de la fameuse 70e brigade blindée ; harcèlement d'Abdel Karim Joundi, l'implacable chef des services de sécurité du Baas, qui finit par se donner la mort.
L'étau se resserre autour des représentants de l'aile civile du Baas, mais Assad attend encore deux ans avant de porter l'estocade à ses adversaires radicaux. L'occasion se présente avec les sanglants événements de Septembre noir, en Jordanie, en 1970, lorsque le général Assad refuse de fournir une couverture aérienne aux unités syriennes dépêchées à Irbid, pour porter secours aux fedayins palestiniens encerclés par les troupes du roi Hussein. Contrairement au tandem Jedid-Atassi, qui appuyait sans réserve la lutte des fedayins, Assad estime que les Palestiniens devaient s'abstenir d'intervenir dans les affaires intérieures de leur pays d'accueil, principe qu'il a rigoureusement appliqué en Syrie en exerçant un strict contrôle sur "ses" Palestiniens.
La crise jordanienne marque le début de la tension avec Yasser Arafat. Assad n'affirma- t-il pas par la suite que le problème palestinien était une "affaire trop sérieuse" pour relever des seuls Palestiniens ? La crise fournit à Assad le prétexte pour en finir une fois pour toutes avec les radicaux. Le 12 novembre, Salah Jedid s'empresse de convoquer une assemblée extraordinaire du Baas, qui prive Assad et ses principaux adjoints des postes de commandement au sein de l'armée et du gouvernement. Le lendemain, Assad s'empare définitivement du pouvoir, après avoir fait arrêter les chefs de l'aile radicale du Baas. Salah Jedid et ses principaux collaborateurs sont envoyés en prison.
Hafez El Assad est le seul maître à Damas. Sa première tâche est de consolider son pouvoir à l'intérieur et de rompre l'isolement de la Syrie sur le plan international, en normalisant ses relations avec l'Egypte et l'Arabie saoudite. Il lance son "mouvement de rectification", tentative de démocratisation d'un régime honni par la population. Il met sur pied de véritables structures étatiques et, après avoir désigné, en février 1971, une Assemblée constituante triée sur le volet, il se fait plébisciter le 12 mars à la présidence de la République, avec 99,2 % des voix, formalité qu'il a renouvelée tous les sept ans.
D ANS le même temps, il devient secrétaire général d'un parti qui lui est désormais totalement acquis. Dans le souci d'élargir les assises de son régime, il constitue un Front national progressiste regroupant des groupuscules politiques allant des communistes aux nassériens. Mais ce n'est qu'un semblant de multipartisme, qui ne fait que souligner le caractère hégémonique d'un pouvoir essentiellement fondé sur la terreur. Il tente, enfin, d'atténuer la composition alaouite de l'équipe au pouvoir, en nommant à des postes importants au sein du gouvernement, du parti et de l'armée des personnalités sunnites qui lui sont loyales. Mais les postes-clés au sein des services de sécurité et de l'armée restent aux mains des Alaouites.
Pour désarmer l'hostilité des milieux religieux sunnites, il prend la précaution de se faire confirmer par le mufti sunnite de Damas comme un "musulman authentique". Mais, à partir de 1976, c'est-à-dire au moment où la Syrie s'engagea au Liban, le caractère alaouite du régime fut monté en épingle par les Frères musulmans, pour discréditer le pouvoir. Assad est accusé d'avoir volé au secours des maronites libanais parce qu'il appartenait lui-même à une communauté minoritaire. En dirigeant, dès le début de 1977, l'essentiel de leurs attaques terroristes contre les cadres supérieurs de l'Etat, de confession alaouite, les Frères musulmans réussissent à cristalliser le sentiment anti- alaouite qui existait déjà à l'état latent chez la plupart des sunnites. Pourtant, ce n'est que deux ans plus tard, vers le milieu de 1979, c'est-à-dire après le massacre des cadets alaouites de l'Académie militaire d'Alep, que les dirigeants baasistes commencent à prendre la mesure de la gravité de la menace pour le régime du mouvement intégriste. La dérive du "mouvement de rectification", gangrené par la corruption, le népotisme et l'absence de libertés démocratiques, favorise la fronde des religieux et alimente le cycle terrorisme-répression. Assad noie dans le sang, en février 1982, le soulèvement populaire de Hama. Une bataille rangée oppose pendant près de trois semaines les rebelles musulmans, qui avaient donné le signal de l'insurrection en massacrant les cadres du Baas et les fonctionnaires du gouvernement, à l'armée et aux forces de sécurité alaouites. Des quartiers entiers de la ville sont rasés par l'artillerie et près du tiers de cette cité historique est détruit. Le nombre des victimes varie entre 5 000 et 20 000 selon les sources.
Ce carnage suscite relativement peu de réactions internationales, vraisemblablement parce qu'il est éclipsé par les événements du Liban. Pour la première fois depuis le début de l'intervention syrienne, Assad commence à perdre le contrôle de la situation. Les Syriens étaient entrés au Liban à la demande de la Ligue arabe pour pacifier le pays. Six ans plus tard, rien n'est réglé et les troupes d'Assad participent à Beyrouth aux pilonnages d'artillerie entre les secteurs musulman et chrétien de la capitale. Assad aspirait au rôle d'arbitre, il n'avait réussi qu'à exacerber le conflit.
En juin 1982, le président syrien assiste en spectateur humilié à l'invasion israélienne du Liban. Le réseau syrien de missiles SAM, installé dans la vallée de la Békaa, est détruit par l'aviation israélienne, et les unités syriennes qui défendaient la route stratégique Beyrouth-Damas se replient en Syrie, tandis que se poursuit le siège de Beyrouth-ouest, où étaient encerclés Yasser Arafat et les siens. Plus grave pour Assad, malgré l'assassinat de Béchir Gemayel, dont il n'avait pu empêcher l'élection à la présidence de la République, un gouvernement pro-israélien est installé à Beyrouth et conclut, le 17 mai 1983, un traité de paix avec Israël.
Ce traité, qui prévoyait le retrait des forces syriennes du Liban et l'établissement de zones de sécurité dans le sud du pays, est un véritable camouflet pour Assad, qui n'hésite pas à recourir à tous les moyens pour le mettre en échec. La résistance nationale libanaise à l'occupation finit par avoir raison de l'accord, dont le nouveau président libanais, Amine Gemayel dut annoncer l'annulation lors d'une visite à Damas en mars 1984. La pax syriana règne de nouveau à Beyrouth. Le redressement quasi miraculeux de l'influence syrienne confirme le rôle privilégié de Damas, redevenue, après le retrait des troupes israéliennes du Liban, à l'exception d'une bande frontalière au sud, l'étape indispensable dans la recherche d'un règlement au Proche-Orient et l'inévitable interlocuteur de Washington.
On a souvent présenté les Etats-Unis et le président Assad comme des adversaires irréductibles, alors que leur hostilité n'a jamais été que conjoncturelle. Après l'éviction du groupe Jedid-Atassi, le principal souci d'Assad a été d'établir des relations équilibrées avec l'URSS et les Etats-Unis. Il refusa de suivre l'exemple de l'Egypte, qui avait expulsé les experts soviétiques en juillet 1972, car il estimait que la présence militaire russe en Syrie était une carte dans les tractations avec Washington, avec lequel il rétablit les relations diplomatiques, après la guerre d'octobre 1973, avant une visite du président Richard Nixon à Damas.
Washington, de son côté, admit peu ou prou le rôle de Damas au Liban, surtout lorsque, en mars 1976, Assad n'hésita pas à intervenir militairement contre la gauche libanaise et la résistance palestinienne. Le 9 mai 1977, cependant, les sept heures d' "entretiens cordiaux" qu'Assad eut avec le président Jimmy Carter à Genève ne lui permirent pas d'arracher à ce dernier une promesse d'évacuation totale du Golan.
La même année, la visite de Sadate à Jérusalem, qui conduisit à la conclusion, deux ans plus tard, d'un traité de paix avec Israël, relance les hostilités entre Damas et Le Caire. Les relations entre la Syrie et les Etats-Unis se dégradent à nouveau et, après une tentative de sabotage d'un avion d'El Al à l'aéroport de Londres en 1986, imputée à Damas, Washington impose des sanctions diplomatiques à Damas. Doué d'une extraordinaire faculté de changer de cap lorsqu'il s'estime en danger, Assad prend l'avertissement au sérieux. En 1987, il ferme les bureaux du terroriste palestinien Abou Nidal en Syrie et met discrètement à l'écart le général Mohamad El Kholi, chef des services de renseignement de l'armée de l'air, impliqué dans l'affaire d'El Al. Les sanctions diplomatiques contre Damas sont partiellement levées. Assad s'engage devant la presse américaine, en septembre 1987, à faire tout son possible pour obtenir la libération des otages au Liban.
A l'origine de ce changement de ton à l'égard des Etats-Unis : la détérioration constante de la situation économique en Syrie et les changements intervenus en Union soviétique, depuis l'arrivée au pouvoir de Mikhaïl Gorbatchev, en 1985. Moscou réduisit son appui militaire à Damas, qui n'était plus dès lors en mesure de réaliser la "parité stratégique" avec Israël. Avec son pragmatisme habituel, le président syrien fit tout son possible pour se rapprocher des Etats-Unis. L'invasion du Koweït par l'Irak en août 1990 lui en fournit l'occasion.
En participant à la coalition multinationale mise sur pied par Washington, il se fait une nouvelle respectabilité internationale, se voit gratifier de la reprise de l'aide financière des pays arabes du Golfe, et, surtout, obtient un feu vert au Liban, où ses troupes délogent le général Michel Aoun, pour installer à sa place un régime pro-syrien. Le président Assad peut savourer enfin son triomphe en signant, le 22 mai 1991, un traité de fraternité, de coopération et de coordination avec le Liban, légalisant en quelque sorte l'hégémonie de la Syrie dans ce pays.
En s'associant à la coalition anti-irakienne, Assad espère régler une fois pour toutes en sa faveur l'interminable conflit qui l'oppose depuis près de vingt ans à ses frères ennemis baasistes de Bagdad. C'était déjà son objectif lorsque, en septembre 1980, il n'avait pas hésité à se mettre à dos la majorité des pays arabes en fournissant à l'Iran, en guerre contre l'Irak, une aide militaire et diplomatique. En juillet 1991, il accepte de participer à la conférence de paix sur le Proche-Orient, programmée pour la fin octobre à Madrid, et consent, pour la première fois, à négocier directement avec Israël. Après de longs mois d'une négociation bilatérale quasi stérile, Assad fait un nouveau pas, lors d'une rencontre au sommet, le 16 janvier 1993 à Genève, avec le nouveau président américain Bill Clinton. Pour la première fois, il évoque publiquement des relations "ordinaires" entre tous les Etats de la région en cas de paix, laquelle, assure-t-il, est un objectif "stratégique" de la Syrie.
Assad reste néanmoins intraitable sur un principe : la solidarité de tous les Arabes - Syriens, Libanais, Jordaniens et Palestiniens - engagés dans la négociation avec l'Etat hébreu. Pour lui, l'union était la seule et unique manière de contraindre Israël à remplir ses obligations. Aussi, lorsque Israéliens et Palestiniens annoncent, début septembre 1993, être parvenus, à Oslo, à un premier accord intérimaire, la fameuse déclaration de principes qui allait être signée le 13 septembre 1993 sur la pelouse de la Maison Blanche, le président syrien en conçoit-il un solide ressentiment.
POUR lui, Yasser Arafat, qu'il tenait dans une grande défiance pour des raisons politiques et en raison d'une nette incompatibilité de caractères, avait "trahi", s'était laissé dicter par Israël les conditions d'un règlement indigne et avait planté un poignard dans le dos de la Syrie. Et lorsque, un peu plus d'un an plus tard, le roi Hussein de Jordanie - avec lequel Hafez El Assad n'avait pas non plus d'affinités particulières - conclut à son tour un traité de paix avec l'Etat hébreu, Assad se retrouve le dos au mur. Le "front" arabe est affaibli. Assad ne peut plus compter que sur le Liban.
Le huis clos que les Etats-Unis, galvanisés par le succès des pourparlers de Dayton sur la Bosnie, organisent à Wye River, près de Washington, en 1995 et 1996, entre Israéliens et Syriens, ne permet pas de débloquer la situation. Suspendus en avril 1996, parce que Israël entrait en période électorale, les pourparlers sont totalement interrompus après l'accession de Benyamin Nétanyahou à la présidence du conseil en juin 1996. Assad est persuadé que ce dernier ne veut pas la paix et exige de reprendre la discussion là où elle s'était arrêtée avant le meurtre d'Itzhak Rabin, lequel, assurait-il, s'était engagé à évacuer la totalité du Golan. Il n'obtient pas satisfaction.
Autre sujet d'inquiétude pour Assad : le rapprochement spectaculaire entre Israël et la Turquie, couronné par un accord de coopération militaire que le président syrien perçoit comme étant dirigé contre son pays, d'autant que le conflit entre Damas et Ankara était allé s'aggravant, tant à propos du partage des eaux de l'Euphrate qu'en ce qui concerne le soutien accordé par la Syrie aux rebelles du Parti des travailleurs du Kurdistan de Turquie, le PKK. Persuadé qu'avec la bénédiction des Etats-Unis, Israël et la Turquie veulent le faire plier, il met un bémol, savamment dosé, à son inimitié historique avec l'Irak et, proclamant son souci de contribuer à réduire les effets dévastateurs de l'embargo imposé au peuple irakien, consent à rouvrir la frontière entre les deux pays. En octobre 1998, Assad finit par céder sur le PKK : Damas et Ankara signent, le 21 octobre, l'accord dit d'Adana (du nom de la ville turque où il a été paraphé), en vertu duquel la Syrie s'engage à cesser son soutien au PKK.
L'élection surprise d'Ehoud Barak à la présidence du conseil en Israël, au terme d'élection anticipées, en mai 1999, est une bonne surprise pour le président syrien. Il ne se prive pas de le dire publiquement, en louant les qualités du nouveau premier ministre israélien, qui le lui rendit bien. Les échanges d'aménités cessent rapidement. Les négociations bilatérales de paix reprennent en décembre 1999. Assad les prend au sérieux puisque, pour la première fois, il charge son ministre des affaires étrangères, Farouk El Chareh, l'un de ses hommes de confiance, d'aller rencontrer M. Barak. Mais après un apparent bon démarrage, la négociation tourne court, en raison, principalement, et une fois encore, d'un désaccord sur la délimitation des territoires que l'Etat hébreu était prêt à évacuer.
Le projet israélien de retrait total du Liban-sud, même en l'absence d'un accord avec Damas et Beyrouth, inquiétait Assad, parce qu'il risquait de priver son pays d'un atout important dans son face-à-face avec l'Etat hébreu. Maintes fois, Damas mit en garde la communauté internationale contre les "manoeuvres" d'Israël et la "malveillance" de ses arrière-pensées. Assad finit par s'y résigner mais, dans la mesure où il n'était pas homme à jeter l'éponge, chacun, en Israël et en Occident, s'interrogeait sur les intentions syriennes une fois le retrait de Tsahal achevé.
La question reste posée.
JEAN GUEYRAS ET MOUNA NAIM
Le Monde du 13 juin 2000