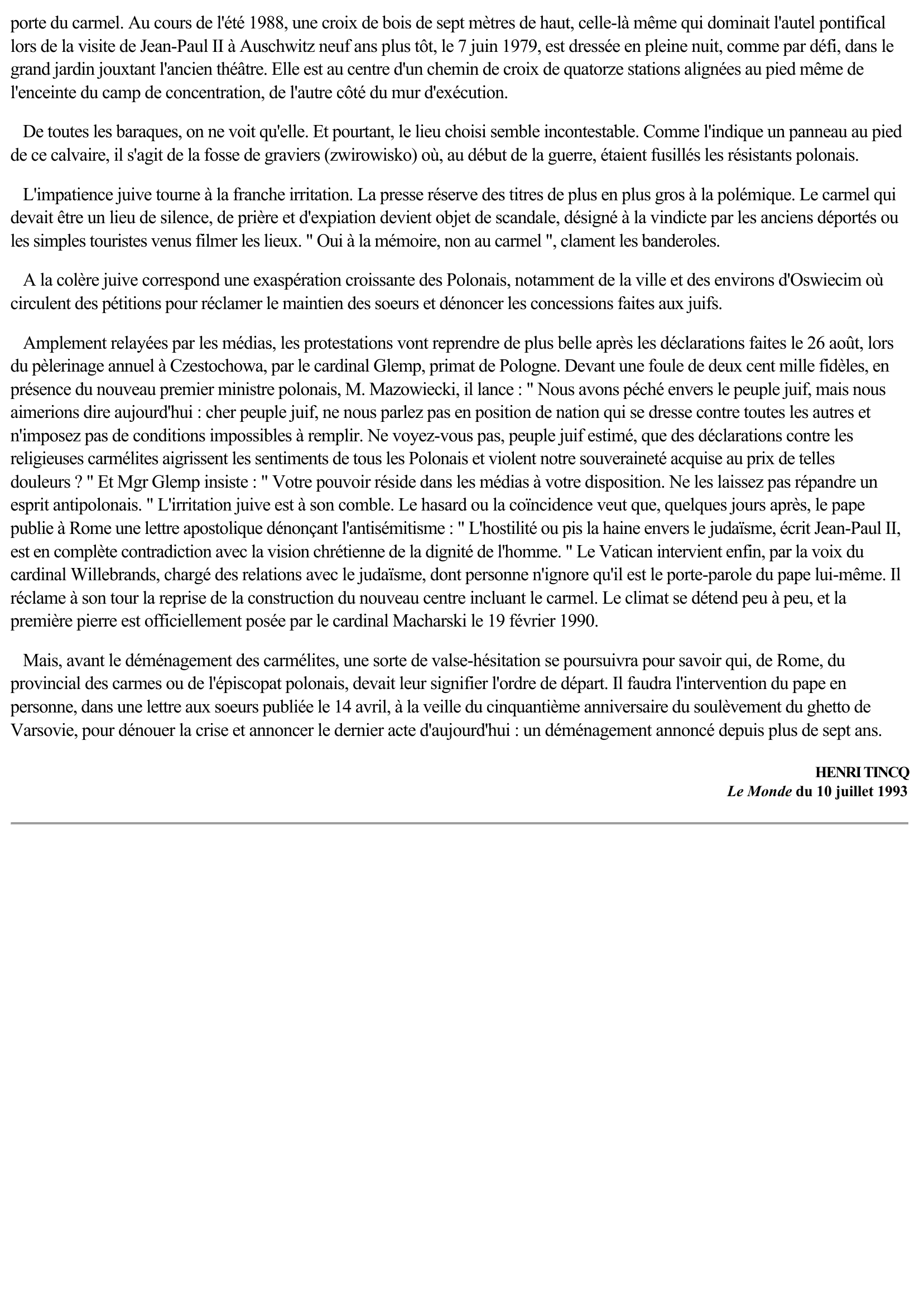Article de presse: L'affaire du carmel d'Auschwitz
Publié le 17/01/2022

Extrait du document
«
porte du carmel.
Au cours de l'été 1988, une croix de bois de sept mètres de haut, celle-là même qui dominait l'autel pontificallors de la visite de Jean-Paul II à Auschwitz neuf ans plus tôt, le 7 juin 1979, est dressée en pleine nuit, comme par défi, dans legrand jardin jouxtant l'ancien théâtre.
Elle est au centre d'un chemin de croix de quatorze stations alignées au pied même del'enceinte du camp de concentration, de l'autre côté du mur d'exécution.
De toutes les baraques, on ne voit qu'elle.
Et pourtant, le lieu choisi semble incontestable.
Comme l'indique un panneau au piedde ce calvaire, il s'agit de la fosse de graviers (zwirowisko) où, au début de la guerre, étaient fusillés les résistants polonais.
L'impatience juive tourne à la franche irritation.
La presse réserve des titres de plus en plus gros à la polémique.
Le carmel quidevait être un lieu de silence, de prière et d'expiation devient objet de scandale, désigné à la vindicte par les anciens déportés oules simples touristes venus filmer les lieux.
" Oui à la mémoire, non au carmel ", clament les banderoles.
A la colère juive correspond une exaspération croissante des Polonais, notamment de la ville et des environs d'Oswiecim oùcirculent des pétitions pour réclamer le maintien des soeurs et dénoncer les concessions faites aux juifs.
Amplement relayées par les médias, les protestations vont reprendre de plus belle après les déclarations faites le 26 août, lorsdu pèlerinage annuel à Czestochowa, par le cardinal Glemp, primat de Pologne.
Devant une foule de deux cent mille fidèles, enprésence du nouveau premier ministre polonais, M.
Mazowiecki, il lance : " Nous avons péché envers le peuple juif, mais nousaimerions dire aujourd'hui : cher peuple juif, ne nous parlez pas en position de nation qui se dresse contre toutes les autres etn'imposez pas de conditions impossibles à remplir.
Ne voyez-vous pas, peuple juif estimé, que des déclarations contre lesreligieuses carmélites aigrissent les sentiments de tous les Polonais et violent notre souveraineté acquise au prix de tellesdouleurs ? " Et Mgr Glemp insiste : " Votre pouvoir réside dans les médias à votre disposition.
Ne les laissez pas répandre unesprit antipolonais.
" L'irritation juive est à son comble.
Le hasard ou la coïncidence veut que, quelques jours après, le papepublie à Rome une lettre apostolique dénonçant l'antisémitisme : " L'hostilité ou pis la haine envers le judaïsme, écrit Jean-Paul II,est en complète contradiction avec la vision chrétienne de la dignité de l'homme.
" Le Vatican intervient enfin, par la voix ducardinal Willebrands, chargé des relations avec le judaïsme, dont personne n'ignore qu'il est le porte-parole du pape lui-même.
Ilréclame à son tour la reprise de la construction du nouveau centre incluant le carmel.
Le climat se détend peu à peu, et lapremière pierre est officiellement posée par le cardinal Macharski le 19 février 1990.
Mais, avant le déménagement des carmélites, une sorte de valse-hésitation se poursuivra pour savoir qui, de Rome, duprovincial des carmes ou de l'épiscopat polonais, devait leur signifier l'ordre de départ.
Il faudra l'intervention du pape enpersonne, dans une lettre aux soeurs publiée le 14 avril, à la veille du cinquantième anniversaire du soulèvement du ghetto deVarsovie, pour dénouer la crise et annoncer le dernier acte d'aujourd'hui : un déménagement annoncé depuis plus de sept ans.
HENRI TINCQ Le Monde du 10 juillet 1993.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Article de presse: L'affaire des diamants
- Article de presse: L'affaire Ben Barka
- Article de presse: L'affaire Siniavski-Daniel
- Comment rédiger un article de presse
- Article de presse en Anglais Film Pokemon 1