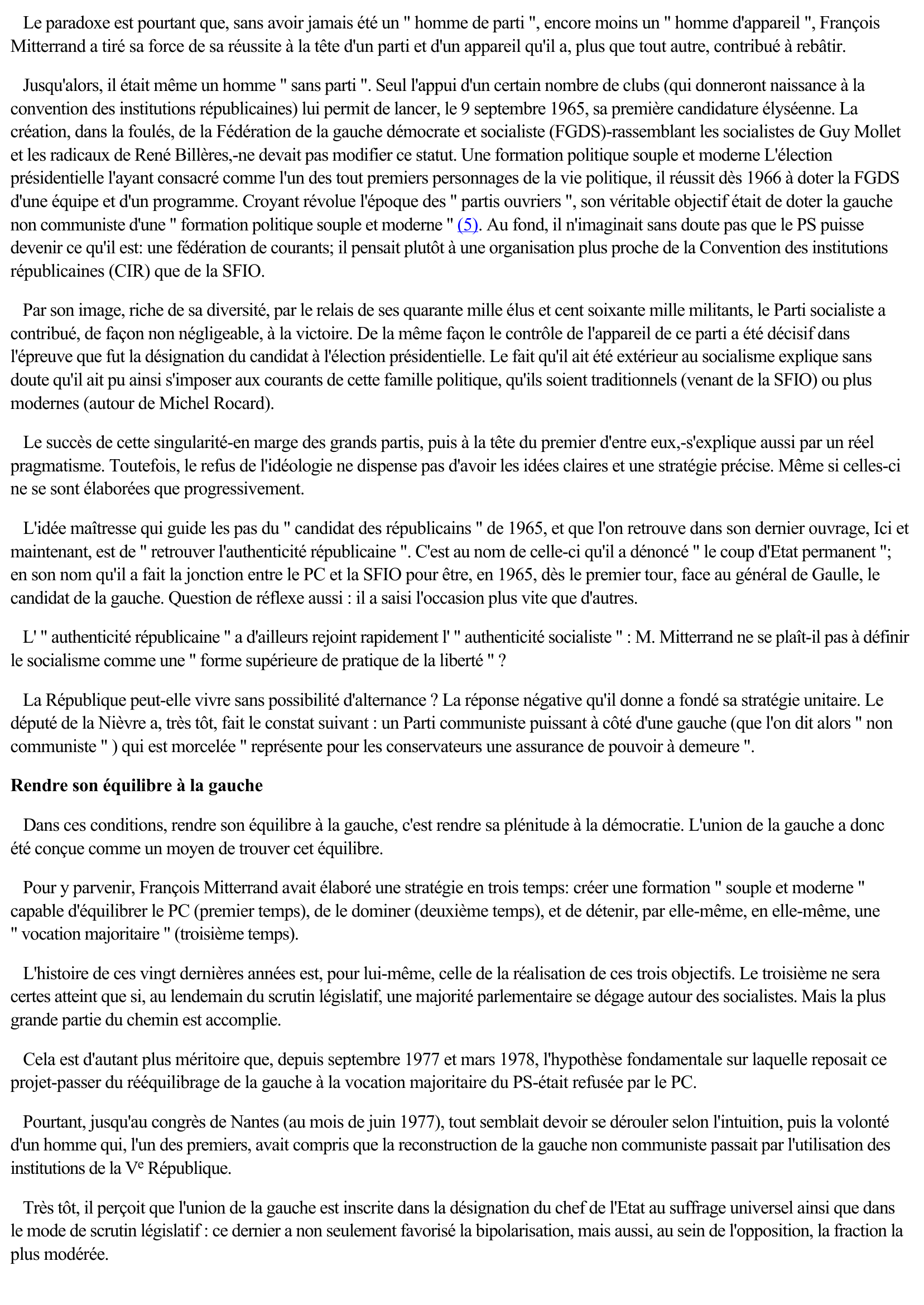10 mai 1981 - François Mitterrand ne s'est pas contenté tout au long de sa vie d'être intelligent et de faire montre d'un sens aigu de la politique : il a su ne jamais renoncer, et continuer de risquer plutôt que de subir.
Au reste, ayant commencé tôt dans cette voie, il s'est plu à rappeler, lors de son " pèlerinage " sur les lieux de son évasion en RDA, en compagnie de M. Willy Brandt (au mois de mars 1981). qu'il lui avait fallu tenter par trois fois de s'évader avant d'y parvenir. En 1981, il se présentait pour la troisième fois à l'élection présidentielle.
Candidature-défi le 19 décembre 1965, " au nom de tous les républicains ", face à un homme qui était alors au faîte de sa puissance et qui, déjà entré dans l'histoire, n'en venait pas moins d'être soumis au ballottage (1). Candidature-espoir en 1974, au nom d'une gauche unie sur son nom et liée par un programme de gouvernement. Candidature-bilan en 1981, qui lui permet de récolter ce qu'il a semé.
Dans l'intervalle, que de ressources ! " Ce n'est pas dans mon caractère d'obéir " (à M. Giscard d'Estaing), s'exclamait-il devant une foule enthousiaste à Montpellier, à quelques jours du scrutin. Il n'est pas non plus dans son caractère de plier devant la fatalité du destin. Ne l'a-t-on pas cru mort, politiquement s'entend, par trois fois déjà ?
En 1958, l'avènement de la Ve République paraît sonner le glas d'une carrière ministérielle conduite jusqu'au seuil de la présidence du Conseil. René Coty, deuxième et dernier président de la IVe République, avait en effet songé à lui confier une charge qui échut finalement à Félix Gaillard (le 5 novembre 1957). " François Mitterrand à Matignon aurait sans doute constitué un cabinet de style nouveau dans ces conditions, le général de Gaulle aurait-il conservé les mêmes chances de faire le 13 mai ? ", s'est demandé plus tard Roger Duchet, proche de M. Antoine Pinay et adversaire entêté de François Mitterrand (2). Il serait sans doute injuste de voir dans cet épisode malheureux l'origine de l'hostilité du troisième successeur de Charles de Gaulle à l'égard du fondateur du régime.
Le 31 mai 1958, une nouvelle entrevue n'est guère plus heureuse que celle de 1943 à Alger : on s'en tint à " un constat lucide d'hostilité irrémédiable " (3). Hostilité d'autant plus affirmée qu'il n'a pas accepté le " coup de force " qui à, selon lui, ramené au pouvoir le général de Gaulle. Attitude que ne comprendront pas les électeurs de la Nièvre : à l'aube de la Ve, l'enfant chéri de la IVe n'a plus en main que son mandat de conseiller général.
Mai 1968
Dix ans plus tard, au mois de mai 1968, alors que de patients efforts lui avaient permis de se remettre en selle et de placer la gauche sur la route de l'unité, il a le tort de se précipiter un peu trop. Noyé dans la tourmente, comme beaucoup, et ignorant, comme tant d'autres, les desseins de de Gaulle, il se déclare, le 28 mai, candidat à la présidence de la République et propose la constitution d'un gouvernement provisoire de gestion pour la direction duquel il avance le nom de Pierre Mendès France. Mais de Gaulle revint et le leader de la gauche qu'il était devenu (depuis sa candidature à l'Elysée en 1965) n'échappa que de justesse au fiasco électoral que celle-ci subit les 23 et 30 juin.
Dix ans passèrent de nouveau jusqu'en mars 1978 : entre-temps, de tenaces efforts lui avait permis de frôler la victoire, au nom de la gauche du programme commun en 1974 (4). L'échec électoral, consécutif à une désunion durable du PC et du PS, fait alors croire à la droite que son champion est en place pour longtemps. Il fait croire à Michel Rocard qu'il lui est possible de proposer, au PS et à la gauche, sa propre démarche. Avec l'insuccès que l'on sait.
Deux épisodes pénibles
Cette aptitude à " rebondir ", cette capacité de résistance, cette obstination, il les doit à un solide individualisme. Il est vrai que ce " personnage de roman ", comme disait François Mauriac, a eu maintes occasions de se durcir-au point d'avoir " oublié qu'il fut un garçon chrétien " -au contact de la vie politique : il connut deux épisodes des plus pénibles.
Cinq ans après l' " affaire des fuites ", où il était totalement innocent, ce fut en 1959 une fusillade dirigée contre lui à l'orée des jardins de l'Observatoire. Provocation (selon François Mitterrand) ou machination (selon ses adversaires) ? La question agita, et agite encore, bien des esprits. Il suffit de noter que le malaise suscité par cette affaire n'a guère atteint ceux qui connaissaient bien la victime, tels François Mauriac ou Pierre Mendès France.
On peut convenir que ces épreuves ne furent dominées qu'à force de volonté et de repli sur soi. Le caractère solitaire du personnage s'en est trouvé durablement renforcé, au point qu'il confiait en privé, sans craindre l'exagération, la joie que lui procurait la perspective de gagner seul, sans argent, sans médias, sans journaux !
Le paradoxe est pourtant que, sans avoir jamais été un " homme de parti ", encore moins un " homme d'appareil ", François Mitterrand a tiré sa force de sa réussite à la tête d'un parti et d'un appareil qu'il a, plus que tout autre, contribué à rebâtir.
Jusqu'alors, il était même un homme " sans parti ". Seul l'appui d'un certain nombre de clubs (qui donneront naissance à la convention des institutions républicaines) lui permit de lancer, le 9 septembre 1965, sa première candidature élyséenne. La création, dans la foulés, de la Fédération de la gauche démocrate et socialiste (FGDS)-rassemblant les socialistes de Guy Mollet et les radicaux de René Billères,-ne devait pas modifier ce statut. Une formation politique souple et moderne L'élection présidentielle l'ayant consacré comme l'un des tout premiers personnages de la vie politique, il réussit dès 1966 à doter la FGDS d'une équipe et d'un programme. Croyant révolue l'époque des " partis ouvriers ", son véritable objectif était de doter la gauche non communiste d'une " formation politique souple et moderne " (5). Au fond, il n'imaginait sans doute pas que le PS puisse devenir ce qu'il est: une fédération de courants; il pensait plutôt à une organisation plus proche de la Convention des institutions républicaines (CIR) que de la SFIO.
Par son image, riche de sa diversité, par le relais de ses quarante mille élus et cent soixante mille militants, le Parti socialiste a contribué, de façon non négligeable, à la victoire. De la même façon le contrôle de l'appareil de ce parti a été décisif dans l'épreuve que fut la désignation du candidat à l'élection présidentielle. Le fait qu'il ait été extérieur au socialisme explique sans doute qu'il ait pu ainsi s'imposer aux courants de cette famille politique, qu'ils soient traditionnels (venant de la SFIO) ou plus modernes (autour de Michel Rocard).
Le succès de cette singularité-en marge des grands partis, puis à la tête du premier d'entre eux,-s'explique aussi par un réel pragmatisme. Toutefois, le refus de l'idéologie ne dispense pas d'avoir les idées claires et une stratégie précise. Même si celles-ci ne se sont élaborées que progressivement.
L'idée maîtresse qui guide les pas du " candidat des républicains " de 1965, et que l'on retrouve dans son dernier ouvrage, Ici et maintenant, est de " retrouver l'authenticité républicaine ". C'est au nom de celle-ci qu'il a dénoncé " le coup d'Etat permanent "; en son nom qu'il a fait la jonction entre le PC et la SFIO pour être, en 1965, dès le premier tour, face au général de Gaulle, le candidat de la gauche. Question de réflexe aussi : il a saisi l'occasion plus vite que d'autres.
L' " authenticité républicaine " a d'ailleurs rejoint rapidement l' " authenticité socialiste " : M. Mitterrand ne se plaît-il pas à définir le socialisme comme une " forme supérieure de pratique de la liberté " ?
La République peut-elle vivre sans possibilité d'alternance ? La réponse négative qu'il donne a fondé sa stratégie unitaire. Le député de la Nièvre a, très tôt, fait le constat suivant : un Parti communiste puissant à côté d'une gauche (que l'on dit alors " non communiste " ) qui est morcelée " représente pour les conservateurs une assurance de pouvoir à demeure ".
Rendre son équilibre à la gauche
Dans ces conditions, rendre son équilibre à la gauche, c'est rendre sa plénitude à la démocratie. L'union de la gauche a donc été conçue comme un moyen de trouver cet équilibre.
Pour y parvenir, François Mitterrand avait élaboré une stratégie en trois temps: créer une formation " souple et moderne " capable d'équilibrer le PC (premier temps), de le dominer (deuxième temps), et de détenir, par elle-même, en elle-même, une " vocation majoritaire " (troisième temps).
L'histoire de ces vingt dernières années est, pour lui-même, celle de la réalisation de ces trois objectifs. Le troisième ne sera certes atteint que si, au lendemain du scrutin législatif, une majorité parlementaire se dégage autour des socialistes. Mais la plus grande partie du chemin est accomplie.
Cela est d'autant plus méritoire que, depuis septembre 1977 et mars 1978, l'hypothèse fondamentale sur laquelle reposait ce projet-passer du rééquilibrage de la gauche à la vocation majoritaire du PS-était refusée par le PC.
Pourtant, jusqu'au congrès de Nantes (au mois de juin 1977), tout semblait devoir se dérouler selon l'intuition, puis la volonté d'un homme qui, l'un des premiers, avait compris que la reconstruction de la gauche non communiste passait par l'utilisation des institutions de la Ve République.
Très tôt, il perçoit que l'union de la gauche est inscrite dans la désignation du chef de l'Etat au suffrage universel ainsi que dans le mode de scrutin législatif : ce dernier a non seulement favorisé la bipolarisation, mais aussi, au sein de l'opposition, la fraction la plus modérée.
Très tôt, il sait que cette gauche non communiste, qu'il nomme la " démocratie socialiste ", doit rechercher les " assises sociologiques de son renouveau ". Où les trouverait-elle sinon " parmi les chercheurs, ingénieurs, cadres techniques et agents de maîtrise ", puisque " le nombre des ouvriers décroît " ? Rapidement (trop rapidement puisqu'il lui faudra attendre plus longtemps qu'il n'espérait), il professe que la part dominante du salariat dans la société française rend la gauche sociologiquement majoritaire.
Son premier souci est d'abord de reprendre aux communistes le terrain perdu par la SFIO : il faut " s'ancrer à gauche, tandis qu'aller vers le centre revient à leur abandonner ce terrain " (6). Cette analyse lui permet de se tenir sagement à l'écart de l'élection présidentielle de 1969. Mieux même, le cuisant échec du tandem Defferre-Mendès France, et de sa stratégie centriste, précipite l'effondrement de la " vieille maison " et rend inéluctable le succès, deux ans plus tard, à Epinay-sur-Seine, de celui qui devient, pour dix ans, le premier secrétaire du PS. L'ancrage à gauche du PS et plus profondément la moralisation du comportement des socialistes sont acquis, sur le plan interne, par l'alliance nouée avec le CERES au congrès d'Epinay; sur le plan externe, par la signature, dès juin 1972, du programme commun.
Ce succès rapide s'explique : le jeune PS ne représente alors qu'une faible force électorale par rapport à la formation dominante de la gauche qu'est le PC, mais qui ne saurait le rester : " Notre objectif fondamental, explique François Mitterrand devant le congrès de l'Internationale socialiste, réuni à Vienne le 28 juin 1972, c'est de refaire un grand Parti socialiste sur le terrain occupé par le PC lui-même, afin de faire la démonstration que, sur les cinq millions d'électeurs communistes, trois millions peuvent voter socialiste. C'est la raison de l'accord (entre le PS et le PC). " Pari difficile. Pari en passe d'être tenu mais après maintes péripéties : au fil des consultations électorales, le PS se place en position d'exercer ce leadership. Le PC s'en émeut dès le lendemain du scrutin présidentiel de 1974 : les élections législatives partielles qui se déroulent à l'automne montrent clairement que l'union profite surtout aux socialistes. Le congrès extraordinaire du PCF qui se réunit au mois d'octobre devient, sous l'impulsion de Roland Leroy, un congrès de dénonciation du PS. Dans la tradition communiste, les mots d'ordre hostiles à la social-démocratie sont le signe annonciateur d'un retour à la stratégie autonome.
Les socialistes continuent pourtant de vivre, et de prospérer, dans le confort de la " dynamique unitaire " et de sa traduction électorale (celle-ci sera d'ailleurs spectaculaire aux élections municipales de 1977). Mais dans le même temps, François Mitterrand, lui aussi, jette les bases d'une démarche plus autonome : l'opération des " assises du socialisme ", qu'il accepte sur les conseils de Pierre Mauroy, et qui marque le ralliement de Michel Rocard au nouveau PS, se déroule au mois de décembre. Elle vise, entre autres objectifs, à doter le jeune Parti socialiste d'une idéologie qui permette de faire contrepoids aux communistes.
La rupture
Ainsi, dès la fin de l'année 1974, soit sept mois à peine après que le candidat commun de la gauche eut frôlé la victoire, tout est en place pour faire de l'union un " combat ". Ce combat est rude et spectaculaire. L'actualisation du programme commun fournit l'occasion de la rupture. Le PCF prend l'initiative de l'une et de l'autre, en demandant une réunion au sommet, dès le 31 mars 1977, et en maintenant ses exigences dans plusieurs domaines (étendue des nationalisations, montant du salaire minimum, calendrier des mesures sociales, politique de défense notamment), jusqu'au 23 septembre, date de la suspension sine die des négociations.
Si François Mitterrand souhaite alors une révision limitée, une actualisation, il s'agit pour les communistes d'engager une véritable renégociation. Et ce, pour une raison essentielle : dans un contexte de recul vis-à-vis du PS, il n'est plus question d'accepter un partage des rôles avec lui, mais bien de doter l'union d'un programme suffisamment contraignant pour les socialistes.
L'échec de mars 1978 est donc le fruit d'une contradiction : des deux côtés, le moyen (l'union) visait une même fin (l'hégémonie à gauche).
Il devient alors possible à Michel Rocard de se poser en homme mieux à même que François Mitterrand de réaliser la vocation majoritaire du PS à la faveur d'un scrutin présidentiel de 1981. Le premier secrétaire est marqué non seulement par l'échec de son discours unitaire, qui ne rencontre d'autre écho que la dénonciation, par le PC, mais aussi par le changement qu'introduit la remise en cause de la détente internationale. François Mitterrand et ses partisans récusent en Michel Rocard le continuateur d'une oeuvre visant à " restituer le socialisme à la France ". La contre-offensive est lancée sur ce terrain, et le premier secrétaire y emploie une extrême habileté.
Mieux vaut, au demeurant, parler d'une extrême, voire une excessive, habileté. Cela permet de rendre compte de son aptitude, peu ordinaire, à concevoir ses actes non seulement en fonction des nécessités du moment, mais aussi en ayant à l'esprit l'étape ultérieure. Une aptitude à mêler la tactique et la stratégie, le court et le long terme, le " subalterne " et l'essentiel.
Ainsi du congrès de Metz (en avril 1979), où il lui faut d'abord préserver son pouvoir pour s'assurer le contrôle d'un appareil (jusque-là aux mains de M. Mauroy), qui lui garantira d'être de nouveau candidat à l'Elysée, s'il le souhaite. C'est l'objectif immédiat de l'alliance renouée avec le CERES, aux dépens non seulement de Michel Rocard, mais aussi du maire de Lille. Mais s'allier aux amis de Jean-Pierre Chevènement, c'est aussi préparer le terrain d'un discours qu'il faudra, pense-t-il, tenir en direction des gaullistes.
Cette capacité à prévoir est servie par un goût du secret qui le conduit non à rester silencieux, mais plutôt à multiplier les déclarations qui suscitent autant de commentaires utiles à sa démarche.
Ainsi de sa candidature : il n'y a nulle raison de penser qu'il n'ait pas douté, qu'il ne se soit pas sincèrement interrogé, faut-il ou non être candidat, ai-je ou non une chance de battre Valéry Giscard d'Estaing, Michel Rocard est-il ou non le meilleur candidat ?
La décision de l'été 1980
Au début de l'été 1980, sa décision est prise. Pourtant il continue d'entretenir le doute jusqu'au 8 novembre, date à laquelle expire le délai prévu par le PS.
Le secret serait de peu d'efficacité s'il n'y avait, au surplus, une grande maîtrise du temps. François Mitterrand sait lui consentir chaque joue ce qu'il faut de lectures, de marches, d'amours, de disponibilité pour emplir une vie, et chaque semaine ce qu'il faut d'attention et de visites pour conserver la confiance des électeurs nivernais comme celle des militants socialistes.
Surtout, il sait gérer le temps d'une politique : celle qu'il conduit victorieusement commence en 1979. Les données de départ lui sont défavorables, personnellement et politiquement.
Ayant incarné l'union de la gauche, il paie l'échec de cette stratégie par une cote de popularité si faible qu'elle paraît indiquer une durable désaffection de l'opinion. Entre le PC et le PS, c'est à qui obtiendra de celle-ci qu'elle désigne l'autre comme seul responsable de la rupture.
En outre, la crise économique n'est pas sans effet néfaste sur l'état de la gauche. Face à la progression de son partenaire d'hier et rival d'aujourd'hui, la direction communiste avait, pendant un temps, hésité entre un redressement " ouvriériste " et une ouverture " eurocommuniste " en direction notamment des couches moyennes (c'est en 1976 qu'elle abandonne officiellement la référence à la " dictature du prolétariat " ). Après 1977, le PCF abandonne cette seconde attitude au profit de la première : le choix en ce domaine paraît avoir été dicté par les difficultés économiques. Les communistes considèrent que celles-ci non seulement aggravent la condition des couches ouvrières mais encore créent une véritable prolétarisation des couches moyennes.
Dès lors, il devient possible pour le PCF, à condition de revenir à un discours dur, protestataire, de regonfler ses effectifs et de conforter son électorat.
L'évolution du climat international n'est pas en reste : le programme commun s'insérait dans un contexte de détente. La remise en cause de celle-ci, là aussi, conduit l'un et l'autre parti à revenir à ses tendances naturelles, à savoir l'aval donné par le PCF aux positions de la diplomatie soviétique (dans l'affaire de l'Afghanistan, notamment) et la demande formulée par le candidat socialiste d'une renégociation de l'alliance atlantique Et pourtant François Mitterrand va retourner la situation en sa faveur en l'espace de six mois.
Le déclic de novembre
Le déclic se produit à la fin du mois de novembre : les élections législatives partielles montrent cette fois que la droite peut, elle aussi, payer le prix de sa désunion. Le manque à gagner résultant pour la gauche de sa désunion peut-il être inférieur au manque à gagner résultant, pour la droite, de la rivalité entre Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac ? Il suffit de le croire pour rendre la victoire possible. François Mitterrand fait cette analyse d'autant plus aisément qu'il mise sur l'aspiration unitaire du " peuple de la gauche " pour relayer l'union défaillante. Il accepte avec le PC, dont il espère qu'elle s'achèvera lorsque les communistes auront payé le prix de la désunion, par un retour à de meilleurs sentiments unitaires. Cette vision est cohérente, mais risquée, car elle suppose, d'une part, que le PS-et donc lui-même-creusera davantage l'écart avec le PC ou son candidat et, d'autre part, que l'union se refera sur la base d'un déséquilibre aggravé entre les deux partis.
Au soir du 26 avril, il a pu enregistrer la force de l'aspiration unitaire et se réjouir d'avoir effectivement creusé l'écart au-delà de ce qu'il pouvait prévoir. Les prochaines étapes seront, certes, difficiles à franchir : il faudra, d'ici au 1er juillet, conclure un contrat de gouvernement et confirmer ce rapport de forces au cours d'élections législatives que la gauche réunie devra gagner. Mais il peut d'ores et déjà éprouver une double fierté : celle d'avoir replacé le socialisme à son rang en effaçant l'image d'un passage lié à la IVe République pour lui substituer la force d'une idée : l'union de la gauche celle d'avoir su pallier les défaillances de cette union en continuant d'incarner l'aspiration unitaire.
Il était bien placé pour cela : par deux fois déjà, l'électorat communiste ne s'était-il pas mobilisé sur son nom ? Quant à sa faible popularité, qui contrastait avec celle, montante, de M. Rocard, il a su distinguer entre la phase qui précède le vote et celle du vote où la logique du duel du second tour l'emporte sur l'appréciation des images personnelles. " A l'approche de l'élection présidentielle, le PS n'aura plus qu'un candidat ", écrivaient dès le mois de mai 1980 deux excellents analystes, avant de poursuivre : " Quel qu'il soit, celui-ci, revenu de la situation de concurrence à l'état de monopole, entrera alors dans la logique bipolaire du système politique français, logique où la dialectique des blocs l'emportera sur les images personnelles, et où la mobilisation chaque jour accrue effacera, au moins temporairement, le souvenir de la course à la candidature (7) ".
Le rassemblement
Sans charisme, François Mitterrand n'aurait sans doute pas pu mobiliser, presque malgré elle, une gauche divisée.
Son action a mis en mouvement la gauche tout entière, où il a établi la prééminence du courant socialiste. Enfin, dans le pays, il a provoqué un rassemblement qui va, comme il le souhaitait, " au-delà " de la gauche.
A cet égard, Valéry Giscard d'Estaing a sans doute commis l'erreur de faire campagne à droite, en ne tenant compte qu'entre les deux tours d'un centre gauche souvent décisif. " Méfiez-vous du changement ", devait d'ailleurs dire le président sortant (8), oubliant qu'il l'avait emporté lui-même en prônant ce changement, n'apercevant pas que les Français étaient désormais habitués à voir François Mitterrand l'incarner, et ne se souvenant pas de cette analyse pertinente qu'il avait faite en mai 1974 : " Lorsque le PC sera ramené à 15 % ", les conditions de l'alternance seront crées.
La victoire de François Mitterrand tient à une autre raison. Tout au long de la Ve République, la majorité s'est maintenue au pouvoir par des élargissements successifs, marginaux mais décisifs. Les derniers ralliements centristes s'étant manifestés en 1974 (celui de Jean Lecanuet), restait à grignoter à gauche. François Mitterrand a su, là aussi, résister avec " obstination ", en restant résolument " ancré à gauche ". Cette résistance n'aurait pas à elle seule suffi si Michel Crépeau ne s'était trouvé à la tête du MRG. Le maire de La Rochelle a retenu son parti de suivre l'exemple de son ancien président, Robert Fabre.
Ainsi la " majorité " n'a-t-elle pu disposer de réserves pour se " régénérer ", selon l'expression de François Mitterrand, alors même qu'elle s'enfermait dans une querelle opposant deux conceptions de la gestion de droite.
JEAN-MARIE COLOMBANI
Le Monde du 12 mai 1981