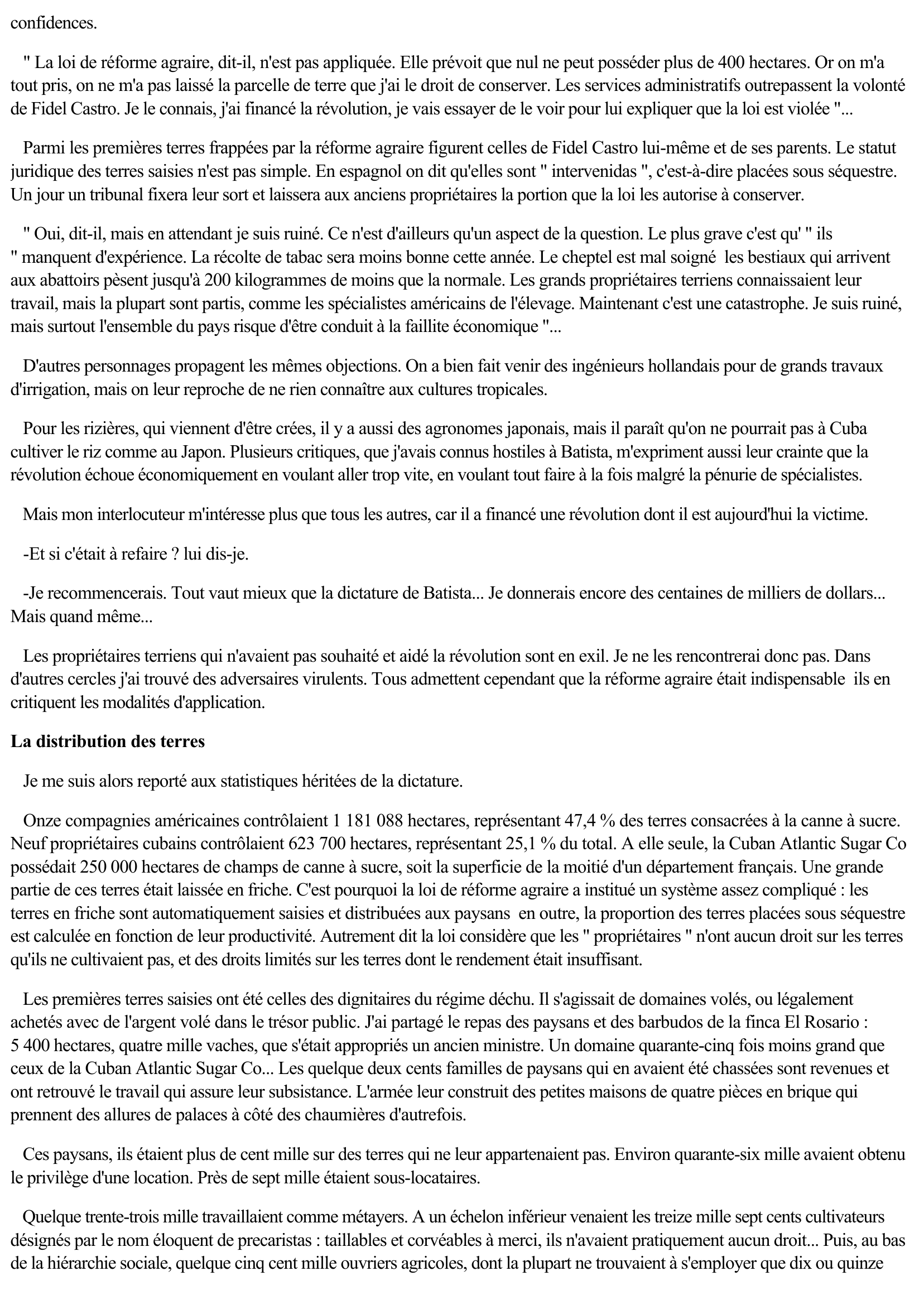Article de presse: Cuba, si !
Publié le 22/02/2012

Extrait du document


«
confidences.
" La loi de réforme agraire, dit-il, n'est pas appliquée.
Elle prévoit que nul ne peut posséder plus de 400 hectares.
Or on m'atout pris, on ne m'a pas laissé la parcelle de terre que j'ai le droit de conserver.
Les services administratifs outrepassent la volontéde Fidel Castro.
Je le connais, j'ai financé la révolution, je vais essayer de le voir pour lui expliquer que la loi est violée "...
Parmi les premières terres frappées par la réforme agraire figurent celles de Fidel Castro lui-même et de ses parents.
Le statutjuridique des terres saisies n'est pas simple.
En espagnol on dit qu'elles sont " intervenidas ", c'est-à-dire placées sous séquestre.Un jour un tribunal fixera leur sort et laissera aux anciens propriétaires la portion que la loi les autorise à conserver.
" Oui, dit-il, mais en attendant je suis ruiné.
Ce n'est d'ailleurs qu'un aspect de la question.
Le plus grave c'est qu' " ils" manquent d'expérience.
La récolte de tabac sera moins bonne cette année.
Le cheptel est mal soigné les bestiaux qui arriventaux abattoirs pèsent jusqu'à 200 kilogrammes de moins que la normale.
Les grands propriétaires terriens connaissaient leurtravail, mais la plupart sont partis, comme les spécialistes américains de l'élevage.
Maintenant c'est une catastrophe.
Je suis ruiné,mais surtout l'ensemble du pays risque d'être conduit à la faillite économique "...
D'autres personnages propagent les mêmes objections.
On a bien fait venir des ingénieurs hollandais pour de grands travauxd'irrigation, mais on leur reproche de ne rien connaître aux cultures tropicales.
Pour les rizières, qui viennent d'être crées, il y a aussi des agronomes japonais, mais il paraît qu'on ne pourrait pas à Cubacultiver le riz comme au Japon.
Plusieurs critiques, que j'avais connus hostiles à Batista, m'expriment aussi leur crainte que larévolution échoue économiquement en voulant aller trop vite, en voulant tout faire à la fois malgré la pénurie de spécialistes.
Mais mon interlocuteur m'intéresse plus que tous les autres, car il a financé une révolution dont il est aujourd'hui la victime.
-Et si c'était à refaire ? lui dis-je.
-Je recommencerais.
Tout vaut mieux que la dictature de Batista...
Je donnerais encore des centaines de milliers de dollars...Mais quand même...
Les propriétaires terriens qui n'avaient pas souhaité et aidé la révolution sont en exil.
Je ne les rencontrerai donc pas.
Dansd'autres cercles j'ai trouvé des adversaires virulents.
Tous admettent cependant que la réforme agraire était indispensable ils encritiquent les modalités d'application.
La distribution des terres
Je me suis alors reporté aux statistiques héritées de la dictature.
Onze compagnies américaines contrôlaient 1 181 088 hectares, représentant 47,4 % des terres consacrées à la canne à sucre.Neuf propriétaires cubains contrôlaient 623 700 hectares, représentant 25,1 % du total.
A elle seule, la Cuban Atlantic Sugar Copossédait 250 000 hectares de champs de canne à sucre, soit la superficie de la moitié d'un département français.
Une grandepartie de ces terres était laissée en friche.
C'est pourquoi la loi de réforme agraire a institué un système assez compliqué : lesterres en friche sont automatiquement saisies et distribuées aux paysans en outre, la proportion des terres placées sous séquestreest calculée en fonction de leur productivité.
Autrement dit la loi considère que les " propriétaires " n'ont aucun droit sur les terresqu'ils ne cultivaient pas, et des droits limités sur les terres dont le rendement était insuffisant.
Les premières terres saisies ont été celles des dignitaires du régime déchu.
Il s'agissait de domaines volés, ou légalementachetés avec de l'argent volé dans le trésor public.
J'ai partagé le repas des paysans et des barbudos de la finca El Rosario :5 400 hectares, quatre mille vaches, que s'était appropriés un ancien ministre.
Un domaine quarante-cinq fois moins grand queceux de la Cuban Atlantic Sugar Co...
Les quelque deux cents familles de paysans qui en avaient été chassées sont revenues etont retrouvé le travail qui assure leur subsistance.
L'armée leur construit des petites maisons de quatre pièces en brique quiprennent des allures de palaces à côté des chaumières d'autrefois.
Ces paysans, ils étaient plus de cent mille sur des terres qui ne leur appartenaient pas.
Environ quarante-six mille avaient obtenule privilège d'une location.
Près de sept mille étaient sous-locataires.
Quelque trente-trois mille travaillaient comme métayers.
A un échelon inférieur venaient les treize mille sept cents cultivateursdésignés par le nom éloquent de precaristas : taillables et corvéables à merci, ils n'avaient pratiquement aucun droit...
Puis, au basde la hiérarchie sociale, quelque cinq cent mille ouvriers agricoles, dont la plupart ne trouvaient à s'employer que dix ou quinze.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Article de presse: Consolider les réformes économiques à Cuba
- Comment rédiger un article de presse
- Article de presse en Anglais Film Pokemon 1
- Presse article de presse
- Article de presse: Le doute ?