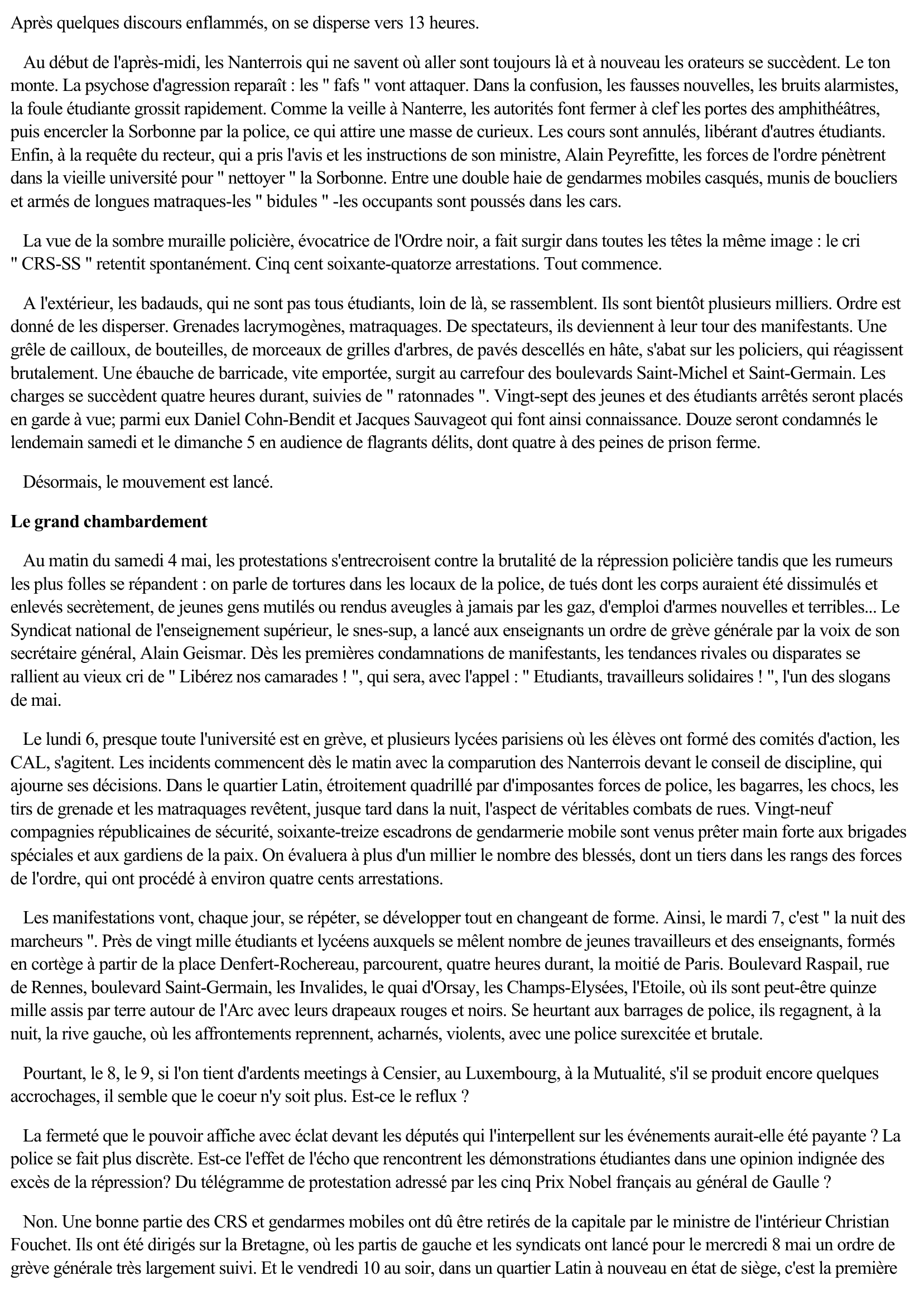10 mai 1968 - A l'occasion de leur dixième anniversaire, Pierre Viansson-Ponté retrace le déroulement des " évènements " de mai-juin 1968.
Le premier drapeau noir que l'on ait vu depuis bien longtemps flotter dans une grande manifestation populaire parisienne, à côté des drapeaux rouges du socialisme et du communisme, est soudain brandi par un petit groupe d'étudiants venus se mêler, le 1er mai 1968, au cortège organisé par la CGT et le Parti communiste, qui défile pour la fête du travail de la République à la Bastille. Vite et durement refoulés aux cris de " Les fils à papa au boulot ! ", ces " gauchistes ", comme on dit, ne troublent qu'un instant le serein déroulement de la manifestation, scandée des slogans habituels : " Augmentez nos salaires ! ", " Pompidou, des sous ! ", " Abrogation des ordonnances ! ", " Sécurité sociale ! "... Il y a quelques jours à peine, le vieux mentor de la CGT, Benoît Frachon, moquait " les brillants annonciateurs de grèves générales à répétition ", tandis que la Confédération signait le premier accord d'intéressement des travailleurs d'une entreprise, en présence de Jacques Chirac, secrétaire d'Etat à l'emploi.
Demain 2 mai, les députés vont voter à l'unanimité la généralisation de la quatrième semaine de congé payé. Le 3 mai, les centrales ouvrières, CGT en tête, signeront l'accord conclu dans la sidérurgie lorraine pour la réduction des horaires. Bref, le climat social est plutôt détendu, peu combatif, nullement menaçant : d'autant moins que les autres syndicats et partis de gauche ont refusé de se mêler au cortège cégétiste et célébré le 1er mai de leur côté.
Le premier ministre, Georges Pompidou, se prépare à partir, l'esprit en repos, le 2 mai, pour un voyage officiel en Iran et en Afghanistan, avec une suite nombreuse. Quant au général de Gaulle, il est particulièrement satisfait. Dans le domaine qui lui tient le plus à coeur, il va pouvoir annoncer un événement spectaculaire : Washington et Hanoi ont choisi Paris pour ouvrir enfin, le 10 mai, les négociations sur le Vietnam. Ce sera la participation de la France au dénouement de ce conflit.
Nul ne se soucie, dans ces conditions, de la fièvre qui règne une fois de plus dans l'une des facultés de la périphérie parisienne, celle de Nanterre. D'ailleurs, il y a des mois que cela dure. Mal située et mal conçue, sinistre et surpeuplée, cette faculté est un bouillon de culture. Une psychose d'agression par les " fafs " (fascistes) d'Occident, le foisonnement de mouvements rivaux-trotskistes, maoïstes, situationnistes, anarchistes de diverses tendances, s'y affrontent en champ clos,-la fréquence des manifestations de toutes sortes engendrent sans cesse des incidents parfois violents, un climat constamment tendu.
Le 2 mai, on a appris que huit étudiants de Nanterre, qui avaient lancé quelques semaines plus tôt, le 22 mars, un nouveau mouvement contestataire, sont convoqués devant le conseil de discipline de l'université. L'agitation reprend, s'enfle, déborde. On casse tout.
C'est Nanterre-la-folie. Bah ! Un chahut de plus, voilà tout, mais un peu plus vif qu'à l'habitude, pensent les autorités.
Elles réagissent en faisant d'abord cerner le campus par d'imposantes forces de police, ce qui n'a pour résultat que d'exacerber la fureur des " enragés ", ainsi qu'ils se nomment eux-mêmes. En fin de journée, le recteur Roche-Nanterre est rattaché à la Sorbonne-et le doyen Grappin rendent compte à leurs supérieurs du ministère, qui prennent la décision d'éteindre ce foyer d'agitation en fermant tout simplement la faculté. " Les cours, annonce Grappin, sont désormais suspendus. " La mesure sera largement approuvée, et notamment par Georges Marchais, qui rédige aussitôt l'éditorial qui paraîtra le lendemain 3 mai dans l'Humanité. Le secrétaire général du Parti communiste expose ainsi l'affaire : " Comme toujours, lorsque progresse l'union des forces ouvrières et démocratiques, les groupuscules gauchistes s'agitent dans tous les milieux... (à l'université de Nanterre) ces groupuscules-quelques centaines d'étudiants-se sont unifiés dans ce qu'ils appellent " le mouvement du 22 mars-Nanterre " , dirigé par l'anarchiste allemand Cohn-Bendit. Un des maîtres à penser de ces gauchistes est le philosophe allemand Herbert Marcuse, qui vit aux Etats-Unis. " Groupuscules, anarchistes allemands : des mots qui feront fortune. Et Georges Marchais continue d'aligner les attendus : " fils de grands bourgeois ", " malfaisante besogne ", " aventurisme gauchiste ", " phraséologie révolutionnaire "... Le pouvoir, de son côté, n'en juge pas autrement.
Comment les bouffonneries de ces agités pourraient-elles ébranler la classe ouvrière, inquiéter le pouvoir gaulliste? Cependant, foyer d'agitation et camp retranché, Nanterre était aussi l'abcès de fixation. Chassés de leur campus, les enragés vont porter leurs psychoses, leurs clameurs et leurs défis au quartier Latin, et leur combat dans la rue. Ils ne le savent pas eux-mêmes, mais ils seront le détonateur de cette révolution un peu fête, de cette fête un peu révolution qui va devenir émeute, puis, presque insurrection, embraser Paris et plusieurs grandes villes pendant un mois et davantage, rencontrer le relais d'une grève quasi générale, faire vaciller le pouvoir du général de Gaulle et basculer l'Etat.
A midi, le vendredi 3 mai, les Nanterrois, Daniel Cohn-Bendit en tête, campent dans la cour de la Sorbonne. Un meeting a été improvisé à l'appel de l'UNEF et de son vice-président, Jacques Sauvageot, pour protester contre les citations en conseil de discipline. Il réunit quatre cents participants : sur les cent soixante mille étudiants que compte l'agglomération parisienne, c'est peu. Après quelques discours enflammés, on se disperse vers 13 heures.
Au début de l'après-midi, les Nanterrois qui ne savent où aller sont toujours là et à nouveau les orateurs se succèdent. Le ton monte. La psychose d'agression reparaît : les " fafs " vont attaquer. Dans la confusion, les fausses nouvelles, les bruits alarmistes, la foule étudiante grossit rapidement. Comme la veille à Nanterre, les autorités font fermer à clef les portes des amphithéâtres, puis encercler la Sorbonne par la police, ce qui attire une masse de curieux. Les cours sont annulés, libérant d'autres étudiants. Enfin, à la requête du recteur, qui a pris l'avis et les instructions de son ministre, Alain Peyrefitte, les forces de l'ordre pénètrent dans la vieille université pour " nettoyer " la Sorbonne. Entre une double haie de gendarmes mobiles casqués, munis de boucliers et armés de longues matraques-les " bidules " -les occupants sont poussés dans les cars.
La vue de la sombre muraille policière, évocatrice de l'Ordre noir, a fait surgir dans toutes les têtes la même image : le cri " CRS-SS " retentit spontanément. Cinq cent soixante-quatorze arrestations. Tout commence.
A l'extérieur, les badauds, qui ne sont pas tous étudiants, loin de là, se rassemblent. Ils sont bientôt plusieurs milliers. Ordre est donné de les disperser. Grenades lacrymogènes, matraquages. De spectateurs, ils deviennent à leur tour des manifestants. Une grêle de cailloux, de bouteilles, de morceaux de grilles d'arbres, de pavés descellés en hâte, s'abat sur les policiers, qui réagissent brutalement. Une ébauche de barricade, vite emportée, surgit au carrefour des boulevards Saint-Michel et Saint-Germain. Les charges se succèdent quatre heures durant, suivies de " ratonnades ". Vingt-sept des jeunes et des étudiants arrêtés seront placés en garde à vue; parmi eux Daniel Cohn-Bendit et Jacques Sauvageot qui font ainsi connaissance. Douze seront condamnés le lendemain samedi et le dimanche 5 en audience de flagrants délits, dont quatre à des peines de prison ferme.
Désormais, le mouvement est lancé.
Le grand chambardement
Au matin du samedi 4 mai, les protestations s'entrecroisent contre la brutalité de la répression policière tandis que les rumeurs les plus folles se répandent : on parle de tortures dans les locaux de la police, de tués dont les corps auraient été dissimulés et enlevés secrètement, de jeunes gens mutilés ou rendus aveugles à jamais par les gaz, d'emploi d'armes nouvelles et terribles... Le Syndicat national de l'enseignement supérieur, le snes-sup, a lancé aux enseignants un ordre de grève générale par la voix de son secrétaire général, Alain Geismar. Dès les premières condamnations de manifestants, les tendances rivales ou disparates se rallient au vieux cri de " Libérez nos camarades ! ", qui sera, avec l'appel : " Etudiants, travailleurs solidaires ! ", l'un des slogans de mai.
Le lundi 6, presque toute l'université est en grève, et plusieurs lycées parisiens où les élèves ont formé des comités d'action, les CAL, s'agitent. Les incidents commencent dès le matin avec la comparution des Nanterrois devant le conseil de discipline, qui ajourne ses décisions. Dans le quartier Latin, étroitement quadrillé par d'imposantes forces de police, les bagarres, les chocs, les tirs de grenade et les matraquages revêtent, jusque tard dans la nuit, l'aspect de véritables combats de rues. Vingt-neuf compagnies républicaines de sécurité, soixante-treize escadrons de gendarmerie mobile sont venus prêter main forte aux brigades spéciales et aux gardiens de la paix. On évaluera à plus d'un millier le nombre des blessés, dont un tiers dans les rangs des forces de l'ordre, qui ont procédé à environ quatre cents arrestations.
Les manifestations vont, chaque jour, se répéter, se développer tout en changeant de forme. Ainsi, le mardi 7, c'est " la nuit des marcheurs ". Près de vingt mille étudiants et lycéens auxquels se mêlent nombre de jeunes travailleurs et des enseignants, formés en cortège à partir de la place Denfert-Rochereau, parcourent, quatre heures durant, la moitié de Paris. Boulevard Raspail, rue de Rennes, boulevard Saint-Germain, les Invalides, le quai d'Orsay, les Champs-Elysées, l'Etoile, où ils sont peut-être quinze mille assis par terre autour de l'Arc avec leurs drapeaux rouges et noirs. Se heurtant aux barrages de police, ils regagnent, à la nuit, la rive gauche, où les affrontements reprennent, acharnés, violents, avec une police surexcitée et brutale.
Pourtant, le 8, le 9, si l'on tient d'ardents meetings à Censier, au Luxembourg, à la Mutualité, s'il se produit encore quelques accrochages, il semble que le coeur n'y soit plus. Est-ce le reflux ?
La fermeté que le pouvoir affiche avec éclat devant les députés qui l'interpellent sur les événements aurait-elle été payante ? La police se fait plus discrète. Est-ce l'effet de l'écho que rencontrent les démonstrations étudiantes dans une opinion indignée des excès de la répression? Du télégramme de protestation adressé par les cinq Prix Nobel français au général de Gaulle ?
Non. Une bonne partie des CRS et gendarmes mobiles ont dû être retirés de la capitale par le ministre de l'intérieur Christian Fouchet. Ils ont été dirigés sur la Bretagne, où les partis de gauche et les syndicats ont lancé pour le mercredi 8 mai un ordre de grève générale très largement suivi. Et le vendredi 10 au soir, dans un quartier Latin à nouveau en état de siège, c'est la première nuit des barricades.
La Sorbonne solidement gardée, les ponts bouclés, les accès partout fermés par crainte de voir les émeutiers envahir tout Paris, le cortège, parti comme chaque soir de Denfert-Rochereau, se voit pris au piège. Qu'importe : on " occupera " le quartier Latin, que faire d'autre ? Les curieux, alertés par les informations que diffusent les radios, affluent par milliers. Les lycéens sont là. La première barricade, faite de voitures poussées au milieu de la voie, de morceaux de palissades, de grilles d'arbres et de pavés, surgit vers 21 heures, rue Le-Goff. Une demi-heure plus tard, on en compte trois au carrefour Médicis. Passé minuit, on en dénombrera plus de trente, énormes ouvrages de plus de 3 mètres de hauteur hérissés de pieux et défendus par un réseau serré de fils de fer tendus à hauteur d'homme ou simples tas de débris, de gravats et d'objets hétéroclites. Leur implantation traduit l'improvisation et l'inexpérience.
Les ministres, autour de Louis Joxe, qui assure l'intérim de Georges Pompidou, toujours en Afghanistan, le préfet de police, Maurice Grimaud, les responsables de l'Université et de l'ordre, se livrent à une sorte de ballet dans l'anxiété et l'incertitude. Le général de Gaulle dort et nul n'osera le réveiller. Des négociations se nouent, puis se défont, les émissaires vont des chefs gauchistes-qui ne contrôlent plus rien-aux autorités. On se défie, on s'insulte, on menace et on implore. Toute la France, à l'écoute, voit littéralement monter les barricades, grossir la foule, se tendre l'atmosphère à travers les récits haletants des radio-reporters. A 2 heures du matin, l'ordre est donné de déblayer le quartier. La première muraille compacte, et quasi monstrueuse, d'hommes noirs s'ébranle lourdement boulevard Saint-Michel.
En cinq heures, cinq mille grenades seront tirées. Les escadrons, précédés de bulldozers et d'autopompes, avancent matraques levées, dans les nappes de gaz, la fumée des voitures incendiées, le fracas des explosions, bombardés de pavés, de projectifs de toutes sortes.
Pas à pas, ils gagnent du terrain, en reperdent, emportent une barricade, puis une autre, se replient, reviennent en force, donnent la chasse aux manifestants. Miracle : si l'on relève, cette fois encore, un millier de blessés au moins, dont une cinquantaine grièvement atteints parmi les manifestants, quatre cents du côté des forces de l'ordre, pas un coup de feu n'est tiré. On n'aura pas un mort, pas un seul, à déplorer.
Le samedi 11 mai, les syndicats ouvriers, la FEN et l'UNEF avancent au lundi l'ordre de grève qu'ils avaient déjà lancé pour " une journée nationale de protestation contre la répression ". De Gaulle consulte, prêche la fermeté. Mais au début de la soirée, le premier ministre débarque à Orly retour de Kaboul, se rend à l'Elysée, arrache au général des concessions. " Il ne faut pas mégoter ", dit-il.
Sur-le-champ, Georges Pompidou annonce à la télévision que les manifestants seront graciés et libérés, la Sorbonne rouverte librement dès lundi, il condamne " les provocations de quelques agitateurs professionnels ", il appelle à " un apaisement rapide et totale ". C'est trop tard.
Le lundi, dés 8 h 30, la Sorbonne, rouverte, est envahie par les étudiants. Censier à été occupé la veille, l'Odéon le sera à son tour le surlendemain. Dans ces trois places fortes du " pouvoir étudiant ", un extraordinaire meeting commence qui va durer pratiquement sans interruption pendant plus d'un mois, jusqu'à la mi-juin. A défaut de prendre le pouvoir, on a pris la parole, comme jadis la Bastille, et on ne la lâchera plus. Des comités d'occupation et d'organisation sans chefs et sans mandat, issus d'assemblées générales permanentes, qui les révoquent à peine nommés, président à une sorte de kermesse débridée, doublée d'une foire aux idées et aux slogans que des dizaines de milliers de Parisiens iront contempler, stupéfaits. Les réformistes discutent de la transformation de l'Université, les révolutionnaires cherchent le contact avec les ouvriers, rêvent de la Commune, de la prise du Palais d'Hiver, et de la Longue Marche en préparant le " grand soir ".
Dans l'après-midi de ce lundi 13, cependant, la manifestation, ordonnée par les syndicats et les partis de gauche qui ont dû accepter de se plier aux exigences des organisations étudiantes, déferle en un interminable cortège de la République à Denfert-Rochereau. En tête, Cohn-Bendit, Geismar, Sauvageot et les " groupuscules ". Puis viennent, autour de Georges Séguy (pour la CGT) et Eugène Descamps (pour la CFDT), les syndicalistes. Loin derrière, les dirigeants communistes, socialistes et radicaux, tous présents autour de Waldeck Rochet, Guy Mollet et François Mitterrand. Pierre Mendès France défile avec le PSU.
Partout des banderoles " Etudiants, enseignants, travailleurs solidaires ", " 13 mai 1958, 13 mai 1968-dix ans, ça suffit ", " Gouvernement populaire ", " La victoire est dans la rue ". On chante " Adieu de Gaulle, adieu de Gaulle, adieu ". On laisse un espace se créer entre deux délégations et on comble le vide ainsi créé en quelques bonds rapides, le " banzaï " étudiant : " Hop ! hop ! hop ! " Un million de manifestants disent les organisateurs. Deux cent trente mille, estime le préfet de police, Maurice Grimaud.
Cette démonstration, paradoxalement, rassure le pouvoir : allons la récupération par les formations organisées est en bonne voie. On va retrouver devant l'opposition de gauche, les centrales syndicales, dans un schéma classique et plus rassurant. Les étudiants ont couronné la journée par un " sit-in " au Champ-de-Mars, sans incidents. On n'a pas vu un casque au Quartier Latin. De Gaulle, après avoir hésité et malgré l'avis de son ministre de l'intérieur, décide de maintenir un voyage officiel prévu de longue date en Roumanie. Il quitte Paris le mardi 14 à l'aube, serein et rassuré. Il ignore qu'en trois jours à la stupeur du gouvernement, mais aussi des partis et des syndicats, dix millions de travailleurs vont basculer dans la grève.
C'est l'usine de Sud-Aviation à Chateau-Bougon, près de Nantes, qui sera la première à s'arrêter, le 14 au matin. Une petite usine : deux mille ouvriers. Mais une région " dure ", une entreprise en flèche dans la revendication. Le directeur, les cadres sont enfermés dans les bureaux-ils y resteront, séquestrés, jusqu'au 29 mai-malgré l'opposition des délégués CGT et l'usine est occupée.
Le lendemain, l'usine de Cléon de la régie Renault, aux portes de Rouen, s'arrête à son tour. Puis Lockheed à Beauvais, UNELEC à Orléans, et de proche en proche, une foule d'entreprises, aussitôt occupées par leur personnel en grève.
De l'émeute à l'insurrection
Partout, il s'agit d'usines où des incidents se sont déjà produits, où les problèmes de salaires, de cadences et d'emploi sont particulièrement aigus où surtout de jeunes ouvriers, parfois travaillés par les ferments anarchistes, trotskistes, gauchistes et attentifs à la révolte étudiante, prennent spontanément l'initiative du débrayage contre l'avis des responsables, malgré l'opposition de la CGT, " grande force tranquille ".
La grève ainsi lancée, il ne reste plus aux confédérations ouvrières qu'à prendre le train en marche, et faute d'avoir pu l'empêcher, de tenter de la contrôler. Le jeudi 16, à 17 heures, à l'appel du secrétaire de la CGT, l'usine de Billancourt de la régie Renault entre à son tour dans le mouvement. Et la liste s'allonge. Le 16 au soir il y a soixante-dix mille grévistes le 17 à 15 heures, trois cent mille à 22 heures, cinq cent mille à six cent mille le samedi 18, deux millions. Le lundi 20, on évalue leur nombre à six millions. A partir de là, on ne sait plus qui est en grève et qui est empêché de travailler par les arrêts des transports, les coupures d'électricité, les grèves des autres ateliers, des fournisseurs et des clients.
Ce qui est sûr, c'est qu'au point culminant, le 24 mai, de neuf à dix millions de salariés auront cessé le travail.
Pendant ces jours où la France se paralyse rapidement, une sorte de trêve semble régner au quartier Latin et dans les villes universitaires de province où la récolte avait fait tache d'huile. Car on s'agite aussi, et on se bat, on occupe, on défile, à Marseille et à Toulouse, à Lyon et à Rennes, à Nantes et à Strasbourg, où les incidents sont nombreux, parfois violents. Cependant le petit nombre et l'isolement relatif des étudiants dont la révolte, guère comprise, n'est que malaisément admise, peu réprimé au surplus, car les effectifs de maintien de l'ordre ont été concentrés à Paris, suscitent l'inquiétude de la " France profonde ", des ruraux et de la population des petites villes, foncièrement hostiles aux émeutiers et horrifiés de leur propos révolutionnaires. A cet égard, le débat qui oppose, à la télévision, Cohn-Bendit, Geismar et Sauvageot à trois journalistes, s'il offre aux gauchistes l'occasion de marquer des points, est désastreux pour eux dans l'esprit de millions de téléspectateurs.
A la Sorbonne, à Censier, à l'Odéon, citadelles du mouvements, le happening continue et on essaie quasi désespérément de trouver un langage commun, d'inventer des structures, d'imaginer des bouleversements et surtout de rencontrer la classe ouvrière. La liaison étudiants-ouvriers, demeuré mythique à la Sorbonne, s'est au moins nouée à Censier sous l'égide des CATE (Comité d'action travailleurs-étudiants) mais la conduite de Grenoble faite aux délégations qui tentent d'être entendues des grévistes de Renault-Billancourt, où ils se heurtent aux grilles obstinément closes de l'usine, et dix autres épisodes analogues marquent la reprise en main des masses par la CGT et le PC, qui ne veulent à aucun prix être enchaînés encore par les gauchistes, ces trublions. Pour une fois, c'est Billancourt qui désespère la Sorbonne et non l'inverse.
On s'installe donc, sans trop de violences et de manifestations, dans la grève et l'attente tandis qu'au Palais-Bourbon de graves débats se déroulent dans l'indifférence générale du public. Mais le retour du général de Gaulle, le samedi 18, va déchaîner à nouveau la tempête. Le général est furieux. " La récréation est terminée ", annonce-t-il à son arrivée à Orly. " C'est le bordel partout ", lance-t-il au premier ministre. Et il ordonne l'évacuation par la force, et sur-le-champ, de la Sorbonne et de l'Odéon, proclamant : " La réforme, oui, la chienlit, non ! " Toute la journée du dimanche, ployant l'échine sous un déluge de reproches, ministres et collaborateurs s'efforcent de fléchir le chef de l'Etat. Ils n'y parviennent qu'à moitié, gagnent un peu de temps, puis un peu encore, tandis que la France s'enfonce dans la crise, que la grève prolifère sans consignes et parfois sans revendications précises.
L'opposition a déposé à l'Assemblée nationale une motion de censure, qui s'est discutée les 21 et 22 mai et recueille 233 voix, onze de moins que la majorité absolue.
Les étudiants continuent de défiler, de se rassembler, de discourir et de couvrir les murs de graffiti, mais la fièvre semble se calmer. Ces propos enflammés pèsent peu à peu au regard de la grève. Mais voici pourtant que le 22 au soir on apprend soudain qu'une mesure d'interdiction de séjour a été prise à l'encontre de Daniel Cohn-Bendit, parti imprudemment répandre la bonne nouvelle en Allemagne et qui sera refoulé quand il tentera de rentrer en France.
Aussitôt après douze jours d'accalmies, les échauffourées et les violences reprennent. On arrive ainsi au vendredi 24 mai, seconde journée des barricades au quartier Latin, mais surtout tournant essentiel de toute l'affaire, le jour où tout d'un côté comme de l'autre, aurait pu être gagné et où tout va être perdu.
De cette étrange et décisive journée du 24 mai, on retiendra, sans plus entrer dans le détail, qu'elle revêt un caractère franchement insurrectionnel. Des groupes d'émeutiers parcourent Paris, attaquent plusieurs commissariats de police et y mettent le feu, forcent les portes de la Bourse, menacent de prendre le ministère de la justice, refluent vers le champ clos du quartier Latin, où ils abattent les arbres-cent trente sont jetés à terre-cassent tout et élèvent derechef des barricades. Une nouvelle tactique de harcèlement, médité et coordonnées, sinon vraiment dirigée, désoriente et affole les forces de l'ordre.
De Gaulle a annoncé, dans une allocution radiotélévisée, un référendum accueilli par un énorme éclat de rire : " J'ai mis à côté de la plaque ", reconnaîtra-t-il, penaud. Encore une fois, des blessés par centaines, mais un degré de violence jamais atteint, des destructions, des pillages. Le ministre de l'intérieur incriminera " la pègre descendue des faubourgs " et l'Humanité parle de " la lie ". Les étudiants protesteront, mais l'opinion leur donnera tort. Car elle bascule : le mouvement cesse d'être populaire. Il atteint son zénith. La grève aussi. La roue tourne.
C'est l'instant cependant où le régime va se liquéfier, l'Etat trébucher. De Gaulle s'est disqualifié, il est visible qu'il ne comprend pas, qu'il doute, qu'il se trompe. Autour de lui, c'est le vide, le désert : un climat de trahison et de fin de règne. Seul Georges Pompidou entouré de quelques hommes, au premier rang desquels Michel Jobert, fait front et garde son sang-froid.
Le premier ministre a noué patiemment et en secret les fils de la négociation avec le patronat et les syndicats, par l'intermédiaire de Jacques Chirac.
Les pourparlers s'ouvrent le samedi 25 au ministère du travail, rue de Grenelle. Ils s'achèveront après un marathon de trente-six heures sur un accord prévoyant l'augmentation par étapes de 10 % des salaires, le relèvement de 35 % du salaire minimum, et quelques avantages supplémentaires, notamment la reconnaissance de la section syndicale d'entreprise. Les deux leaders syndicalistes, Georges Séguy et Eugène Descamps, viennent le lundi 27 au matin, présenter cet accord aux ouvriers de Renault-Billancourt, qui le rejettent et décident de poursuivre la grève. C'est un moment étrange qui n'a pas encore livré tous ses secrets. La grève continue donc, partout. Comment en sortir ?
Nul ne le sait plus. Au stade Charléty, le même lundi 27, en présence de Pierre Mendès France, silencieux, les éléments révolutionnaires ont commencés d'esquisser les lendemains qui, c'est juré, chanteront. La police a disparu. Le premier ministre appuie sur les levier de commande : ils ne répondent plus, personne n'obéit plus. Parmi les possédants, c'est la panique chez les politiciens, la débandade. Le pouvoir s'évapore littéralement.
Au nom de la gauche, François Mitterrand propose de constituer un gouvernement provisoire que dirigeait Pierre Mendès France. Ce dernier insiste pour qu'Alain Geismar soit ministre. Les communistes refusent, multiplient les objections et les conditions. Pour sa part, François Mitterrand sera candidat à l'Elysée. Cohn-Bendit, narguant l'Etat, a reparu à minuit à la Sorbonne, les cheveux teints et l'air hilare. De Gaulle, terré dans son palais, se tait.
Le coup de théâtre
Et soudain, c'est le coup de théâtre. Le mercredi 29 au matin, alors que les ministres convoqués comme chaque semaine pour le conseil commencent d'arriver à l'Elysée, le général fait annuler la réunion du gouvernement et s'en va. Où ? Il n'en a pas fait confidence, pas même à son premier ministre, auquel il a annoncé simplement son départ, concluant la conversation d'une formule- " Je vous embrasse " -qui laisse son interlocuteur stupéfait. Symbole : le général mime-t-il sa propre mort ? Ou prend-il du champ pour se mettre à la tête de ses troupes et reconquérir par la force Paris et le pouvoir?
Est-ce une ruse ou la guerre civile ?
Toute la journée, dans une extrême agitation, au milieu des rumeurs les plus fantastiques, la classe politique s'interroge et se bouscule.
De Gaulle va-t-il se retirer ou revenir ? Et d'abord, où est-il et que fait-il ? On suit avec angoisse-une angoisse sans fondement-les douze meetings organisés, en douze places différentes de la capitale, par la CGT. Le bruit court que les militants ont reçu des armes, qu'ils vont s'emparer de l'Hôtel de Ville, proclamer la Commune, se saisir du pouvoir que personne n'exerce plus.
La psychose de révolution communiste s'enfle de la peur des gauchistes. Il n'y a plus de gouvernement, plus de police-y a-t-il encore une armée ? Et obéirait-elle ?-plus d'administration, plus de transport, plus d'essence, plus de télévision, plus rien. Toutes les cartes-celle de la répression, celle des concessions, celle du référendum, celle des négociations-ont été jouées. Et perdues. Le pouvoir est bien " dans la rue ". Il est à ramasser.
Disparu à 11 h 20, de Gaulle reparaît à 18 h 15. A Colombey. On apprendra par la suite qu'il est allé à Baden-Baden, chez son vieux camarade le commandant supérieur des troupes françaises d'Allemagne, le général Massu. Plus tard, il dira à la télévision : " Oui, le 29 mai, j'ai eu la tentation de me retirer... " Le 30 mai, comme la veille, les réactions, les proclamations, les injonctions, s'entrecroisent. Georges Pompidou rédige sa lettre de démission. Jean Lecanuet, des gaullistes même, réclament " un gouvernement de salut public ". Valéry Giscard d'Estaing demande le maintien du général et le départ du gouvernement, son remplacement par une équipe plus large, qu'il semble prêt à diriger. La gauche s'efforce de pousser ses pions sur l'échiquier.
A 12 h 25, le général arrive à l'Elysée. Il reçoit son premier ministre, refuse sa démission, mais écarte d'abord la requête insistante qu'il lui présente : prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Une heure de discussion, de Gaulle cède. Un rapide conseil des ministres. A 16 h 30, à la radio, le général annonce ses décisions : maintien du premier ministre, remaniement du gouvernement, ajournement du référendum, dissolution de l'Assemblée.
Il affirme sa légitimité et sa détermination, attaque le Parti communiste-excellent dérivatif habituel,-menace de se saisir par l'article 16 de tous les pouvoirs. Assurance et gravité, ni alarmisme ni illusions. Le ton juste, enfin.
Un dernier choc psychologique encore, après ce sensationnel retournement. Les gaullistes et, à leur appel, la foule vont déferler sur les Champs-Elysées, monter à l'Etoile. Manifestation tricolore qui réplique au grand défilé de la gauche le 13 mai et qui, quoi qu'on en ait dit, n'est nullement improvisée à la dernière minute. Un million de participants assurent les organisateurs. De trois à quatre cent mille, estime le préfet de police. Peu importe. C'est fini.
Dans la nuit du 30 au 31 mai, les dépôts de carburant de la région parisienne sont dégagés, les pompes approvisionnées. Le week-end de la Pentecôte commence : il fera soixante-dix morts et six cents blessés sur les routes. Quatre Frances sont séparées comme les galaxies par des millions d'années-lumière.
A Deauville, la cohue : plus une chambre libre pour les nuits du samedi et du dimanche, plus une table dans les cafés et les restaurants, plus un mètre carré de sable inoccupé.
Dans les usines, les chantiers, les magasins, les bureaux, de neuf à dix millions de grévistes qui sentent venir la fin du mouvement et, relâchant leur vigilance, quittent les piquets pour aller passer le dimanche en famille. Les syndicats s'efforcent de maintenir le moral des troupes par des manifestations antigaullistes à Clermont-Ferrand, à Nantes, à Caen, à Limoges...
En face, les gaullistes, qui manifestent aussi, dans vingt, trente villes, où des cortèges prolongent l'écho du rassemblement des Champs-Elysées : Lyon, Nice, Rennes, Toulouse, Marseille...
Enfin, à Paris, à l'appel de la seule UNEF et malgré la réaction hostile de la CGT et la réserve des partis de gauche, de quinze à vingt mille manifestants vont de la gare Montparnasse à la gare d'Austerlitz à travers le quartier Latin en scandant : " Ce n'est qu'un début. Continuons le combat ! " et " Elections-trahison ! ".
Frances des indifférents, des partisans de l'ordre, des grévistes et des contestataires : entre chacune d'elles, des murs épais d'incompréhension, de peur, de hargne et de colère. Il faudra quelques semaines encore, et cette fois quelques morts, hélas ! pour liquider la révolte et conclure la grève. La France qui s'en fout rejoindra le camp de l'ordre à l'heure du scrutin, ce qui produira la plus forte majorité parlementaire-trois cent soixante sièges sur quatre cent quatre-vingt-cinq-qui soit jamais sortie des urnes sous la République.
PIERRE VIANSSON-PONTE
Le Monde du 3 mai 1978