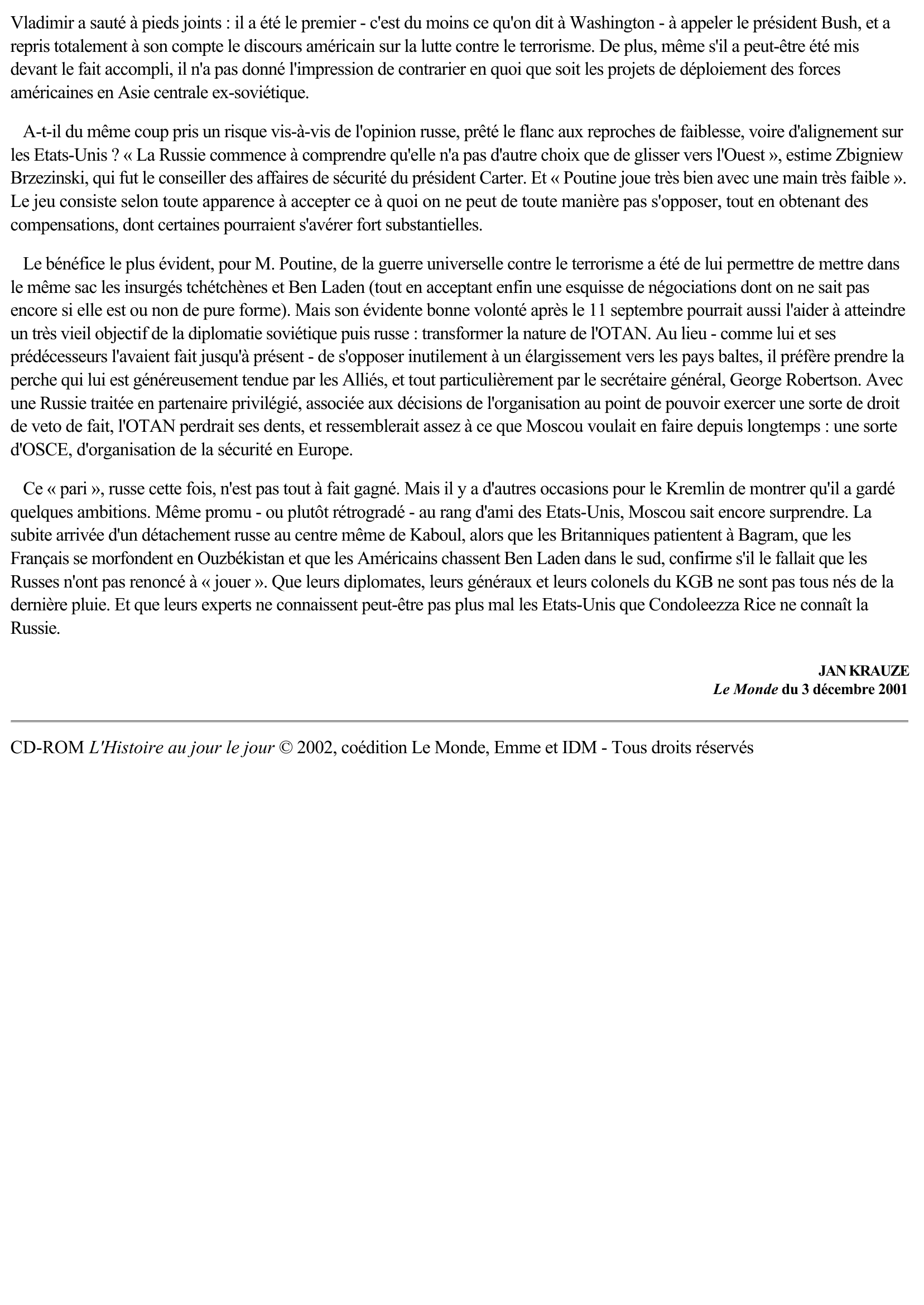Après le 11 septembre, une nouvelle Russie
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
«
Vladimir a sauté à pieds joints : il a été le premier - c'est du moins ce qu'on dit à Washington - à appeler le président Bush, et arepris totalement à son compte le discours américain sur la lutte contre le terrorisme.
De plus, même s'il a peut-être été misdevant le fait accompli, il n'a pas donné l'impression de contrarier en quoi que soit les projets de déploiement des forcesaméricaines en Asie centrale ex-soviétique.
A-t-il du même coup pris un risque vis-à-vis de l'opinion russe, prêté le flanc aux reproches de faiblesse, voire d'alignement surles Etats-Unis ? « La Russie commence à comprendre qu'elle n'a pas d'autre choix que de glisser vers l'Ouest », estime ZbigniewBrzezinski, qui fut le conseiller des affaires de sécurité du président Carter.
Et « Poutine joue très bien avec une main très faible ».Le jeu consiste selon toute apparence à accepter ce à quoi on ne peut de toute manière pas s'opposer, tout en obtenant descompensations, dont certaines pourraient s'avérer fort substantielles.
Le bénéfice le plus évident, pour M.
Poutine, de la guerre universelle contre le terrorisme a été de lui permettre de mettre dansle même sac les insurgés tchétchènes et Ben Laden (tout en acceptant enfin une esquisse de négociations dont on ne sait pasencore si elle est ou non de pure forme).
Mais son évidente bonne volonté après le 11 septembre pourrait aussi l'aider à atteindreun très vieil objectif de la diplomatie soviétique puis russe : transformer la nature de l'OTAN.
Au lieu - comme lui et sesprédécesseurs l'avaient fait jusqu'à présent - de s'opposer inutilement à un élargissement vers les pays baltes, il préfère prendre laperche qui lui est généreusement tendue par les Alliés, et tout particulièrement par le secrétaire général, George Robertson.
Avecune Russie traitée en partenaire privilégié, associée aux décisions de l'organisation au point de pouvoir exercer une sorte de droitde veto de fait, l'OTAN perdrait ses dents, et ressemblerait assez à ce que Moscou voulait en faire depuis longtemps : une sorted'OSCE, d'organisation de la sécurité en Europe.
Ce « pari », russe cette fois, n'est pas tout à fait gagné.
Mais il y a d'autres occasions pour le Kremlin de montrer qu'il a gardéquelques ambitions.
Même promu - ou plutôt rétrogradé - au rang d'ami des Etats-Unis, Moscou sait encore surprendre.
Lasubite arrivée d'un détachement russe au centre même de Kaboul, alors que les Britanniques patientent à Bagram, que lesFrançais se morfondent en Ouzbékistan et que les Américains chassent Ben Laden dans le sud, confirme s'il le fallait que lesRusses n'ont pas renoncé à « jouer ».
Que leurs diplomates, leurs généraux et leurs colonels du KGB ne sont pas tous nés de ladernière pluie.
Et que leurs experts ne connaissent peut-être pas plus mal les Etats-Unis que Condoleezza Rice ne connaît laRussie.
JAN KRAUZE Le Monde du 3 décembre 2001
CD-ROM L'Histoire au jour le jour © 2002, coédition Le Monde, Emme et IDM - Tous droits réservés.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Question2: Elaborée en un temps record de trois mois, la nouvelle Constitution est présentée publiquement par de Gaulle, le 4 septembre 1958, date anniversaire de la fondation de: A.
- REYNAUD, Paul (15 octobre 1878-21 septembre 1966) Homme politique C'est en tant qu'avocat que Paul Reynaud, après des voyages qui l'ont mené au Mexique comme au Japon, en Chine comme en Russie, commence sa carrière.
- REYNAUD, Paul (15 octobre 1878-21 septembre 1966) Homme politique C'est en tant qu'avocat que Paul Reynaud, après des voyages qui l'ont mené au Mexique comme au Japon, en Chine comme en Russie, commence sa carrière.
- REYNAUD, Paul (15 octobre 1878-21 septembre 1966) Homme politique C'est en tant qu'avocat que Paul Reynaud, après des voyages qui l'ont mené au Mexique comme au Japon, en Chine comme en Russie, commence sa carrière.
- Chasseurs de la RAF en Russie: Du secours de l'Angleterre, septembre-novembre 1941 (histoire).