Religion et modernité
Publié le 09/12/2012
Extrait du document
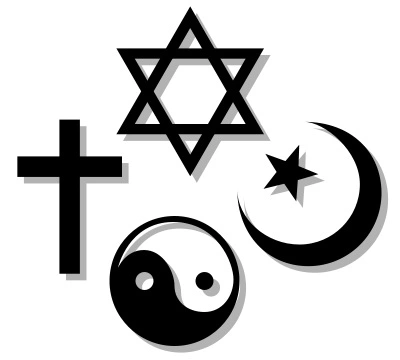
Programme national de pilotage Religions et modernité Sous la direction de Jean-Marie Husser professeur à l'université Marc-Bloc, Strasbourg Actes de l'université d'automne de Guebwiller, 27-30 octobre 2003 Direction de l'Enseignement scolaire Bureau de la formation continue des enseignants 1 Sommaire Avant-propos Jean-Marie Husser Introductions Dominique Borne et Gérard Chaix I. LE DISCOURS CRITIQUE SUR LES RELIGIONS Mark Sherringham : La critique philosophique de la religion au 18ème siècle Jean-Marie Husser : L'approche historique des documents fondateurs : la Bible Alfred-Louis de Prémare : L'approche historique des figures religieuses : Muhammad Jean-Paul Willaime : L'approche sociologique des faits religieux II. RELIGIONS ET SECULARISATION DES SOCIETES Gilbert Vincent : Le concept de sécularisation, perspectives historiques et critiques François Boespflug : La crucifixion déportée, sur la sécularisation en Occident d'un thème majeur de l'art chrétien Frank Frégosi : L'islam en France, une religion minoritaire dans un espace sécularisé et laïque Francis Messner : État et religions en Europe. III. LES RELIGIONS FACE A LA MODERNITE Viviane Comerro : Islam et modernité, quelques jalons d'un parcours historique Luc Perrin : Catholicisme et modernité Sophie Nizard : Judaïsme et modernité IV. PERSPECTIVES PEDAGOGIQUES Oissila Saaidia : Comment enseigner le fait religieux Nathalie Siffer-Wiederhold : La prédication missionnaire et le kérygme des premiers chrétiens Thierry Legrand : Les Hébreux, une histoire et plusieurs représentations 2 François Bessire : La Bible dans la littérature française du XVIIIe siècle, omniprésence et confrontations Jacques Gaillard : Enseignement du fait religieux et formation civique CONCLUSION Danièle Cotinat, Jacqueline Gaillard, Francesco Belcastro, Guy Mandon, Marcel Spisser Annexe Jacques Miet : Le statut juridique des cultes en Alsace-Moselle Bibliographie thématique 3 Avant-Propos 4 Avant-Propos Jean-Marie Husser, Professeur à l'Université Marc Bloch, Strasbourg Donner toute leur place aux faits religieux dans les programmes de l'enseignement public s'est peu à peu imposé comme une nécessité urgente, au fil d'un inventaire et d'une réflexion menés depuis près d'un quart de siècle déjà. Cependant, si la nécessité semble s'imposer, les modalités pratiques et les objectifs pédagogiques peinent à se définir devant une réalité en constante évolution. Les attendus du récent Rapport Debray (2002) synthétisent les observations faites dans le Rapport Joutard (1989), ainsi que dans les enquêtes et travaux divers qui l'avaient précédé et qui l'ont suivi au cours des années 1980 et 1990. Tous convergent vers le constat aujourd'hui bien établi d'un déficit alarmant de connaissances religieuses chez les jeunes générations, entraînant une incapacité croissante à s'approprier une part de plus en plus importante de leur patrimoine culturel. A ce constat s'ajoute cependant une donnée nouvelle, tout aussi préoccupante bien qu'encore mal évaluée et diversement perçue selon les observateurs : celle au contraire d'une attitude confessionnelle militante et intransigeante, refusant toute légitimité à un enseignement abordant de quelque façon que soit les faits religieux dans le cadre des programmes et de la laïcité scolaire. Déficit de culture ou indifférence religieuse pour les uns, excès de certitudes ou blocages fondamentalistes pour les autres, avec toutes les incompréhensions que ces configurations engendrent entre ces différents types de population scolaire. L'enseignement public, s'il veut assumer sa responsabilité en ce domaine, comme l'y engage le Rapport Debray et les récentes initiatives ministérielles, se trouve dès lors confronté à deux exigences contradictoires : donner aux uns les connaissances nécessaires pour comprendre le monde dans lequel ils vivent, aider les autres à prendre un peu de recul face aux discours identitaires, l'une et l'autre dans le respect des consciences et le souci d'éducation à une citoyenneté respectueuse de l'autre. De plus, les principes mêmes de la laïcité imposent aux enseignants une démarche singulièrement exigeante, qui consiste à aborder les croyances et les pratiques religieuses avec l'objectivité critique propre à toute démarche scientifique, tout en préservant leur spécificité et en évitant de présenter ce savoir scientifique - parfois encore hypothétique - comme une entreprise de démolition des traditions religieuses et des convictions des élèves. La tâche, on le sait, n'est pas aisée. L'étude critique des religions, qu'il s'agisse du questionnement philosophique ou de la recherche en sciences humaines, conduit bien à une déconstruction des discours traditionnels, à une dissociation entre savoir et croyance, à un déplacement du sens qui peuvent être déstabilisants pour des élèves en quête d'identité et de repères sûrs. C'est dire que, s'il y a un défit à relever dans l'enseignement des faits religieux dans le cadre de l'enseignement public, il est essentiellement d'ordre pédagogique. 5 Par cette situation singulière, l'enseignant se trouve au coeur même du conflit herméneutique suscité par l'affrontement des religions à la modernité. Depuis la Renaissance et l'émergence d'un savoir critique indépendant de la théologie, le rapport entre les religions concernées et la modernité a été, et demeure encore à bien des égards, conflictuel. Nous entendons ici la modernité de façon très classique comme la résultante de quelques traits culturels majeurs : l'affirmation de l'autonomie du sujet, l'avancée de la rationalité scientifique et la différenciation des institutions, l'ensemble conduisant progressivement, à travers le processus de la sécularisation, à la marginalisation des religions instituées. Il ne s'agit là, bien sûr, que d'un schéma théorique, qui appelle des nuances et des corrections qu'apporteront plusieurs auteurs du présent volume. L'Université d'automne qui s'est tenue à Guebwiller en Alsace du 27 au 30 octobre 2003, organisée à l'initiative de l'IUFM d'Alsace et de son directeur Mark Sherringham, avec le soutien énergique du Recteur de l'Académie de Strasbourg Gérald Chaix et de la Direction de l'Enseignement scolaire, ambitionnait d'aborder ces questions sous la forme d'une session nationale de formation offerte aux inspecteurs, enseignants et autres acteurs de l'Éducation nationale. Il s'agissait de mettre en lumière différents aspects du rapport des religions à la modernité - essentiellement ici les trois monothéismes présents en France -, afin de mieux cerner les enjeux pédagogiques qui viennent d'être évoqués. Ce sont les actes de cette Université d'automne qui sont ici publiés et proposés à la lecture d'un plus large public. La plan de l'ouvrage respecte dans ses grandes lignes le programme de la session, distribuant les contributions selon trois problématiques majeures : - En premier lieu, le discours critique sur les religions, illustré par quatre contributions représentatives des approches philosophique, historique et sociologique des faits religieux. L'exposé des principes herméneutiques et des problématiques qui conduisent ces diverses disciplines met en évidence le décalage entre le discours religieux traditionnel et sa déconstruction critique. - Un deuxième thème envisage la place des religions dans la société sécularisée à travers des points de vue divers et originaux : une interrogation philosophique de la notion même de sécularisation des sociétés ; une recherche historique dans l'art contemporain sur la sécularisation d'un motif religieux ; une mise au point minutieuse sur la situation sociale de l'islam en France, illustrant toute la complexité des rapports d'une religion plurielle et minoritaire avec une société sécularisée ; enfin, c'est la place réservée aux religions dans les États moderne qui est évoquée à travers un exposé synthétique de la situation juridique des religions dans les différents États de l'Union européenne. - Le dernier thème de ce triptyque aborde de front l'attitude des religions face à la modernité depuis le XIXème siècle. Attitudes diverses et contrastées, faites, selon les temps et les communautés, de rejets, de crispations ou au contraire d'adaptations à la modernité, de volonté d'intégration à la société démocratique, de sécularisation ou d'aggiornamento interne, de stratégies de reconquête, etc.. Ces divers positionnements ad extra s'accompagnent souvent de vifs débats internes, voire de déchirements. Ces questions ne constituent pas seulement un important champ de recherche de l'historiographie et de la sociologie contemporaines, elles se trouvent à l'arrière-plan de bien des 6 conflits actuels, et définissent - souvent de manière implicite - les attitudes qui rendent, précisément, l'enseignement des faits religieux si complexe et délicat. A treize conférences s'ajoutaient une dizaine d'ateliers et trois tables rondes. Il n'est pas apparu opportun de les reproduire ici dans leur totalité ni sous leur forme initiale, plusieurs d'entre eux reprenant des thématiques déjà abordées dans des sessions analogues. Un choix a donc été fait, de manière à éviter les redondances avec les conférences magistrales et à offrir, en guise de « perspectives pédagogiques « et en annexe, quelques éléments documentaires en histoire, en droit, en littérature et en philosophie, qui recouvrent en même temps les champs religieux considérés dans cette session. Les intervenants sollicités pour cette université d'automne, issus principalement du milieu universitaire régional, se sont pliés de bonne grâce aux demandes qui leur étaient faites et ont présenté des contributions originales alliant - les lecteurs en jugeront - un très haut niveau scientifique à d'excellentes qualités pédagogiques. J'ai plaisir ici à les en remercier très vivement, ainsi que de la disponibilité dont ils ont fait preuve pour permettre une publication rapide de ces actes en dépit d'emplois du temps souvent surchargés. Je remercie également Pascal Ménoret, agrégé de philosophie et chargé d'études à la Direction de l'Enseignement scolaire, de sa précieuse collaboration à la mise en forme de cet ouvrage. Enfin, je renouvelle les remerciements des organisateurs de cette Université d'automne au personnel de l'IUFM d'Alsace à Guebwiller qui en a assuré avec compétence et amabilité la logistique administrative, à la grande satisfaction de tous les participants. 7 Introduction 8 Introduction Dominique Borne, doyen de l'Inspection générale de l'Éducation nationale Pourquoi parler du fait religieux ? Je commence tout naturellement par la question préalable : pourquoi enseigner le fait religieux ? Mon propos n'est pas neuf, mais il convient cependant de répéter qu'on enseigne le fait religieux parce qu'il permet de mieux comprendre le monde contemporain. Il y a vingt ans, cette affirmation n'était certainement pas une évidence. On pensait que la sécularisation des sociétés allait se poursuivre : la tendance était plutôt à la disparition des cornettes et des soutanes qu'à l'apparition du voile. On se plaçait dans un cycle très long de sécularisation, un cycle qui remonte sans doute à la Renaissance, et l'on était arrivé, croyait-on, au bout de ce processus. Or il n'y a pas un, mais deux processus simultanés : la sécularisation continue, mais, en même temps, il y a un choc du religieux ; les élèves ont besoin de clés pour comprendre cette double évolution. L'élection d'un pape polonais et la chute du Mur, par exemple, sont des événements qui appartiennent au même processus, même s'il ne s'agit pas de tracer un lien de causalité entre eux. De même, s'agissant de tout ce qui s'est passé autour de l'éclatement de la Yougoslavie, comment distinguer le national de l'ethnique ou du religieux : l'expression « purification ethnique « est-elle équivalente de l'expression « purification religieuse « ? Il faudrait méditer tous ces problèmes, car le religieux était bien présent dans l'explosion de la Yougoslavie. On a même découvert à cette occasion qu'il y avait des musulmans en Europe depuis très longtemps, des musulmans qui n'étaient pas des immigrés, ce qu'on avait un peu oublié. Un autre phénomène, dans notre occident contemporain, touche également au religieux : une nouvelle forme de l'islam est apparue, d'autant plus violente qu'elle est en rupture avec l'islam pratiqué par la génération précédente. L'islam des parents des jeunes filles qui mettent des voiles est un islam très calme, très discret, alors que la jeune génération se reconnaît davantage dans un islam de rupture. Peut-être le voile aurait-il moins troublé au temps des cornettes : c'est peut-être parce qu'il n'y a plus de cornettes que le voile choque autant. La disparition du religieux que nous connaissions rend d'autant plus dérangeante l'apparition de nouvelles formes du religieux. Aurait-on oublié que, dans les années 1950 et 1960, une femme « en cheveux « était une femme de mauvaise vie ? Nous observons donc que le religieux est utilisé pour affirmer une identité, et c'est également une nouveauté, ou du moins un phénomène inhabituel, puisque les identités régionales en France n'ont à ma connaissance jamais mobilisé un lexique religieux pour s'affirmer ; elles ont plutôt utilisé l'appartenance linguistique. Aujourd'hui, au contraire, on voit des minorités utiliser le religieux pour 9 s'imposer. Le détour par le religieux n'est d'ailleurs pas l'apanage des minorités ; songeons aux discours des dirigeants américains et à leurs très fortes implications religieuses. Nous vivons dans un monde où le religieux prend des formes multiples, jusqu'à cacher des gestes manifestement politiques. Certains lisent le tragique événement de Manhattan, en septembre 2001, comme un phénomène religieux. Le religieux simplifie alors jusqu'à la caricature la lecture du monde. Si le religieux a fait irruption dans le monde contemporain de manière aussi forte, il faut bien que les élèves arrivent à en décrypter les signes, à trouver des ébauches de sens. C'est la première raison qui impose l'étude du fait religieux à l'école. La deuxième raison est repérée depuis quelques années déjà : il faut pallier la méconnaissance d'une partie du patrimoine de l'humanité. Le religieux, en Europe, sans oublier le mythologique gréco-romain, fait partie de ce patrimoine, en est la source d'inspiration constante. Une promenade récente dans le parc de Versailles m'a permis de vérifier que je n'identifiais les scènes mythologiques des sculptures qu'une fois sur deux seulement. Nous avons perdu la lecture de tout un pan du patrimoine. Nous habitons dans un décor dont nos élèves - et nous-mêmes parfois - ont perdu les clés. Il est très important de donner un sens au décor dans lequel nous vivons. Car au delà du patrimoine, ce sont nos lieux de vie qui sont encore pétris de signes religieux. Il faut apprendre aux élèves où ils habitent. Troisième grande raison : le religieux est un langage spécifique, sans doute assez proche du langage de l'art et donc de la poésie - du langage symbolique. Ainsi tous les poèmes de Victor Hugo comportent une dimension religieuse, le dit-on dans les classes ? Comment, dans ces textes, reconnaître le religieux ? comment l'analyser ? La place du religieux est évidente chez Victor Hugo, mais n'est-ce pas tout aussi présent dans la poésie de Baudelaire ? Une grande partie de notre littérature est pétrie de significations religieuses. Il s'agit donc d'identifier et de comprendre les signes du religieux, de les reconnaître dans un monument, une sculpture, dans un poème, dans un texte de philosophie. Le religieux est une catégorie de la connaissance, comme l'économique, le social ou le politique. Le religieux doit donc être inscrit dans un contexte global de connaissance, qui n'est pas seulement religieux, mais également littéraire, philosophique, historique. Le reconnaître, ce n'est pas l'isoler, mais lui donner sens dans un ensemble plus vaste. Alors il est possible d'aller de la forme au sens. Que veut dire cette église ? Pourquoi ce tympan ? Le déchiffrement du sens guide alors vers l'étude de la forme. Un des morceaux de bravoure des professeurs d'histoire de Cinquième était naguère le chapitre consacré à l'art roman et l'art gothique ; on décrivait les monuments, on expliquait que l'art roman était sombre et que la clarté caractérisait l'art gothique, on expliquait le triomphe de l'ogive, les plus téméraires dessinaient une croisée d'ogives au tableau... Alors, on ne pensait guère au sens, ce sens qui est tout simplement religieux. Le premier colloque de l'École du Louvre avait un 10 thème tout à fait éclairant : Forme et sens1. Forme et sens, c'est pour nous une orientation. Il faut partir de la forme pour aller au sens, et ne pas se contenter seulement de la forme en elle-même. Ainsi aborde-t-on la lecture des signes du religieux. Il y a donc trois grandes raisons - qui se croisent, bien sûr - d'aborder ces questions. Peut-être faudrait-il en esquisser une quatrième : enseigner le fait religieux, ce serait répondre à ce qu'on appelle une demande sociale. Je pose ce terme avec précaution. Cette demande est-elle mesurable ? Est-elle même légitime ? M'inquiètent quelquefois les propos entendus de parents inquiets : « Vous avez bien raison de réintroduire le fait religieux à l'école, ils seront plus sages et plus disciplinés... « La demande sociale serait-elle une demande de moralisation de l'École par l'intermédiaire d'une éthique religieuse ? Chacun voit les dérives possibles, les dangers de cette position. L'École enseigne appuyée sur des valeurs ; nous disposons d'une morale laïque, d'une éthique laïque, et nous n'avons pas besoin d'une autre morale. De quoi parle-t-on ? J'aimerais, maintenant, tenter de répondre à une deuxième question : « De quoi parle-t-on ? « La réponse à cette deuxième grande question est loin d'être une évidence. En raccourci, on pourrait dire qu'une religion est porteuse d'une vision, d'une vision explicative du monde, et d'une vision d'un audelà du monde. Bien souvent, d'ailleurs, l'art religieux tente de figurer cet au-delà du monde. On peut ajouter que cette vision du monde est le plus souvent gouvernée par de grands textes fondateurs. Cependant, ces affirmations, globalement acceptables pour les trois monothéismes, sont-elles valables en Asie ? L'exemple de la Chine est éclairant : il n'y a pas, au sens européen, de dieu(x) en Chine, il n'y a pas non plus véritablement de grands récits fondateurs ; il y a des livres, des textes, mais plus de sagesse que de fondation. En Chine, il n'y a pas d'au-delà du monde, mais plutôt un ensemble d'équilibres subtils entre les contraires. Dans ce cadre, peut-on parler de religieux ? Je n'en suis pas très sûr. Savons-nous parler du bouddhisme ? Peut-on englober les sagesses, ou parle-t-on uniquement des trois grandes religions ? Autre problème : au nom de quoi pourrions-nous distinguer un « vrai « religieux d'un « faux « religieux ? les enseignants sont-ils à même de qualifier les manifestations du religieux, les superstitions, la voyance, les horoscopes, tous les petits rites qui ont leur place dans la société ? J'appartiens à un comité interministériel de lutte contre les dérives sectaires - et on ne parle plus de « lutte contre les sectes «, mais de « lutte contre les dérives sectaires «, parce que la secte est parfois « la religion de l'autre «, comme chacun sait, et les religions sont souvent « des sectes qui ont réussi «, selon un autre mot célèbre. Le seul jugement possible doit se fonder sur les valeurs sur lesquelles nous nous appuyons : pour les dérives sectaires, le critère est l'autonomie du sujet : dès que, 1 Forme et sens. La formation à la dimension religieuse du patrimoine culturel, École du Louvre/La documentation française, Paris, 1997. 11 dans une communauté qui se dit religieuse, il y a perte de l'autonomie du sujet, on peut dire - avec infiniment de prudence - qu'il y a dérive d'une forme de religieux. Pendant longtemps, on a parlé de l'institué, c'est-à-dire des rapports entre l'Église et l'État. L'enseignement de l'histoire médiévale portait sur les conciles, sur les rapports entre le pape et l'empereur. Ensuite, à mesure que les liens se distendaient entre l'Église et l'État et que les Églises étaient rejetées dans la sphère privée par la sécularisation, on en parlait de moins en moins. Dans l'enseignement de l'histoire et dans celui des lettres, à partir du XVIIIème siècle, on parle beaucoup plus des Lumières que de la religion - qui existe néanmoins toujours dans les sociétés ; mais elle est expulsée du coeur de l'État, et, donc, on en parle moins. Après l'histoire de l'institué, il faut analyser la marque des religions, la trace qu'elles laissent dans les civilisations. Les religions marquent les civilisations, colorent les sociétés. Cette démarche nous situe dans le cadre de l'anthropologie historique dont l'un des historiens fondateurs, Alphonse Dupront, est aujourd'hui redécouvert et republié2. L'anthropologie du religieux analyse les gestes, les rites, la procession, le pèlerinage, par exemple. Dupront aimait parler de la « marque sacrale « par laquelle les religions marquent l'espace. L'anthropologie historique est la meilleure porte d'entrée pour parler scientifiquement de la religion. Inversement, dans les classes, une des plus mauvaises portes d'entrée serait une entrée par les dogmes ou par l'essence des religions, en dehors de toute contextualisation. Par quoi commencer ? C'est une question classique de la pédagogie. L'entrée par les dogmes ne peut être pertinente, car notre travail consiste à historiciser, à contextualiser, à situer dans un temps, dans une évolution. Le contexte, l'histoire imposent heureusement une approche critique. Par exemple, nous ne contextualisons pas suffisamment l'islam, tout simplement parce que nous ne savons pas le faire : voyez comment, pour enseigner l'islam, on revient toujours aux cinq piliers, sans se poser la question de savoir si cette approche est pertinente de Muhammad jusqu'à nos jours. On peine à placer l'islam dans une histoire. On sait, quand on parle du christianisme, qu'il y a le temps de l'Inquisition et le temps de Vatican II, et que ces deux temps diffèrent du tout au tout. On sait qu'il n'y a pas d'immuabilité, qu'il y a un déroulement dans le temps, que l'appréhension du religieux ne peut être identique dans la longue durée. Mais, s'agissant de l'islam, on a beaucoup de mal à opérer la même contextualisation, d'autant plus que l'islam le plus bruyamment visible s'affiche aujourd'hui comme un fondamentalisme. Et, comme tout fondamentalisme, il veut être un retour aux origines. J'ai assisté à des cours de Cinquième sur les débuts de l'islam, et le professeur semblait enseigner l'immuable. Oublier que nous sommes dans une histoire, c'est ne pas comprendre ce que nous devons faire dans une école laïque, parce que lorsqu'on oublie l'histoire et qu'on se place dans l'incréé, dans l'éternel, dans le monde des essences pures, on n'est plus dans la laïcité. 2 Cf. Alphonse DUPRONT, Du sacré, Gallimard, Paris, 1987 ; Puissances et latences de la religion catholique, Gallimard, 1993 ; Le mythe de croisade, 4 vol., Gallimard, Paris, 1997. 12 Je crois également qu'il faut se défier de la tendance naturelle à partir toujours du modèle judéochrétien que nous avons intériorisé. Ce modèle pose en préalable la distinction du civil et du religieux, du temporel et du spirituel. Il le pose d'ailleurs dès l'origine : l'Évangile fonde la laïcité par la distinction entre Dieu et César ; dans le christianisme, une figure du temporel équilibre toujours une figure du spirituel, comme l'écrivait Victor Hugo, ces deux moitiés de Dieu, le Pape et l'Empereur. La séparation de l'Église et de l'État est un schéma judéo-chrétien dont nous avons parfois un peu de mal à nous défaire pour comprendre les islams, car ils ne posent pas de la même manière la question du rapport entre le spirituel et le temporel. Et je dis bien les islams, parce qu'il y a des islams qui diffèrent considérablement dans le temps et l'espace ; lorsque les cartographes figurent en vert uniforme tous les pays musulmans, ils oublient qu'entre l'islam des pays arabes et l'islam indonésien ou pakistanais par exemple, il y a d'immenses différences. Pour savoir que dire il faut donc contextualiser non seulement dans le temps mais aussi dans l'espace. Comment enseigner le fait religieux ? Une fois ces précautions prises, comment enseigner le fait religieux ? Les programmes du collège, publiés à partir de 1995 en histoire, recommandent déjà de partir des textes et des oeuvres. Lors du colloque sur L'enseignement du fait religieux3, Régis Debray a émis la même recommandation, et cette rencontre de Guebwiller est construite à partir d'une démarche analogue. Partir des textes, partir des oeuvres : c'est pour mettre en oeuvre cette pédagogie que les professeurs ont besoin de formations approfondies. L'expérience des classes montre quelques insuffisances. J'ai encore en mémoire une leçon d'histoire sur les débuts du christianisme pendant laquelle le professeur faisait lire un petit extrait des Actes des Apôtres pour en tirer d'immédiates conclusions historiques, et d'extrait en extrait construisait ainsi l'histoire à partir d'un texte révélé. Il faut ajouter que, sur ce problème, les manuels n'aident pas toujours les enseignants à aborder comme il le faudrait les documents. Ces documents, en effet, ne peuvent être traités comme les autres. Les Évangiles, par exemple, ne sont pas une source documentaire sur la vie du Christ ; lorsqu'on lit dans les Évangiles : « Jésus alla de Galilée en Samarie «, aucune autre source ne permet de vérifier la vérité de cette assertion. Mais on peut s'arrêter sur ce constat ; il renvoie à la spécificité du document : les Évangiles ne sont pas une source qui permettrait de construire l'existence historique de Jésus, mais ces mêmes Évangiles constituent une source essentielle concernant les croyances des chrétiens. En ce sens, ils sont une source historique majeure. Les récits de la vie de Jésus que les Évangiles rapportent ne sont qu'un support symbolique qui permet de construire des croyances et des rites. C'est cela qu'il faut expliquer aux élèves, sans pour autant mettre en cause les croyances personnelles de chacun. On sait bien, d'ailleurs, que les savants ou les archéologues qui ont cherché à « prouver que la Bible a raison « ou 3 Cf. Régis DEBRAY, Dominique BORNE, Jean BAUBEROT et Emile POULAT (dir.), L'enseignement du fait religieux, coll. « Les Actes de la DESCO «, CRDP de l'académie de Versailles, 2002. 13 « que la Bible a tort «, sont passés à côté de la véritable démarche scientifique, parce qu'ils n'ont pas voulu reconnaître le caractère symbolique des textes. Les mêmes remarques valent pour l'Odyssée : le périple d'Ulysse en Méditerranée est aussi de l'ordre du symbolique, il dit autre chose que la littéralité du texte. Rechercher des lieux réels qui correspondraient aux voyages dans l'imaginaire est donc une démarche vaine. Homère comme les Évangélistes sont dans un autre registre. Il faut également se soucier de mettre en évidence ce qui, dans le religieux, rassemble. Il est à cet égard étonnant que le personnage d'Abraham ne soit pas plus présent dans les enseignements et dans les manuels, car il est commun aux trois monothéismes ; le sacrifice d'Isaac pour les juifs, le sacrifice d'Ismaïl pour les musulmans sont également fondateurs. Au XIIème siècle, le philosophe juif Maïmonide disait qu'Abraham est la colonne sur laquelle repose le monde. Et, dans la société française qui est la nôtre, dire à des élèves que nous sommes tous fils d'Abraham ou d'Ibrahim est important et fort. Je n'insiste pas, enfin, sur la force des images, mais je pense simplement qu'elles pourraient être mieux utilisées. A Strasbourg, les porches de la cathédrale donnent à voir un univers spirituel, une piété, des rites. Tout Alsacien devrait pouvoir expliquer le face à face des deux statues de la Synagogue et de l'Église. Au Musée de l'Oeuvre Notre-Dame, les Vierges à l'enfant et les Piétas disent tout le christianisme : la face joyeuse et la face sombre, l'espoir et le désespoir. De telles images offrent des possibilités multiples si on sait les contextualiser, ce qui n'est pas toujours le cas, même dans les musées. Un jour, au Louvre, un conservateur nous montrait ce qu'on appelle une « chapelle «, c'est-à-dire en fait l'ensemble du mobilier portatif d'autel ; l'étiquette de présentation indiquait seulement : « Chapelle du Duc de Bourgogne «, ce qui rendait l'oeuvre difficilement compréhensible. Le même problème se pose dans certaines églises, lorsque par exemple des curés modernistes ont ôté les reliquaires, laissant des niches vides dont plus personne ne comprend le sens. La présentation esthétique, comme au musée, des reliquaires dans le déambulatoire de la Basilique Saint-Sernin de Toulouse efface le sens, ne permet guère de comprendre le pèlerinage, l'émotion sacrée devant les reliques, les figures de la dévotion. C'est le problème des oeuvres et du sens, du passage de l'église au musée : Régis Debray dit souvent que pour éprouver des frissons esthétiques, il ne faut plus aller dans les églises mais dans les musées. La place du religieux dans le patrimoine national et communautaire européen Deux points enfin, pour toucher des problèmes difficiles. D'abord, la place du religieux dans le patrimoine national : autrement dit, comment fonctionnent les rapports entre le national et le religieux ? Personne ne conteste que, par exemple, Jeanne d'Arc n'appartient à personne, ou ne devrait appartenir à personne : la République a même placé la bergère lorraine dans le Panthéon républicain, la canonisation de 1920 ayant permis de refermer l'épisode douloureux de la Séparation et de la loi de 1905. Autre exemple : les cathédrales, qui en France appartiennent à l'État, relèvent à la 14 fois du patrimoine religieux et du patrimoine national ; songeons à Chartres, à Reims, à Notre-Dame de Paris... Quelle place donner au religieux dans le patrimoine national ? Le problème prend une nouvelle actualité quand une partie de la population ne reconnaît pas « son « religieux dans le patrimoine national : je pense bien sûr aux musulmans. C'est là un des vrais problèmes de l'intégration. Être Français, c'est adopter le patrimoine, l'histoire et les mythes de la nation française ; être Français, c'est adopter les Gaulois comme ancêtres ; c'est connaître et se reconnaître dans une mémoire commune, Vercingétorix, Jeanne d'Arc, Reims, Versailles, 1789, Jaurès et Clemenceau. Mais où est l'islam dans ce patrimoine ? Comment dire à une communauté : « Vous êtes Français « - et ils sont Français -, alors que le patrimoine national ne contient pas de référence culturelle à leur identité ? C'est là un réel problème national, et c'est pour cette raison qu'il faut que l'islam soit visible, que l'islam sorte des caves et des garages et qu'on construise des mosquées ; il faut rendre l'islam visible dans le paysage, à côté des cathédrales, des églises et des évêques. Il y a deux ans, nous avons organisé une Université d'été sur le thème : « Europe et islam, islams d'Europe4 «, pour montrer justement que l'islam était en Europe, que l'islam n'était pas seulement l'autre de l'Europe - car le drame serait de faire une analyse constante en disant que l'islam est l'autre de l'Europe. Certes, je n'ignore pas que l'on se pose en s'opposant et que l'Europe s'est construite, dans la deuxième moitié du dernier siècle, sur l'opposition Est-Ouest ; l'autre, c'était l'au-delà du mur. Actuellement, cet autre a disparu et le risque serait de voir en l'islam cet autre de l'Europe. L'islam est en Europe, pleinement en Europe, non seulement en Yougoslavie, mais aussi en Allemagne avec les communautés turques, en Grande-Bretagne avec les communautés pakistanaises, et chez nous avec les communautés nordafricaines. Et j'espère bien que l'on cessera, un jour, de désigner « les immigrés « ; Dominique Schnapper dit très justement qu'on n'hérite pas de l'immigration. Ceux que l'on nomme encore trop souvent les « immigrés « sont Français ; mais pour qu'il se sentent, pour qu'ils se vivent Français, ils doivent reconnaître dans le patrimoine et la mémoire française quelque référence à leurs identités. Fait religieux et laïcité Enfin, quelques mots sur la laïcité. Et je ne parle pas de laïcité pour équilibrer mon propos : un peu de laïcité pour « faire passer « l'étude du fait religieux ? Ce serait absurde. L'approche du fait religieux à l'École est naturellement scientifique et critique : elle n'a nul besoin d'alibi ou de paravent. La laïcité, ce sont les valeurs de la République : il faut l'affirmer tranquillement. Ces valeurs s'enracinent d'abord dans la Déclaration des Droits de 1789 et dans son article premier : « Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. « 4 Cf. Dominique BORNE, Bruno LEVALLOIS, Jean-Louis NEMBRINI et Jean-Pierre RIOUX (dir.), Europe et islam, islams d'Europe, coll. « Les Actes de la DESCO «, CRDP de l'académie de Versailles, 2002. 15 L'un des principaux problèmes que nous pose la notion de laïcité, c'est la relation dialectique, et parfois conflictuelle, entre l'égalité et la liberté. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit, et précisant les libertés, l'article 10 de la Déclaration des Droits stipule que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public «. Autrement dit, la liberté d'expression religieuse est une donnée constante, elle est symboliquement rappelée en tête de la loi de Séparation de l'Église et de l'État. En voici l'article premier : « La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice du culte «, s'il ne trouble pas l'ordre public. C'est ainsi qu'on ne peut interdire une procession (ou les sonneries de cloches) que si l'on estime qu'elle empêche ou gêne la circulation. Hors de ces considérations d'ordre public, la loi garantit la libre expression, y compris dans les établissements scolaires. Je cite ici la loi Debré de décembre 1959 : « Suivant les principes définis par la Constitution, l'État assure aux enfants et aux adolescents, dans les établissements publics d'enseignement, la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes, dans un égal respect de toutes les croyances. L'État proclame et respecte la liberté de l'enseignement et en garantit l'exercice dans les établissements privés ouverts. Il prend toutes les dispositions utiles pour assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse. « Ce texte, on ne le cite malheureusement jamais. De même, la loi fondatrice de l'enseignement privé enjoint de respecter une symétrie entre le public et le privé. Dans les établissements privés, l'enseignement est dispensé selon les instructions de l'État et contrôlé par lui. La différence porte sur l'établissement, son « caractère propre «. Quel est le fondement de la laïcité ? C'est l'égalité d'éducation telle qu'elle a été posée en principe par Condorcet, puis Jules Ferry, et constamment réaffirmée jusqu'à aujourd'hui. Pour assurer cette égalité, c'est l'État - et non pas les familles ou les églises - qui prend en charge l'éducation et garantit l'accueil de tous. La laïcité ne consiste pas à refuser des élèves, mais consiste à accueillir tous les élèves. L'égalité citoyenne que garantit l'École implique que chacun ait le droit d'exprimer ses croyances, tant qu'il ne cherche pas à faire du prosélytisme. La très célèbre lettre de Jules Ferry aux instituteurs dit fort bien que la République distingue deux domaines trop longuement confondus : celui des croyances, qui sont personnelles, libres et variables, et celui des connaissances, qui sont communes et indispensables à tous - et ce sont ces connaissances qui permettent de faire des citoyens. Il ne s'agit pas, en enseignant le fait religieux, comme certains le croient, de « ré-enchanter le monde «, tout simplement parce que l'École n'a pas vocation à réintroduire le spirituel. En revanche, l'École a le devoir de respecter le spirituel, qui est peut-être dans chaque élève. La part de la personne, la part du privé, chacun y a droit - et en disant cela, on est en pleine laïcité, car cette part de privé peut prendre la forme de croyances. Mais l'École construit des citoyens qui obéissent tous aux mêmes lois. Et les enseignants doivent faire en sorte que ces citoyens soient instruits. 16 Introduction Gérald Chaix, Recteur de l'académie de Strasbourg Dans ce propos introductif, j'adopterai successivement trois attitudes. La première, bien sûr, est une attitude de Recteur. C'est en tant que Recteur de l'académie de Strasbourg que j'ai le plaisir de vous accueillir au début de cette Université d'automne pour étudier l'enseignement du fait religieux dans. J'y reviendrai, bien sûr. Deuxièmement, je parlerai en tant qu'historien, et en tant qu'historien conscient - et je suis entouré par deux autres historiens - que l'enseignement du fait religieux n'est absolument pas l'apanage des historiens, et qu'il importe depuis quelques années, et en particulier au lendemain du rapport Debray, de prendre conscience qu'il faut approcher de façon plurielle le fait religieux. Je suis très heureux de voir que d'autres disciplines sont déjà fortement représentées, notamment la philosophie et les disciplines littéraires. La troisième posture, bien sûr, c'est celle de l'enseignant confronté à la question de l'enseignement du fait religieux dans l'École laïque et républicaine. De quelle signification cet enseignement est-il porteur ? A quelle condition peut-on et doit-on enseigner le fait religieux qui, je le rappelle, n'est pas une discipline en tant que telle, mais qui consiste à traiter dans nos disciplines propres un phénomène qui traverse nos sociétés ? Premièrement, je voudrais dire que l'enseignement du fait religieux fait l'objet d'un développement dans le projet d'académie - un projet qui vient tout juste d'être élaboré, puisque le document que je brandis a été imprimé vendredi dernier et ne passera devant les instances consultatives de l'académie qu'en novembre. Ce projet est organisé en cinq axes, chaque axe ayant trois objectifs - le projet comprend donc quinze objectifs. Si je prends le dernier objectif, dans le cinquième axe (« Conforter et intensifier l'action de l'Académie dans trois domaines prioritaires «), je lis : « Prendre en compte les multiples dimensions des pratiques culturelles : science et technique, art et littérature, pratiques corporelles et sportives, religions et sociétés. « Dans le projet d'Académie, donc, l'acquisition des langages fondamentaux fait l'objet de l'objectif 1 ; l'enseignement du fait religieux relève de l'objectif 15 : il est en quelque sorte l'oméga de ce projet d'Académie, et un oméga véritable, puisque l'ensemble des objectifs ont distingué un certain nombre d'actions, et que deux actions sont consacrées à l'enseignement du fait religieux, l'action 69 et la dernière action, l'action 70. L'action 69 : « Prendre en compte le fait religieux dans toutes ses dimensions, historique, culturelle et sociale, pour favoriser la tolérance et l'ouverture à l'autre «, est pilotée par Marcel Spisser, IA-IPR d'Histoire-Géographie ; l'action 70 : « Mieux intégrer le fait religieux dans les enseignements pour enrichir la culture générale «, est pilotée par Jean-Marie Husser, professeur à l'Université Marc Bloch de Strasbourg. 17 Ce projet d'Académie s'intègre d'abord dans une politique nationale ; le Doyen Dominique Borne en parlera plus longuement que moi, mais je crois qu'il faut rappeler que l'enseignement du fait religieux n'est pas une lubie de l'Académie de Strasbourg, mais constitue bel et bien l'un des éléments d'une politique nationale, marquée il y a une quinzaine d'années par le rapport Joutard, dans un premier temps, par le rapport Debray, plus récemment, et par la mise en place, au lendemain de la définition d'une stratégie pédagogique, d'un Institut européen d'histoire des religions. Et cette politique nationale entend réfléchir sur le fait religieux, me semble-t-il, dans une triple perspective. La première fut la prise de conscience des années 1980, avec la remise du rapport Joutard, que le fait religieux, le vocabulaire même qui nous permet d'aborder le fait religieux dans nos cours, quelle que soit la discipline que nous enseignons, était en train de disparaître, parce que de fait, les référents culturels n'étaient plus présents, la transmission d'un type de savoir n'était plus assurée par les institutions (la famille, éventuellement les Églises) qui auparavant assuraient cette transmission, et que l'école avait, dans une vocation en quelque sorte patrimoniale, le souci de transmettre cette connaissance, ne serait-ce que pour comprendre les bâtiments que nous avons en face de nous, ou même de comprendre pourquoi l'IUFM de Guebwiller est installé dans la résidence des princes-abbés de Murbach : qu'est-ce que ça veut dire qu'un abbé soit prince, etc. La deuxième perspective de l'enseignement du fait religieux est peut-être la démarche culturelle : il s'agit ici de comprendre le rôle que le religieux a joué dans les sociétés, ou joue encore dans des sociétés contemporaines de la nôtre, à la fois comme structurant ces sociétés et organisant le lien social - vous savez que c'est l'une des étymologies possibles du mot religio -, mais aussi, éventuellement, donnant sens à la vie des gens, entre un ici-bas et un au-delà ; de comprendre ce qui dans des sociétés traditionnelles, ou dans des sociétés contemporaines est encore aujourd'hui un élément structurant du fait social. Enfin, le troisième point dans l'enseignement du fait religieux est l'approche anthropologique du fait religieux. Qu'est-ce que la dimension anthropologique (qui n'est pas une dimension donnée en soi, qui est un fait culturel bien sûr, un fait historique que l'on retrouve dans un certain nombre de sociétés) du fait religieux ? Ces trois éléments, que je nommerai le fait lexical, le fait culturel et le fait anthropologique, sont, je crois, les trois axes d'une approche possible du fait religieux, une approche qui se fait dans l'école laïque et républicaine, c'est-à-dire ordonnée aux valeurs de la laïcité, et, d'autre part, fondée sur une démarche scientifique, rationnelle, sur le souci comparatiste et le souci d'une mise en perspective du fait religieux. On a rappelé la distinction entre l'enseignement du fait religieux d'un côté, l'enseignement de la religion de l'autre, ce qui, dans l'académie de Strasbourg, est évidemment une dimension particulière, compte tenu de son histoire. Mais l'enseignement du fait religieux est aussi, deuxièmement, une politique académique. Pour trois raisons, me semble-t-il. 18 La première raison est une demande largement liée au caractère polyculturel de notre académie - ce qui n'est pas propre à notre académie mais est peut-être plus sensible ici, en raison de la présence très forte des trois religions du Livre : monde chrétien d'un côté, avec ses divisions confessionnelles - vous savez que l'Alsace est une terre de catholicité et des différents courants protestants, luthériens comme réformés ; monde juif de l'autre, avec une présence très forte, peut-être pas quantitativement mais en tout cas historiquement et culturellement ; enfin une présence très forte de l'islam, avec notamment deux grandes communautés, turque d'un côté, maghrébine de l'autre. Je crois qu'il y a là une demande à laquelle nous devons être très sensibles. La deuxième raison a trait au statut spécifique de l'académie de Strasbourg, en raison du droit local, qui n'a bien entendu rien à voir avec le fait religieux (d'autres Académies qui ne connaissent pas ce droit local s'interrogent aussi sur l'enseignement du fait religieux), mais qui donne à notre académie, pour des raisons historiques, pour des raisons culturelles, une dimension tout à fait particulière, quel que soit d'ailleurs l'avenir de ce statut spécifique à la région Alsace, et au département de Moselle, pour l'académie voisine de Nancy-Metz. Enfin, la troisième raison est la situation triplement privilégiée de notre Académie. Privilégiée du côté universitaire - et je remercie tout particulièrement le professeur Jean-Marie Husser d'avoir été l'une des chevilles ouvrières de l'organisation de cette Université d'automne -, car nous avons la chance d'avoir une Université dans laquelle la réflexion sur le fait religieux est menée dans une démarche très plurielle, puisque nous avons à la fois deux facultés publiques de théologie, une faculté de théologie catholique, une faculté de théologie protestante, mais aussi toute une équipe de recherche qui travaille sur le fait religieux, notamment dans l'UFR des Sciences historiques. Si notre académie est privilégiée, c'est, deuxièmement, pour la richesse documentaire et le patrimoine : nous avons la chance d'avoir, à côté de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, la bibliothèque universitaire CADISTE, c'est-à-dire le Centre d'acquisition, de documentation et d'information scientifique et technique, bibliothèque spécialisée dans le fait religieux. C'est à Strasbourg que s'achètent, toutes religions confondues et toutes approches confondues - philosophique, sociologique, historique, artistique - les ouvrages sur le fait religieux, que vous pouvez ensuite, où que vous soyez, faire venir par le prêt inter-bibliothèques. Enfin, notre IUFM s'est doté d'un corps d'enseignement et je crois qu'il a le projet de faire venir un second maître de conférences plus tourné vers la philosophie de la laïcité, pour bien tenir les deux aspects, religion d'un côté, laïcité de l'autre, de façon à offrir aux enseignants les moyens de leur réflexion et de leur pratique pédagogique dans le domaine du fait religieux. Voilà ce que je voulais rappeler en introduction à cette Université d'automne, qui s'adresse à l'ensemble des collègues qui, en France, s'intéressent au fait religieux et qui s'intègre à la stratégie particulière de l'académie de Strasbourg pour les quatre années à venir - en ce sens, cette Université d'automne, en amont du projet d'académie, en constitue en quelque sorte les prolégomènes. J'ai rappelé, tout à l'heure, les deux grandes actions qui sont menées : favoriser la tolérance et l'ouverture 19 à l'autre d'un côté, enrichir la culture générale des élèves de l'autre, avec pour acteurs et partenaires associés d'un côté les équipes pédagogiques et éducatives, les corps d'inspection, l'IUFM et l'Institut européen des sciences des religions, enfin. Ces prolégomènes annoncent, je l'espère, des rencontres régulières, peut-être dans le cadre d'une autre Université d'automne, certainement dans le cadre de réunions régulières, en liaison avec le CRDP. Dans l'Académie de Strasbourg, en associant toutes les forces, de l'Université, de l'IUFM, du CRDP, du corps enseignant et des corps d'inspection, nous voudrions participer à cette réflexion nationale et académique sur l'enseignement du fait religieux. 20 I. Le discours critique sur les religions 21 La critique philosophique de la religion au XVIIIème siècle. Mark Sherringham, Directeur de l'IUFM d'Alsace Le XVIIIème siècle européen a eu l'ambition de penser d'une façon nouvelle les rapports de la raison avec le christianisme en particulier, et les religions en général. Cet effort audacieux de remise en question et de clarification est inséparable de l'entrée dans une nouvelle phase du processus de constitution de notre modernité, qui n'a pas été sans affrontements ni polémiques, parfois d'une grande violence. Mais le siècle des Lumières s'est aussi montré capable de dégager, autour de la question de la religion, des principes, des problèmes et des essais de solution dont nous sommes, à plus d'un titre, les héritiers, et qui peuvent nous alerter, aujourd'hui encore, sur les impasses à éviter et les perspectives qui méritent d'être parcourues plus profondément. Le procès de Dieu L'ouvrage qui ouvre l'espace intellectuel du XVIIIème siècle dans son rapport à la religion est la Théodicée de Leibniz, paru en 1710. Voltaire ne s'y était pas trompé, puisqu'il tente à sa manière de le neutraliser à travers le récit des aventures imaginaires de son Candide. Mais, en réalité, si Voltaire s'oppose à Leibniz sur la solution, il partage avec lui la position du problème. Dieu se trouve convoqué devant le Tribunal de la raison humaine pour se justifier de l'existence du mal. Peu importe que l'accusé soit disculpé ou reconnu coupable, l'audace inaugurale réside bien dans la mise en accusation de Dieu. Ainsi le XVIIIème siècle, qui commence avec le procès de Dieu, culminera dans le procès du Roi. Dans les deux cas, il s'agit d'un procès politique et moral. Le Roi se trouve accusé d'avoir trahi la Révolution qu'il avait en apparence acceptée. Dieu se trouve accusé d'avoir mal gouverné le monde en autorisant le mal, alors que sa toute-puissance et sa sagesse auraient dû permettre de le rendre inutile et inexistant. La question du mal, à l'aube du XVIIIème siècle, au lieu d'interroger prioritairement l'homme, se retourne contre Dieu, qui est désigné, sinon comme son auteur, du moins comme son complice. Le lieu même de ce procès doit être souligné. Il s'agit bien de la morale ou de la politique, et pas d'abord de la science. Aux XVIIème et XVIIIème siècles, le sentiment de la solidarité entre l'existence de Dieu et la possibilité de la science de la nature reste largement partagé. Descartes exprime bien ce qu'on pourrait appeler l'opinion dominante des savants de son temps, et même du siècle suivant, quand il pose Dieu comme le garant des vérités éternelles et la condition de possibilité de la science de la nature. Bien sûr, les « libres-penseurs « du siècle classique et les philosophes « matérialistes « du 22 siècle des Lumières maintiennent vivante l'antique tradition épicurienne. Quant à Spinoza, posant au commencement de son Éthique l'identité de Dieu et de la nature, il retrouve, contre la science des modernes, la position grecque de la divinité de la nature. Mais majoritairement, les modernes, en science comme en philosophie, continuent de percevoir, par delà le procès emblématique de Galilée, à quel point le Dieu chrétien, délivré de son habillage grec et scolastique grâce à la Réforme protestante, rend théoriquement possible la science de la nature pour au moins deux raisons : la « dé-divinisation « de la nature qu'opère le retour à la séparation biblique de la création et du créateur, et la garantie divine de la régularité et de l'unité des lois naturelles, qui rend la connaissance de la nature accessible à l'esprit humain. C'est justement la prise au sérieux du motif biblique de la création, dans sa double dimension de séparation entre Dieu et la nature et de fondation de la nature sur l'intelligence divine, qui permet à Descartes d'énoncer l'ambition moderne : devenir « maître et possesseur de la nature «. En revanche, dans le domaine politico-moral, la gouvernance de Dieu va se trouver fondamentalement remise en question. Sans doute peut-on mieux comprendre ce processus si l'on se réfère, là aussi, au développement de la Réforme en Europe. Le protestantisme, grâce au retour à la vision biblique du monde contre la cosmologie et la physique héritées d'Aristote, auxquelles s'était parfois identifiée l'Église romaine, a globalement favorisé l'essor de la science moderne. Mais, dans le domaine moral, la Réforme contredit ouvertement la valeur humaniste de la liberté humaine, avec laquelle le catholicisme parvient plus facilement à transiger. C'est d'abord Luther qui s'oppose à Érasme avec son Traité du serf-arbitre, et c'est ensuite Calvin qui fonde l'interprétation stricte de la double prédestination sur le respect scrupuleux de l'Écriture Sainte. Le « scandale « de la prédestination, qui semble annuler tout le libre-arbitre de l'homme, me semble être la cause profonde du procès fait à Dieu par la raison moderne. Si tout dépend de la volonté divine, si l'humanité ne peut rien décider sans l'autorisation divine, si l'individu ne peut rien entreprendre qui ne soit déjà prévu par Dieu, ne devient-il pas logique et légitime de demander des comptes à un tel maître, de lui demander raison du mal qu'il autorise pour sa plus grande gloire ? La réaction contre le calvinisme, dans ce qu'il a de plus « réactionnaire « par rapport à la modernité, dans ce qu'il a de plus paradoxal par rapport à la liberté des modernes, alimente le procès de Dieu. Ce procès connaîtra trois phases : le premier moment est dominé par la réponse leibnizienne. Grâce à la distinction faite dans la Théodicée entre le mal métaphysique, le mal moral et le mal physique, Leibniz parvient à innocenter Dieu ou, en tous cas, à aboutir à un non-lieu. En aucune façon l'être divin ne peut être tenu pour la cause directe du mal physique et moral, même si, dans sa sagesse suprême qui veut le meilleur des mondes possibles, il est amené à autoriser une certaine quantité de ces deux types de maux, dans la mesure exacte où ils se révèlent indispensables à la réalisation du meilleur état possible de l'univers. Seul le mal métaphysique, c'est-à-dire l'imperfection et la limitation inhérentes à la notion même de créature, est la conséquence directe de la volonté de Dieu comme créateur du monde. Malheureusement le plaidoyer de Leibniz souffre de trois défauts majeurs. Tout d'abord, il abandonne la position chrétienne du « mystère « du mal, en faisant dépendre 23 l'innocence de Dieu de la nécessité paradoxale du mal qui trouve son fondement dans l'être divin luimême en tant qu'il a décidé de créer le monde et l'a voulu le meilleur possible. Si l'on suit Leibniz, la nécessité du mal est inscrite dans la bonté même de Dieu. Mais Leibniz abandonne également la position chrétienne du « scandale « du mal, qui doit demeurer toujours absolument injustifiable, et que seule peut vaincre la passion du Christ sur la croix. Enfin la solution leibnizienne, malgré sa finesse conceptuelle, résistera difficilement à l'ironie d'un Voltaire ou à l'incompréhension qui suit le tremblement de terre de Lisbonne. Commence alors un procès en appel, qui sera instruit par Hume. Dans ses Dialogues sur la Religion naturelle, qui paraissent en 1779 (mais qui ont été rédigés autour de 1750), Hume attaque à la fois la gouvernance de Dieu et son existence. Il y a donc radicalisation et généralisation de l'acte d'accusation. De la question de l'existence du mal, on passe à la question de l'(in)existence de Dieu. Par ailleurs, la gouvernance de Dieu n'est plus seulement examinée par rapport au mal moral, mais aussi par rapport à la cohérence et à l'unité du monde physique. De même que Hume avait sapé les fondements de la science moderne en s'attaquant au principe de causalité, ramené à une simple croyance fondée sur l'habitude, de même il s'attaque à la relation même de Dieu à la nature et au monde en critiquant la notion de finalité. En réalité, nous fait comprendre Hume, l'action divine sur la nature, « la marque de Dieu sur son ouvrage «, n'est pas aussi visible ou lisible qu'on veut bien le dire. La Religion naturelle, comprise comme la croyance en l'existence d'un Dieu créateur du monde, ne peut pas être prouvée à partir des caractéristiques de la nature ou de la raison humaine. Tout ce qu'on peut admettre est une « lointaine analogie « entre la raison humaine et la cause productrice de la nature : « Le tout de la théologie naturelle, comme quelques-uns semblent le soutenir, se résout en une seule proposition, simple, quoique assez ambiguë, ou du moins indéfinie, que la cause ou les causes de l'ordre de l'univers présentent probablement quelque lointaine analogie avec l'intelligence humaine [...]5. « Pour autant, Hume ne conclut pas à l'inexistence de Dieu, mais il se contente de relever le fait que le désordre moral et physique du monde rend l'affirmation de l'existence de son créateur assez difficile à percevoir. Au contraire, sa déconstruction sceptique des preuves de l'existence de Dieu se termine par un appel, qui n'est pas seulement ironique, même s'il demeure paradoxal, à la Révélation divine : « Mais croyez-moi, Cléanthe, le sentiment le plus naturel qu'un esprit bien disposé puisse éprouver en cette occasion, est une attente ardente et un vif désir qu'il plaise au ciel de dissiper, ou du moins d'alléger, cette profonde ignorance, en accordant à l'humanité quelque révélation plus particulière et en lui découvrant quelque chose de la nature, des attributs et des opérations du divin objet de notre foi. Toute personne pénétrée d'un juste sentiment des imperfections de la raison humaine se précipitera avec la plus grande avidité vers la vérité révélée6. « 5 HUME, Dialogues sur la Religion naturelle, trad. M. Malherbe, Vrin, Paris, 1987, p. 158. 6 Ibid. 24 La deuxième phase du procès de Dieu aboutit donc à ce que Hume appelle « un juste sentiment des imperfections de la raison humaine «. Le jugement de Dieu aboutit à la confirmation de la condamnation sceptique de la raison. Celle-ci doit reconnaître sa faiblesse et ses limites, du fait même de sa confrontation à un divin à la fois insaisissable et indécidable. On est loin du triomphe de la raison comme marque distinctive d'un optimisme des Lumières qui n'a sans doute jamais vraiment existé. Face à une nature incohérente, confrontée à une histoire qui voit trop souvent triompher la folie des hommes, sommée de s'expliquer avec un Dieu caché et incompréhensible, la raison est forcée de reconnaître sa faiblesse. Tel est le premier résultat du rationalisme sceptique de Hume. Le troisième acte du procès de Dieu - qui est aussi devenu le procès de la raison - commence avec Kant. En partisan affirmé des Lumières et en observateur attentif de son siècle, il perçoit parfaitement le danger. La justification de Dieu par la raison, à la suite de Leibniz ou de Locke, n'emporte pas l'adhésion, et tend à affaiblir la position de la divinité qu'elle visait pourtant à renforcer. Quant au questionnement sceptique de Dieu, à la suite de Hume, il aboutit au constat que la raison est amenée à faire de sa propre imperfection. Le bilan des Lumières apparaît alors comme bien peu satisfaisant, nous laissant le choix entre un Dieu affaibli et une raison épuisée. Pour échapper à ce dilemme, il convient de repenser le procès de Dieu sur de nouvelles bases. Devant le « Tribunal de la raison humaine «, Kant procède à un double retournement. En premier lieu, la charge de la preuve repose dorénavant sur la raison. Le tribunal kantien est d'abord ce lieu où la raison se juge elle-même. Il lui revient de définir ses propres limites. En examinant ce que Kant appelle, dans sa Critique de la raison pure, la « dialectique de la raison «, il devient évident, si du moins l'on accepte les prémisses kantiennes, que les trois types possibles de preuves de l'existence de Dieu (la preuve ontologique, la preuve cosmologique et la preuve physicothéologique) manquent nécessairement leur but à cause de la nature des facultés humaines de connaissance. C'est que Dieu n'est pas un objet possible de l'intuition sensible, et qu'il ne peut pas se comprendre à partir des catégories de l'entendement. Du point de vue de la raison théorique, il est précisément une « Idée régulatrice « ou un « Idéal «, mais en aucune façon l'objet d'une connaissance possible. De Dieu, la raison ne peut prouver, ni qu'il existe, ni qu'il n'existe pas. Mais l'aveu d'incompétence de la raison théorique devant la question de Dieu aboutit, paradoxalement en apparence, à l'affirmation de la toute-puissance du sujet humain de la connaissance par rapport à la nature. Si Laplace pourra affirmer que Dieu est devenu une hypothèse inutile, c'est justement parce que Kant avait installé le sujet transcendantal à la place du Dieu transcendant dans le rapport théorique ou scientifique à la nature. Si la raison théorique ne peut plus affirmer ou nier l'existence de l'être divin, elle devient la source unique de l'ordre et de l'unité de la nature connaissable. Dieu se trouve bien remplacé par la raison, mais la fonction divine par rapport à la connaissance scientifique de la nature demeure indispensable. La science de la nature ne peut pas se passer d'un garant. Le second retournement qu'opère Kant concerne la morale. A la mise en cause de l'être divin par l'existence du mal répond maintenant le postulat de l'existence de Dieu par la raison pratique ou la 25 volonté bonne. L'homme moral est en droit d'attendre de Dieu qu'il existe. Le bonheur qu'il peut légitimement espérer rend nécessaire le recours à l'Être suprême et à l'immortalité de l'âme. L'exercice de la liberté humaine, ou plutôt l'idée de la liberté de la volonté, fonde le besoin de Dieu qu'éprouve la raison. Celui-ci doit exister parce que l'homme est capable de moralité. Finalement, à travers ce double retournement, la philosophie critique aboutit à la justification pratique de l'existence de Dieu et à la limitation théorique de la raison humaine à la connaissance de la nature. Ce faisant, Kant donne raison à Leibniz sur l'innocence divine, mais sans avoir besoin de recourir à l'argument du meilleur des mondes possibles, c'est-à-dire en évitant à la raison humaine de se placer au point de vue de Dieu. Kant donne aussi raison à Hume sur l'impossibilité des preuves de l'existence de Dieu, mais sans mettre en question la capacité de la raison à connaître la nature. Le procès se termine par un accord qui scelle une séparation théorique et une solidarité pratique entre le divin et l'humain. Séparation et solidarité qui, dans l'esprit de la philosophie kantienne, laisse s'ouvrir une nouvelle ère de paix perpétuelle, délivrée des conflits qu'entraînent les positions philosophiques du dogmatisme et du scepticisme. A travers la « paix critique «, le XVIIIème siècle découvre que la raison humaine peut se vouloir à la fois indépendante et solidaire de l'Être suprême. La Révélation devant la Raison Se pose alors avec une urgence nouvelle la question du statut de la Révélation religieuse, c'est-àdire de la possibilité d'une relation à Dieu qui ne dépende pas de la raison des hommes. C'est la notion même de Révélation, ainsi que le contenu spécifique des dogmes chrétiens, qui vont se trouver mis en question. Le XVIIIème siècle lira avec avidité le Traité des trois imposteurs, dont l'origine demeure incertaine, puisqu'on l'attribue aussi bien à Frédéric II de Hohenstauffen que, plus récemment, à Spinoza ou à l'un de ses disciples. La notion de révélation s'y trouve entièrement ramenée à un projet politique de domination : « Les ambitieux, qui ont toujours été de grands maîtres en l'art de fourber, ont tous suivi la même route dans l'établissement de leurs lois. Pour obliger le peuple à s'y soumettre de lui-même, ils l'ont persuadé, à la faveur de l'ignorance qui lui est naturelle, qu'ils les avaient reçues ou d'un dieu ou d'une déesse7. « La démonstration de cette imposture des fondateurs de religion au service de leur ambition politique est faite successivement pour Moïse, Numa-Pompilius, Jésus-Christ et Mahomet. Tous apparaissent comme des précurseurs du Prince de Machiavel (même si le Christ rentre plus difficilement dans ce rôle), incarnations exemplaires d'une volonté de puissance hostile à la vie et à la vérité. De leur côté, Diderot, dans ses Pensées philosophiques de 1746 et son Addition de 1770, et Voltaire, dans son Dictionnaire philosophique de 1764, prennent le parti de mettre en évidence les « absurdités « de toute religion qui se prétend révélée, et du christianisme en particulier. Leurs armes essentielles sont l'ironie, la dérision ou l'indignation. Il n'est aucun des artifices des créateurs de 7 Traité des trois imposteurs, Max Milo Editions, Paris, 2002, p. 61. 26 religion en général, ni des dogmes ou des articles de foi de la religion chrétienne, qui ne se trouvent pris d'assaut et dénoncés sans pitié. Ainsi Diderot : « Tous les peuples ont de ces faits, à qui, pour être merveilleux, il ne manque que d'être vrais ; avec lesquels on démontre tout, mais qu'on ne prouve point ; qu'on n'ose nier sans être impie, et qu'on ne peut croire sans être imbécile8. « Ainsi Voltaire : « Après notre sainte religion, qui sans doute est la seule bonne, quelle serait la moins mauvaise ? Ne serait-ce pas la plus simple ? Ne serait-ce pas celle qui enseignerait beaucoup de morale et très peu de dogmes ? celle qui tendrait à rendre les hommes justes sans les rendre absurdes ? celle qui n'ordonnerait point de croire des choses impossibles, contradictoires, injurieuses à la Divinité et pernicieuses au genre humain, et qui n'oserait point menacer des peines éternelles quiconque aurait le sens commun ? Ne serait-ce point celle qui ne soutiendrait pas sa créance par des bourreaux, et qui n'inonderait pas la terre de sang pour des sophismes inintelligibles ? celle dans laquelle une équivoque, un jeu de mots, et deux ou trois chartes supposées ne feraient pas un souverain et un dieu d'un prêtre souvent incestueux, homicide et empoisonneur ? celle qui ne soumettrait pas les rois à ce prêtre ? celle qui n'enseignerait que l'adoration d'un Dieu, la justice, la tolérance et l'humanité9 ? « Mais ce faisant, il faut le remarquer, Voltaire et Diderot n'inaugurent pas vraiment une ère nouvelle dans les relations entre la philosophie et les religions, même s'ils placent avec passion et éloquence le geste philosophique sous la bannière de la dénonciation de la religion. On assiste plutôt à la réactivation des éléments de polémique anti-religieuse déjà présents dans la philosophie grecque classique ainsi que dans la réaction païenne qui s'était développée, au début de l'ère chrétienne, autour de Celse, du néo-platonisme et des tentatives de restauration de Julien l'Apostat. C'est donc un très ancien fond de refus et d'indignation qui resurgit ici, et pas du tout le résultat d'un nouveau positionnement de la raison moderne ou du progrès intellectuel de la compréhension scientifique du monde. Au contraire, Diderot lui-même souligne que la science moderne contredit le « matérialisme «, et encourage la croyance d'origine chrétienne en un dieu créateur de la nature : « Ce n'est que dans les ouvrages de Newton, de Musschenbroek, d'Hartsoeker et de Nieuwentyt, qu'on a trouvé des preuves satisfaisantes de l'existence d'un être souverainement intelligent. Grâce aux travaux de ces grands hommes, le monde n'est plus un dieu : c'est une machine qui a ses roues, ses cordes, ses poulies, ses ressorts et ses poids10. « Comme chez Descartes, se maintient ici la solidarité moderne entre la création divine et le mécanisme de la nature. La nouveauté ne réside pas non plus dans l'accusation portée contre l'absurdité de la Révélation chrétienne aux yeux de la raison philosophique traditionnelle - c'était déjà un lieu commun de l'apologétique des Pères de l'Église. La part moderne de cette polémique réside 8 DIDEROT, OEuvres philosophiques, textes établis par P. Vernière, Garnier, Paris, 1964, p. 39. 9 VOLTAIRE, Dictionnaire philosophique, Garnier-Flammarion, Paris, 1964, p. 333-334. 10 DIDEROT, OEuvres philosophiques, op. cit., p. 17-18. 27 avant tout dans la reprise des arguments de Luther ou de Calvin contre le pouvoir des Papes, ainsi que de ceux de Bayle et de Locke en faveur de la tolérance dans le domaine de la foi religieuse. Dans cette perspective, à la dénonciation ancienne et passablement ambiguë de l'absurdité de toute Révélation vient s'ajouter l'appel plus proprement moderne à la lutte contre le pouvoir temporel et spirituel de Rome et à la tolérance de l'État en matière de religion. Toutefois, le XVIIIème siècle explore encore une autre voie dans sa volonté de rendre compte de la Révélation : il s'agit de la tentative de réduire celle-ci à son noyau rationnel. Là non plus, l'innovation n'est pas, en apparence, radicale. La question des relations de la raison humaine et de la Révélation biblique est posée depuis les Pères de l'Église, et nombreux furent ceux qui montrèrent l'accord profond de la raison et de la révélation, comme Saint Thomas ou Maïmonide. Cependant, il reviendra à Kant de porter à son point culminant l'ambition du XVIIIème siècle, non pas seulement d'harmoniser raison et révélation, mais bien d'inclure la Révélation chrétienne dans le cadre de la raison humaine, et plus précisément de soumettre complètement le dogme au libre examen de la raison. Dorénavant, ce n'est plus la Révélation qui est la « pierre de touche « de la raison, mais bien la raison qui prétend dicter ses lois à la Révélation. Dans l'un de ses derniers ouvrages, Le conflit des Facultés, publié en 1798, Kant résume la nouvelle relation de la philosophie et de la théologie qu'il appelle de ses voeux, en reprenant la formule célèbre : « On peut aussi, sans doute, concéder à la Faculté de Théologie l'orgueilleuse prétention de prendre la Faculté de philosophie pour sa servante, mais alors la question subsiste toujours de savoir si celle-ci précède avec la torche sa gracieuse Dame, ou si elle la suit portant la traîne [...]11. « Dans le contexte de la réaction contre les principes des Lumières, qui suivit en Prusse la mort de Frédéric II et qu'amplifia le déroulement de la Révolution française, Kant cherche à déterminer les rapports légitimes entre la Théologie et la Philosophie, de façon à assurer les droits de la raison humaine. Le conflit des deux Facultés à l'intérieur de l'espace de l'Université renvoie à la distinction de deux principes que Kant désigne comme « la foi d'Église « et « la foi religieuse «. La première repose « sur des statuts, c'est-à-dire des lois dérivant de la volonté d'un autre12 «. La seconde renvoie, au contraire, à « des lois intérieures qui peuvent se déduire de la raison propre de tout homme13 «. Cette distinction, qui permet d'opposer le travail du « docteur de la loi « à celui du « savant de la raison « dérive directement de la séparation, propre à la philosophie kantienne, des principes d'hétéronomie et d'autonomie. Le théologien accepte de placer la volonté de l'homme sous l'autorité d'un Dieu extérieur, le philosophe des Lumières pense la divinité comme la loi de la raison pratique qui s'inscrit tout entière dans l'intériorité de l'humain. 11 KANT, Le conflit des Facultés, trad. J. Gibelin, Vrin, Paris, 1973, p. 27. 12 Ibid., p. 38. 13 Ibid. 28 Ainsi compris, le concept kantien de la religion ne renvoie plus « au contenu de certains dogmes considérés comme révélation divine (ceci, c'est la théologie), mais à celui de tous nos devoirs en général en tant que commandements divins (subjectivement, de la maxime de s'y conformer comme tels)14 «. La religion est donc identique, dans son contenu, à la morale. Elle en diffère seulement par la forme, en ce qu'elle présente les lois de la raison pratique comme l'expression de la volonté divine, de façon à en faciliter l'accomplissement par la volonté humaine. Dans cette perspective, le christianisme est la foi d'Église qui « convient le mieux « à la religion de la raison. « Or, celui-ci se trouve, dans la Bible, composé de deux parties dissemblables : l'une, qui contient le canon, et l'autre l'organon ou véhicule de la religion ; le premier peut être appelé la pure foi religieuse (fondée sans statuts, sur la simple raison), et l'autre la foi de l'Église qui, tout entière, repose sur des statuts, exigeant une révélation, pour être regardés comme un enseignement et des préceptes sacrés15. « De cette définition du christianisme biblique se déduisent les principes philosophiques de l'exégèse scripturaire qui sont au nombre de trois : tout d'abord, les passages de l'Écriture qui contiennent des dogmes théoriques dépassant tout concept rationnel, comme la Trinité ou l'Incarnation, doivent toujours être ramenés à leur contenu rationnel - ici, par exemple, l'idée de la Personne et celle de l'Humanité. Contre l'horizon d'une Révélation imaginée comme un au-delà de la raison, Kant affirme l'immanence de la première à l'intérieur du cadre de la seconde, c'est-à-dire l'inscription de la Révélation dans les limites de la simple raison. Ensuite, il convient d'affirmer que la foi en des dogmes scripturaires n'a aucun mérite en soi. Dans la vraie religion (morale), le doute à propos du dogme n'est pas une faute. Seul compte l'agir conforme à la moralité. Contre la foi, Kant affirme l'unique valeur des « oeuvres «. Enfin, l'action humaine doit toujours être présentée comme résultant de l'usage particulier que l'homme fait de ses forces morales, sans recours à l'intervention divine. Contre la grâce divine, Kant soutient l'autosuffisance de la raison humaine. Ce faisant, il rompt ouvertement et délibérément avec la tradition de la Réforme, qui faisait résider l'essence du christianisme dans les trois principes de l'Écriture seule, de la foi seule, et de la grâce seule. Dorénavant, la raison seule doit prévaloir et se soumettre l'Écriture tout en congédiant la foi et la grâce. Ainsi s'accomplit la logique immanente de l'autonomie. Le compromis que propose Kant est finalement le suivant : la philosophie reconnaît le « noyau rationnel « de la révélation chrétienne, et la théologie reconnaît, pour sa part, la validité de l'interprétation philosophique des Écritures. Mais ce compromis demeure profondément instable. Presque immédiatement il sera contesté, du côté de la philosophie, par ceux qui, depuis le jeune Hegel de l'Esprit du christianisme et son destin jusqu'au Bergson des Deux sources de la morale et de la religion, préféreront placer l'essence du christianisme dans un « amour « qui transcende toute légalité morale. Quant à ceux qui accepteront la leçon kantienne de l'identité de la morale et de la religion, ils 14 Ibid., p. 38-39. 15 Ibid., p. 39. 29 n'hésiteront pas, comme Nietzsche, à en déduire la condamnation conjointe de la raison et de la religion au nom de l'affirmation de la puissance vitale. Enfin les théologiens eux-mêmes, d'abord tentés par cette offre de paix, seraient bien avisés de se demander ce qui subsiste de cette foi d'Église, qu'ils sont censés défendre, dans la religion de la raison. La généalogie de la religion Après Dieu et la Révélation, la philosophie des Lumières va devoir se confronter au concept même de religion. Dans l'Histoire Naturelle de la Religion, rédigée autour de 1750 et publiée en 1757, Hume distingue deux questions, « celle qui concerne le fondement de la religion dans la raison « et « celle qui concerne son origine dans la nature humaine16 «. La première fera l'objet des Dialogues sur la Religion naturelle. La seconde commande l'enquête généalogique sur la religion qui fait l'objet du premier ouvrage. La réponse qu'apporte Hume s'organise autour de deux axes. La religion en général est définie comme la croyance en une puissance invisible et intelligente qui agit dans les oeuvres de la nature, ainsi que dans les « événements divers et contraires de la vie humaine17 «. La contemplation de la nature, de son unité et de son uniformité, conduit inévitablement à poser un « dessein « ou une finalité qui renvoie nécessairement à l'existence d'un « auteur unique «. Cette croyance de la raison en un Dieu principe et cause suprême de la nature correspond à la religion naturelle des savants et des philosophes18. C'est d'ailleurs pourquoi cette espèce de religion n'est pas primitive, mais suppose au contraire un degré élevé de science et de culture. De plus, elle ne peut jamais être « populaire « et son influence sur la conduite des sociétés humaines reste négligeable. Enfin son contenu, une fois passé au crible de la critique, reste très pauvre, puisqu'il se limite, comme on l'a vu précédemment, à poser une « lointaine analogie « entre la cause de la nature et l'intelligence humaine19. L'existence de cette religion naturelle, à laquelle Hume reconnaît le statut de croyance inévitable de la raison, permet cependant de souligner, encore une fois, la relation étroite qui unit la science et la religion dans la culture savante du XVIIIème siècle jusqu'à la « révolution « kantienne. Quant aux religions populaires ou historiques, elles n'entretiennent aucun lien avec la science dans leur origine, c'est-à-dire qu'elles ne découlent pas de « la contemplation des oeuvres de la nature «. Elles prennent leur source uniquement dans les « affections ordinaires de la vie humaine «, qui se ramènent aux passions de l'espoir et de la crainte, c'est-à-dire « le souci anxieux du bonheur, la crainte des maux futurs, la terreur de la mort, la soif de vengeance, la faim et l'aspiration aux autres nécessités de l'existence20 «. Ces deux grandes passions, en relation avec les événements de la vie 16 HUME, L'histoire naturelle de la religion, trad. M. Malherbe, Vrin, Paris, 1980, p. 39. 17 Ibid., p. 44-45. 18 HUME, Dialogues sur la Religion naturelle, op. cit., p. 144-145. 19 Ibid., p. 158. 20 HUME, L'histoire naturelle de la religion, op. cit., p. 46-47. 30 humaine, se renforcent et se maintiennent à cause de « l'ignorance « dans laquelle les hommes sont et resteront par rapport aux causes qui dirigent le cours ordinaire de leur vie. La puissance des passions et l'impuissance de la raison sont donc le terreau fertile d'où sont issues les religions populaires. Cette conjonction explique l'universalité, la permanence et la force de la croyance religieuse. La généalogie de la religion que propose Hume n'autorise aucune illusion quant à une disparition future des religions populaires, non seulement parce que les passions sont, dans la philosophie sceptique de Hume, plus primitives et plus puissantes que la raison, mais aussi parce qu'il ne croit pas que la raison pourra jamais diriger et éclairer le cours de la vie quotidienne des hommes. Jamais la science ne pourra complètement calmer les espoirs et les craintes que font naître les aléas de notre existence individuelle. C'est pour cela que Hume ne fait pas de la religion une simple invention des prêtres, même si ceux-ci savent utiliser à leur profit cette tendance de la nature humaine. A partir de cette source unique découlent deux types de religions historiques. D'abord vient le polythéisme, croyance primitive de l'humanité, la plus naturelle, consistant à attribuer les événements contraires et les occupations diverses de la vie humaine à des puissances, elles aussi, multiples et variées. Mais à cette pluralité des dieux, des esprits et des puissances invisibles peut succéder ce que Hume nomme le théisme, et que nous appellerions plus volontiers le monothéisme. Cette forme de religion populaire, qui n'a rien à voir, ni historiquement, ni psychologiquement, avec la religion naturelle de la raison, est présentée comme une simple évolution du polythéisme, une conséquence de la tendance humaine à exagérer la puissance et les attributs des divinités du polythéisme afin de s'en attirer et de s'en conserver les faveurs. Hume insiste bien sur l'idée selon laquelle le théisme n'est pas une rupture par rapport au polythéisme, mais sa continuation sous une autre forme. Le théisme est issu d'une concentration du polythéisme sur une seule divinité privilégiée. C'est aussi la raison pour laquelle rien n'interdit d'envisager un basculement en retour du théisme dans le polythéisme. Ces deux types de religion sont bien les deux espèces d'un même genre : la religion populaire, avec son cortège de superstitions et de persécutions. Quand Hume aborde l'évaluation comparée des religions, elle tourne rapidement et complètement à l'avantage du polythéisme. Successivement, quatre séries de critères sont pris en compte : la persécution et la tolérance, le courage et l'humilité, la raison et l'absurdité, le doute et la conviction. L'histoire montre, dans chaque cas, si l'on accepte de suivre notre auteur dans sa démonstration impitoyable, que le polythéisme s'en sort mieux que le théisme par rapport à la tolérance, à l'esprit de soumission, à l'acceptation des croyances absurdes et à la place laissée au doute et à l'esprit critique. Le type humain que produit le monothéisme serait inférieur en tous points à celui qu'autorise le polythéisme. Pour faire semblant d'atténuer ce constat redoutable pour les trois religions monothéistes, Hume rappelle, non sans ironie, le principe selon lequel « la corruption des meilleures choses engendre les pires21 «. 21 Ibid., p. 77. 31 On le voit, la charge de Hume est terrible. Elle s'attaque précisément à ces deux lieux communs de l'apologétique chrétienne que sont la supériorité du christianisme par rapport au polythéisme des Grecs et des Romains, ainsi que la proximité du christianisme et de la raison naturelle. Le verdict de Hume est sans pitié : les religions en général, et le théisme chrétien en particulier, ne sont pas des croyances rationnelles, et ce qu'elles ont en commun reste plus profond et plus significatif que ce qui les distingue. Enfin, le théisme populaire, loin d'être historiquement supérieur au polythéisme, serait plus nocif et dangereux pour les sociétés humaines. Ce jugement est donc sans appel, même si Hume ne se fait aucune illusion sur son efficacité. Là encore, la raison sceptique se reconnaît sans pouvoir devant le cours impétueux et désordonné des passions humaines, qui demeurent le seul véritable moteur de l'histoire universelle. Pour Hume, comme pour Shakespeare avant lui et Schopenhauer après lui, l'histoire sert de théâtre aux passions et illustre leur puissance irrésistible. Les avancées de la raison restent fragiles et ne laissent pas espérer un quelconque progrès moral. La religion de la raison ne pourra jamais supplanter les religions populaires. A la limite, une résurgence du polythéisme permettrait d'atténuer les excès des monothéismes et offrirait paradoxalement à la religion de la raison un champ d'expansion limité, mais mieux toléré. Ainsi l'histoire permet au philosophe d'approfondir sa connaissance du phénomène religieux, mais nullement d'en entrevoir la fin. Le recours à l'histoire Chez Hume, l'histoire constituait le prolongement naturel de l'analyse généalogique et servait seulement à illustrer l'alchimie des passions dans son rapport au mécanisme des religions. Il n'en va plus de même avec Condorcet. D'argument contre la religion, l'histoire est élevée au statut de recours et de moyen de salut à l'encontre de l'« oppression « religieuse. Or ceci est rendu possible justement parce que l'usage que Condorcet va faire de l'histoire dans son Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain se situe entièrement à l'intérieur de la tradition de l'apologétique chrétienne. On sait que le christianisme est une religion historique, c'est-à-dire une religion dont la justification se situe à l'intérieur du temps qu'habitent les hommes. La vérité du christianisme se présente d'abord comme une vérité inscrite dans l'histoire, et qui tend à faire de celle-ci le récit où se déploie et s'expose la révélation divine. A travers l'Incarnation, la vérité éternelle de Dieu pénètre dans l'histoire des hommes, qui se trouve tout entière orientée en fonction de cet événement unique et de son achèvement annoncé et promis : le retour en gloire du Christ et la fin de l'histoire. Le christianisme n'est donc pas seulement prophétique et messianique : sa vérité n'est pas seulement saisie dans la dimension de l'attente ou de l'inaccomplissement. L'histoire, dans son déroulement passé et présent, a pour mission de manifester la puissance du Christ et de son Eglise. En ce sens, l'histoire des hommes est bien de part en part une histoire sainte et providentielle. C'est ce que Bossuet va vouloir illustrer à travers son Discours sur l'histoire universelle, publié en 1681, alors même que s'achève son préceptorat du Dauphin. Dans la première partie de son ouvrage, intitulée « Les époques ou la suite des temps «, Bossuet précise le sens qu'il convient de donner à la 32 notion d'époque, fournissant à ses successeurs un modèle de périodisation qu'ils sauront utiliser: « Ainsi, dans l'ordre des siècles, il faut certains temps marqués par quelque grand événement auquel on rapporte tout le reste. C'est ce qui s'appelle ÉPOQUE, d'un mot grec qui signifie s'arrêter, parce qu'on s'arrête là pour considérer comme d'un lieu de repos tout ce qui est arrivé devant ou après et éviter par ce moyen les anachronismes, c'est-à-dire cette sorte d'erreur qui fait confondre les temps22. « Bossuet va ensuite distinguer douze époques correspondant aux sept âges du monde : 1°) Adam ou la création (premier âge du monde) ; 2°) Noé ou le déluge (deuxième âge du monde) ; 3°) La vocation d'Abraham, ou le commencement du peuple de Dieu et de l'Alliance (troisième âge du monde) ; 4°) Moïse ou la loi écrite (quatrième âge du monde) ; 5°) La prise de Troie et les temps héroïques ; 6°) Salomon, ou le temple achevé (cinquième âge du monde) ; 7°) Romulus, ou Rome fondée ; 8°) Cyrus, ou les Juifs rétablis (sixième âge du monde) ; 9°) Scipion, ou Carthage vaincue ; 10°) Naissance de Jésus-Christ (septième et dernier âge du monde) ; 11°) Constantin, ou la paix de l'Église ; 12°) Charlemagne, ou l'établissement du nouvel empire. Comme on le voit, l'histoire sainte et l'histoire profane sont savamment entremêlées par Bossuet, et placées l'une et l'autre sous l'autorité de la providence divine qui fait tout concourir à sa plus grande gloire. Dans les neufs époques qui précèdent la venue du Christ, et en dehors de la première renvoyant à la naissance de l'humanité en Adam, un équilibre parfait s'établit entre quatre personnages bibliques (Noé, Abraham, Moïse et Salomon) et quatre personnages de l'Antiquité classique (Homère, Romulus, Cyrus et Scipion). C'est ici que la volonté catholique de l'harmonie des deux cultures, la biblique et l'antique, s'exprime de la façon la plus éclatante, donnant au classicisme français son modèle indépassable. Elle permet aussi de souligner le fait que la providence divine exerce son autorité sur toute l'humanité et sur ses rois. Après la naissance du Christ, l'unité prend une forme nouvelle : Constantin et Charlemagne manifestent dans leur personne la soumission du pouvoir temporel au pouvoir spirituel, et annoncent ainsi la venue du règne de Dieu. En 1750, Turgot, le maître et l'ami de Condorcet, prononce à la Sorbonne un discours resté célèbre présentant un Tableau philosophique des progrès successifs de l'esprit humain, où il développe trois grands thèmes : celui de « l'avancement réel de l'esprit humain, qui se décèle jusque dans ses égarements « ; celui de l'importance de la communication des idées et de la transmission du savoir 22 BOSSUET, Discours sur l'histoire universelle, Garnier-Flammarion, Paris, 1966, p. 41. 33 que l'invention de l'imprimerie fera entrer dans une ère nouvelle ; enfin « les avantages que l'établissement du christianisme a procurés au genre humain «. Turgot précise que la religion chrétienne, « en répandant sur la terre le germe du salut éternel, y a versé les lumières, la paix et le bonheur23 «. En 1793, quand Condorcet rédige sa propre Esquisse, il se souvient certainement du Tableau philosophique de Turgot, dont il reprend l'ambition, et il n'ignore pas le Discours de Bossuet, auquel il emprunte sa division en époques. Cependant, son programme est volontairement tout autre. Contre Bossuet, il rejette l'idée d'une Providence divine extérieure à l'humanité, et pose bien plutôt l'Esprit humain comme le seul acteur et auteur de son histoire et de ses progrès. Contre Turgot, il refuse absolument la thèse du concours de la religion chrétienne au progrès intellectuel et spirituel de l'humanité. Pour Bossuet et Turgot, le recours à l'histoire permettait de lier le christianisme au salut de l'humanité. Il n'en va plus de même chez Condorcet : l'histoire illustre à la fois l'autosuffisance de l'esprit humain, seul responsable de sa marche vers le progrès, et le rôle néfaste de toutes les religions dans ce processus émancipateur. On assiste donc au retournement volontaire et conscient de la tradition apologétique de l'histoire providentielle. Mais cette différence fondamentale de contenu inscrit en même temps Condorcet dans la tradition chrétienne de l'histoire avec laquelle il prétend rompre. Car le retournement d'une tradition, ou même son utilisation polémique contre son modèle, n'implique aucune rupture structurelle. Bien plutôt, le résultat de cette opération se déploie sur le mode de la répétition simplement inversée. D'un argument en faveur de la religion chrétienne, l'histoire s'inverse en réquisitoire contre la religion en général. Mais, ce faisant, Condorcet n'échappe pas du tout à la forme de l'histoire providentielle et à la perspective du salut, héritées du christianisme, qu'il retrouve consciemment dans le devenir immanent de l'humanité. C'est donc à l'intérieur d'un cadre issu de la religion chrétienne, que Condorcet va s'employer à dénoncer les méfaits des religions. Ses principales thèses sont les suivantes : Premièrement, les religions proviennent, dès l'origine de l'humanité, de l'élaboration et de la confiscation du savoir par une minorité savante. La différence entre la minorité savante et la masse ignorante est la structure de base de la religion. Deuxièmement, les religions se développent à partir de la constitution d'une « caste sacerdotale « qui s'édifie sur la base fournie par la minorité savante. Cette caste, pour mieux asseoir son pouvoir sur le peuple, s'allie naturellement à la caste des chefs de guerre et des rois. Troisièmement, le christianisme d'Église, loin de modifier ce système de domination, l'a encore aggravé. Les prêtres et les moines vont tout faire pour étouffer ou retarder les progrès de l'esprit humain, dans lesquels ils discernent la menace la plus sérieuse contre leur pouvoir. La domination des prêtres supposant l'ignorance du peuple, la caste sacerdotale ne peut que s'opposer au développement 23 CONDORCET, Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, Garnier-Flammarion, Paris, 1988, Introduction, p. 42-43. 34 du savoir et de la science. Mais Condorcet reconnaît que le christianisme fait ainsi éclater la contradiction existant entre son message de base, l'Évangile, et le système de domination politique mis en place par l'Église romaine. C'est en ces termes qu'il évoque la conception évangélique de l'égalité des hommes : « Enfin, les principes de fraternité générale, qui faisaient partie de la morale chrétienne, condamnaient l'esclavage ; et les prêtres, n'ayant aucun intérêt politique à contredire sur ce point des maximes qui honoraient leur cause, aidèrent par leurs discours à une destruction que les événements et les moeurs devaient nécessairement amener. Ce changement a été le germe d'une révolution dans les destinées de l'espèce humaine ; elle lui doit d'avoir pu connaître la véritable liberté24. « Dans le même esprit, Condorcet saluera le rôle positif des Réformateurs, à travers leur doctrine du libre examen de l'Écriture Sainte, au service de l'émancipation de l'humanité. Enfin, quatrièmement, l'événement qui fera basculer définitivement le sort de ce combat pour la domination intellectuelle et politique des sociétés européennes sera l'invention de l'imprimerie et la diffusion universelle des savoirs qu'elle rend possible. Dorénavant, la science n'est plus réservée à une élite, les Lumières ne peuvent plus être « mises sous le boisseau «, dorénavant se développe une « opinion publique « qui devient progressivement le seul juge des débats et des combats en faveur des progrès de l'esprit humain. Cet événement décisif entraînera le déclin inexorable du pouvoir sacerdotal et son remplacement prévisible par la nouvelle classe des savants, qui est inséparable de la publicité du débat intellectuel et de l'universalité de sa diffusion. Annonçant Auguste Comte, Condorcet prédit la victoire de la communauté scientifique et sa substitution à la caste sacerdotale. La confiance qu'il porte aux savants repose moins sur une croyance naïve dans une amélioration morale de la nature humaine que sur le constat du changement des conditions réelles de production et de diffusion du savoir. On le voit, l'originalité de Condorcet repose bien sur une analyse principalement « politique « du rôle de la religion dans l'histoire, faisant écho aux propos de Marx selon lesquels les Français avaient fait la révolution dans la politique, alors que les Anglais l'avaient faite dans l'économie, et qu'il appartenait aux Allemands de la faire en philosophie. La confrontation historique, ainsi que sa solution, sont entièrement de nature politique : le savant est appelé à supplanter le prêtre comme détenteur du pouvoir spirituel, de même que la science remplace progressivement la religion en tant que mode de production du savoir, et que le règne de « l'opinion publique « met définitivement fin au principe d'autorité. On trouve ici une des sources historiques de la laïcité républicaine : la méfiance devant le rôle « obscurantiste « des religions et la certitude que la science et la raison vont s'imposer dans la conscience du peuple. Est-il besoin d'ajouter que la dénonciation systématique du rôle néfaste des prêtres et des moines à laquelle s'est livrée, avec tant d'autres, Condorcet, n'a pas toujours abouti à un progrès des Lumières ? Un seul exemple suffira, parmi bien d'autres. En 1793, brûleront une semaine durant les ouvrages contenus dans la bibliothèque de l'abbaye de Cluny. « Ce gigantesque 24 Ibid., p. 164. 35 autodafé est dressé sur la place du champ de foire par le libraire Tournier. Les documents qui échappent au feu vont, durant plusieurs années, servir à fabriquer des milliers de couvercles pour les pots à confiture. Thibaudet rapporte que de belles feuilles d'antiphonaire, décorées de miniatures et de dorures, servent à fabriquer des cerfs-volants que certains se souviennent avoir lancés sur la place Notre-Dame25. « Comme l'illustrera Goya, les rêves de la raison peuvent aussi engendrer des monstres. Quant aux espoirs qu'on peut placer dans le triomphe de l'esprit scientifique, ils font l'objet de la dixième époque de l'Esquisse de Condorcet, intitulée « Des progrès futurs de l'esprit humain «. Il est à noter que, chez Bossuet, la dixième époque correspond à l'avènement du Christ. Pour Bossuet, comme pour Condorcet, cette dixième époque marque le début du « dernier âge de l'humanité «, dont s'inspirera la terminologie hégélienne de la « fin de l'histoire «. Chez Condorcet, trois questions vont y trouver une réponse nouvelle et positive grâce au développement prévisible des sciences : « Nos espérances sur l'état à venir de l'espèce humaine peuvent se réduire à ces trois points importants : la destruction de l'inégalité entre les nations ; les progrès de l'égalité dans un même peuple ; enfin, le perfectionnement réel de l'homme26. « Mais l'optimisme de Condorcet, d'autant plus admirable qu'il s'exprime alors que, proscrit, il doit se cacher pour éviter l'arrestation qu'il pressent inévitable, ne repose pas sur l'ignorance des conditions historiques présentes de l'humanité. La contemplation du tableau à venir de l'humanité « affranchie de toutes ses chaînes «, écrit Condorcet, « présente au philosophe un spectacle qui le console des erreurs, des crimes, des injustices dont la terre est encore souillée, et dont il est souvent la victime27 «. Comment ne pas comparer ces dernières lignes à la Consolation de la philosophie de Boèce ? Par delà les siècles, par-delà le christianisme proclamé de l'un et l'anti-christianisme militant de l'autre, une même tonalité proprement philosophique résonne et nous parle encore aujourd'hui : la foi dans la victoire de la raison, malgré le triomphe apparent de l'injustice et de l'oppression, dont on peut être soi-même la victime. C'est finalement un XVIIIème siècle complexe et puissant jusque dans ses apories qui surgit de ce trop bref tableau des relations de la philosophie des Lumières avec les religions. Le procès de Dieu, s'il ne parvient pas à asseoir le triomphe de la raison, éclaire d'un jour nouveau ce besoin du divin présent au coeur du sujet de la connaissance. La solution du conflit entre la philosophie et la Révélation, si elle se révèle peu stable dans ses fondements et limitée dans sa durée, oblige à penser les conditions de possibilité d'une parole divine adressée à l'humanité. La généalogie de la religion, si elle rend incertaine toute sortie de l'ère religieuse, amène à réfléchir sur les raisons de cette permanence constitutive de l'humain. Quant à la dénonciation du rôle politique de la caste sacerdotale 25 Agnès GERHARDS, L'Abbaye de Cluny, Complexe, Bruxelles, 1992, p. 93-94. 26 CONDORCET, Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, op. cit., p. 265-266. 27 Ibid., p. 296. 36 et de ses abus obscurantistes, si elle risque toujours de faire le lit d'un nouveau fanatisme, elle suppose de s'interroger sur la capacité de la science à répondre à l'angoisse des hommes. Enfin le recours à l'histoire, si caractéristique du rapport aux religions de la philosophie française de la laïcité, depuis l'Esquisse de Condorcet jusqu'à l'Uchronie de Charles Renouvier, parue en 1876, en passant par la loi des trois états énoncée par Auguste Comte dans le Discours sur l'Esprit positif de 1844, s'il permet de donner sens à la spécificité et à la variété du phénomène religieux, oblige à revenir sur la problématique du salut historique et de la fin de l'histoire. Mais l'actualité profonde du XVIIIème siècle ne réside pas seulement dans la richesse et le foisonnement parfois contradictoire des questions et des réponses qu'il nous a léguées. Elle vaut, plus profondément encore, par son exemple intellectuel et moral, qui peut nous aider dans la réflexion urgente, à plus d'un titre, sur le devenir de la laïcité française. La première leçon est celle du courage de la raison, prête à aller jusqu'au bout d'elle-même dans sa confrontation avec Dieu, la Révélation et les religions, fidèle à la formule antique selon laquelle « rien de ce qui est humain ne peut lui rester étranger «. La deuxième leçon est de ne pas se contenter de réfléchir sur le « fait « religieux, mais d'oser la question du sens et de la vérité, en reconnaissant la contribution qu'y apportent les religions. A ces deux sources, qui nous placent à « l'ombre des Lumières «, pourra s'abreuver la réflexion philosophique dont la laïcité a besoin aujourd'hui. 37 L'approche historique des documents fondateurs : la Bible Jean-Marie Husser, Professeur à l'Université Marc-Bloch de Strasbourg L'approche historique des documents religieux a pour premier objectif de les situer dans leur contexte culturel, social et politique, afin d'en permettre une interprétation indépendante des présupposés théologiques qui conduisent leur exégèse traditionnelle. C'est dire d'emblée qu'il y aura une inévitable tension entre l'interprétation historique de ces textes et leur réception dans la foi par une communauté de croyants. Si l'historien peut aisément ignorer la tension engendrée par son travail critique, dans la mesure où il respecte toutes les règles d'une démarche objective et non réductrice, il n'en va pas de même pour l'enseignant. Celui-ci se trouve dans l'inconfortable position d'interface entre l'approche scientifique, le savoir qu'il a pour mission de transmettre, et des élèves dont il se doit de respecter la liberté de conscience et les convictions, différentes pour chaque individu, parfois intransigeantes, souvent contradictoires à l'âge de l'adolescence. A cet égard, l'approche scientifique des faits religieux est, me semble-t-il, un véritable défi pédagogique, car la pertinence de l'enseignement y est directement proportionnelle à sa réception auprès des élèves. Je ne me sens aucune qualité pour donner leçons et conseils en la matière, et mon propos sera plus modeste. A partir du cas particulier de la Bible hébraïque, il s'agira d'illustrer la distorsion que la recherche historique imprime au texte religieux par rapport précisément à sa fonction de document fondateur. Dans une première partie, j'évoquerai rapidement les prémisses de cette critique historique dans l'appréhension d'un texte qui se présente lui-même en partie comme historiographique. Puis je synthétiserai les questions relatives aux origines d'Israël dans ma deuxième partie, et à la naissance du monothéisme biblique dans ma troisième partie. Enfin, en quatrième partie, j'illustrerai la nécessité, tant pour l'enquête historique que pour l'enseignement, d'aborder également le contenu religieux du document et sa signification pour les communautés qui l'ont produit. Je le ferai à travers un point précis et généralement négligé : le rapport que la Bible entretient avec l'histoire, comprise à la fois comme lecture théologique des événements et comme représentation du temps. L'historien face à l'historiographie biblique Si la Bible se présente comme la mise par écrit d'une parole divine révélée, elle a pour particularité de mettre en scène cette révélation dans le continuum de l'histoire, d'après une chronologie des événements établie selon les critères de l'historiographie pratiquée au temps de sa composition. La 38 place de la narration historique dans la Bible est considérable : elle commence avec les récits mythiques des origines du monde et de l'humanité et se poursuit, à travers les cinq livres du Pentateuque28, avec le récit des tribulations des patriarches et de la sortie d'Égypte de leurs descendants sous la conduite de Moïse. Dans son ensemble, le Pentateuque partage à peu près à égalité son contenu entre les récits historiques et les lois'. Le principe rédactionnel qui a présidé à la mise en forme définitive du tout consista à insérer les lois (cultuelles, morales, sociales) dans un cadre narratif, de manière à les référer à la révélation reçue par Moïse sur la Montagne sainte. Cette répartition à peu près égale entre la narration historique et la législation indique à elle seule deux grands axes de la pensée religieuse juive au moment de l'achèvement de ces écrits. Viennent ensuite, dans une continuité narrative savamment organisée, les six livres de ce que les historiens appellent « l'Histoire deutéronomiste29 «, qui couvre les événements depuis la « conquête « de Canaan par les Hébreux jusqu'à la fin du royaume de Juda et la déportation d'une part de sa population en Babylonie. La fin du récit indique en même temps l'époque de sa rédaction finale et le contexte dans lequel ses rédacteurs ont travaillé. L'ensemble de cette fresque historique, qui court depuis la création du monde jusqu'à la destruction du Temple de Jérusalem, est marqué par une évaluation morale et théologique des événements, très présente dans l'Histoire deutéronomiste, mais dont on trouve quelques éléments dès les premiers chapitres de la Genèse. Cette évaluation est guidée par l'idée que les malheurs présents - l'exil à Babylone et la destruction de Jérusalem - sont le châtiment mérité et annoncé des infidélités du peuple d'Israël et de ses rois envers leur Dieu et le pacte qu'il avait conclu avec eux. Un autre corpus historiographique, rédigé pendant la période perse, est constitué de quatre livres : 1-2 Chroniques, Esdras et Néhémie. Il reprend la narration depuis les patriarches (mentionnés uniquement à travers des généalogies) jusqu'à la restauration du Temple et des murs de Jérusalem sous l'égide des autorités perses (objet des livres d'Esdras-Néhémie). La perspective de l'oeuvre n'est plus celle d'un jugement porté sur les malheurs passés, mais celle d'une restauration théocratique à travers l'idéalisation des figures royales de David et de Salomon. La narration veut ici illustrer la place centrale du culte et du sacerdoce, et s'assortit de considérations idéologiques sur ses relations avec le pouvoir politique et l'occupation du sol. Ces deux collections de livres historiques assurent le cadre chronologique de leur récit en donnant de nombreuses indications chiffrées sur les durées de règnes ou les périodes ; cette chronologie relative permet aujourd'hui, après examen critique mais avec parfois quelques réserves, d'insérer cette historiographie d'Israël depuis les débuts de la monarchie avec Saül (ca. 1030-1010) dans notre chronologie de l'histoire universelle. Outre ces deux corpus à caractère proprement historiographique, l'attention portée à l'histoire sous-tend également l'ensemble des textes prophétiques, qui apparaissent comme un commentaire 28 A savoir : Genèse, Exode, Lévitique, Nombres, Deutéronome. 29 A savoir : Josué, Juges, 1-2 Samuel, 1-2 Rois. 39 continu et sans cesse réactualisé des événements vécus par le peuple d'Israël. Ce regard prophétique sur l'histoire trouve son point culminant dans la littérature apocalyptique, qui intègre la destinée d'Israël et des autres nations dans une vision désormais universaliste de l'histoire, qui s'achève avec la venue attendue du Royaume de Dieu. Cet aboutissement de l'historiographie biblique dans une vision eschatologique est certes un développement tardif qui apparaît progressivement à partir de l'exil (au milieu du VIème siècle) ; il n'en est pas moins la manifestation éclatante de la perspective mythicothéologique qui sous-tend l'ensemble de cet effort d'interprétation de l'histoire, et à laquelle l'historien moderne ne saurait naturellement souscrire. Il est évident que nous avons affaire à une « Histoire sainte «, quelle que soit par ailleurs la réelle valeur historique de nombreux documents utilisés dans ces textes. La critique historique de la Bible commença véritablement au XVIIème siècle, lorsque philosophes et érudits osèrent, au nom de la raison, tirer les conclusions d'un certain nombre d'inconséquences narratives et théologiques observables dans le texte biblique : des événements racontés deux ou trois fois selon des perspectives différentes, des ruptures narratives, des données invraisemblables et des lois contradictoires, des noms ou des représentations de Dieu différents, etc. Avec les travaux des fondateurs, tels Baruch Spinoza (1632-1677)30, Richard Simon (1638-1712)31 ou Jean Astruc (16481766)32 était ouverte ce qu'on appellera par la suite « la question du Pentateuque «, selon les mêmes principes critiques que se formulait en même temps « la question homérique33 «, et que seront bientôt examinés l'ensemble des textes bibliques. La question initiale fut celle des auteurs des textes et de leurs dates de rédaction. Questions éminemment sensibles, car la conception traditionnelle de l'authenticité du texte sacré et de son inspiration était en jeu. Dès le début du XIXème siècle, l'exégèse critique libérale abandonna 30 Il soutenait, dans son Tractatus politico-politicus publié en 1670, que le véritable rédacteur de la Torah et des livres historiques serait Esdras et non Moïse. 31 Prêtre de l'Oratoire, il émit dans son Histoire critique du Vieux Testament (publiée la première fois en 1678, avec le nihil obstat de ses supérieurs et de la Sorbonne) l'hypothèse d'une chaîne ininterrompue de scribes qui auraient transmis les traditions de Moïse à Esdras. Poursuivi par la vindicte de Bossuet, il dut par la suite se réfugier en Hollande où parut la seconde édition, à Roterdam, en 1685. 32 Huguenot d'origine et médecin de Louis XV, il publia à Bruxelles en 1753 des Conjectures sur les Mémoires originaux dont il paraît que Moyse s'est servi pour composer le récit de la Genèse, ouvrage dans lequel il distinguait deux documents-sources ayant servi à la composition du Pentateuque : l'un (document A), débutant avec Gen. 1 et utilisant le nom divin Elohim, l'autre (document B), débutant avec Gen. 2-3 et utilisant le nom divin Jehowah, auxquels on été associées huit sources fragmentaires. Astruc posait ainsi les principes d'une « hypothèse des documents « pour rendre compte des difficultés du texte. 33 Posée pour la première fois par l'abbé d'Aubignac dans ses Conjectures académiques ou dissertation sur l'Iliade, publiées en 1715 (mais rédigées dès 1664), et reprise avec plus d'ampleur en Allemagne par F. A. Wolf dans ses Prolégomènes à Homère (1795). 40 définitivement l'idée que Moïse fût l'auteur du Pentateuque et passa de la notion d'auteur à celle d'écoles et de rédacteurs. Les mêmes conclusions s'imposèrent pour l'attribution des Psaumes à David et de la littérature de sagesse à Salomon : on admit que le procédé de pseudépigraphie courant dans l'Antiquité valait également pour les écrits bibliques. Jusqu'au milieu du XIXème siècle, l'archéologie n'étant encore que balbutiante, l'approche historique de la Bible se fit essentiellement à travers la critique philologique et l'analyse rédactionnelle des textes. Cette méthode dite « historico-critique « était alors principalement pratiquée en Allemagne, dans les Facultés protestantes libérales ; il s'agissait essentiellement de repérer et de définir les documents sources utilisés par les rédacteurs dans la composition des textes du Pentateuque. Je mentionnerai ici uniquement les travaux fondateurs de Julius Wellhausen (18441918)34, qui s'imposèrent comme référence jusque dans les années 1970. Dès la fin du XIXème siècle, les premiers textes akkadiens déchiffrés (le récit du déluge, l'Enuma elish ou la Descente d'Ishtar aux enfers) firent sortir la Bible de son isolement culturel. La comparaison avec cette littérature soeur amena à considérer de plus près les formes et les genres littéraires mis en oeuvre dans les textes bibliques. Cette critique des formes fut inaugurée par un autre savant allemand, Hermann Gunkel (1862-1932)35. Très attentif aux travaux des recherches folkloristes, il insista sur la nécessité de tenir compte de la tradition orale, dont les modes de fonctionnement auraient laissé leur empreinte dans certaines formes écrites de ces littératures du Proche-Orient ancien. Après trois siècles d'analyse critique des textes bibliques, et même si les questions de dates de rédaction font encore l'objet de vifs débats, les acquis de cette approche historique sont considérables. Il n'est ni possible ni opportun de les résumer ici, mais disons simplement que le texte biblique, en quelque partie que se soit, est désormais considéré comme le résultat d'un processus rédactionnel plus ou moins long. Pour chaque partie de ce corpus, ce processus est globalement compris, dans son étape initiale, comme une collation de traditions et de textes primitivement épars (légendes, documents d'archives, textes liturgiques, oracles, etc.) pour constituer un écrit primitif (récit historiographique, collection d'oracles) ; puis interviennent au fil du temps divers rédacteurs ou écoles, qui reprennent cet écrit primitif, le complètent et le développent, l'actualisent en fonction des besoins nouveaux d'une communauté, en réorientent si nécessaire les axes théologiques. L'état actuel de ces études tend à abaisser les dates de composition des textes bibliques dans une fourchette allant du VIIIème siècle au ème siècle pour la plupart d'entre eux, avec une période d'intense activité rédactionnelle et éditoriale 34 Die Composition des Hexateuchs und der historischen Bücher des Alten Testaments, Berlin, 1876 ; IV Prolegomena zur Geschichte Israels, Berlin, 1883. 35 Die Sagen der Genesis, Göttingen, 1901 ; Genesis. Handkommentar zum Alten Testament, Göttingen, 1901 ; Das Märchen im Alten Testament, Tübingen, 1917. 41 à la fin de la monarchie judéenne et pendant l'exil babylonien (à la fin du VIIème siècle et dans le courant du VIème siècle)36. Mais l'approche historique de ce corpus s'est faite également grâce à l'accroissement considérable des données archéologiques et épigraphiques au long du XXème siècle, et principalement ces cinquante dernières années. Cet apport d'informations extérieures au texte biblique sur les modes de vie, l'économie, les événements politiques, les cultes, les différents aspects de la culture, a évité que cette exégèse historico-critique des textes s'enferme dans une argumentation circulaire, et a plus d'une fois remis en cause les modèles élaborés par la critique rédactionnelle. Cependant, cet affranchissement des études historiques à l'égard du cadre historique mis en place dans l'histoire sainte a été long et difficile. L'étonnement et la curiosité suscités dans le public par l'ouvrage récent de Israël Finkelstein et Neil A. Silberman37 témoignent combien la « démythologisation « de l'histoire ancienne d'Israël est un acquis scientifique encore peu diffusé dans l'opinion et dans nos manuels scolaires, en dépit des progrès constants et significatifs en ce domaine depuis un siècle. La recherche historique et les origines des Hébreux La possibilité d'utiliser comme sources documentaires les récits bibliques concernant les Patriarches et les origines des tribus d'Israël, tout en respectant les exigences de la critique historique, a été envisagée à partir des principes de l'étude des formes, développés par H. Gunkel. On constate tout d'abord que le genre littéraire des récits du Pentateuque, notamment de la Genèse et de l'Exode, est la légende (die Sage), légende familiale, héroïque ou cultuelle. Or, le propre d'un récit légendaire est de s'appuyer sur un élément de la réalité : le nom d'un personnage, un lieu connu de tous, une pratique cultuelle, un événement transmis dans la mémoire collective, etc. De plus, on insista sur deux points, essentiels à cette étude des formes littéraires : premièrement, la tradition orale est capable de transmettre fidèlement des récits simples pendant de longues périodes ; deuxièmement, il est possible d'identifier le milieu de production du récit à partir d'une définition précise de sa forme littéraire. La critique des formes prétendit ainsi pouvoir remonter, en deçà des textes écrits, à une réalité sociale et institutionnelle insaisissable directement et beaucoup plus ancienne que la mise par écrit des récits. Ce faisant, la recherche renonce certes à reconstituer une trame événementielle de la protohistoire d'Israël, mais elle défend la possibilité de saisir le contexte culturel et historique de ses origines. Constatant que les légendes patriarcales racontent essentiellement des déplacements de groupes et d'individus et que ces derniers apparaissent comme des personnalités éponymes, on considère ces récits non plus comme des histoires racontant les aventures singulières de tel héros, mais comme des 36 Il ne faut pas mésestimer l'importance pour l'historien de l'abondante littérature rédigée pendant les périodes hellénistique et romaine, dite apocryphe ou pseudépigraphique, et qui n'a pas été retenue dans le canon scripturaire juif. 37 Israël FINKELSTEIN et Neil A. SILBERMAN, La Bible dévoilée, Bayard, Paris, 2002. 42 fragments de mémoire d'une histoire collective. On a dès lors tenté de situer les migrations des groupes tribaux représentés par les figures éponymes d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, d'Esaü ou de Jacob dans le cadre général de l'histoire du Proche-Orient, en tenant compte des mouvements migratoires que l'archéologie repère au cours du IIème millénaire. C'est ainsi qu'on a cru pouvoir situer la période patriarcale au Bronze moyen, identifiant les premiers Hébreux à des populations marginales, vivant de rezzou ou utilisées comme mercenaires, et désignées par les noms de habiru / apiru dans les textes mésopotamiens et égyptiens du IIème millénaire. On associa la migration d'Abraham aux infiltrations des Amorites dans le pourtour du Croissant fertile aux XIXème et XVIIIème siècles, la descente en Égypte des fils de Jacob à l'installation en Haute Égypte des tribus de pasteurs connues sous le nom de Hyksos (1730-1550), et l'exode enfin à l'expulsion de ces mêmes Hyksos par Amosis, le fondateur de la XVIIIème dynastie (1580-1546), ou à la fuite hypothétique d'un petit groupe d'esclaves au XIIIème siècle ; le fait n'est en soit pas invraisemblable, mais aucune source égyptienne n'en fait mention. Cette reconstitution, qui atteint son achèvement dans les années 197038, tentait de faire coïncider la succession des événements tels qu'ils sont racontés dans la Bible et les données connues de l'histoire du Proche-Orient. Deux raisons peuvent être invoquées pour expliquer ce souci de « concordisme « avec le modèle biblique : le fait d'une part que la recherche s'est longtemps effectuée principalement dans des contextes confessionnels, certes libéraux et scientifiquement très rigoureux, mais inévitablement enclins à une interprétation maximaliste des données scripturaires. Le fait, d'autre part, que la Bible reste elle-même la principale, voire la seule source écrite permettant de documenter cette période de l'histoire des Hébreux, et que l'archéologie a besoin de textes pour faire parler les choses. Pourtant, cette séduisante reconstitution fut à son tour contestée par les progrès de la recherche, tant dans le domaine archéologique que textuel. Elle admettait en effet que les légendes patriarcales, en raison de leur ancienneté supposée, transmettent suffisamment d'indications sociologiquement et historiquement fiables. Or, c'est l'ancienneté même de ces traditions patriarcales qui a été partiellement remise en question par la critique littéraire à partir de la fin des années 1970, et de nombreux textes du Pentateuque ont vu leur date de composition réévaluée à la baisse39. De plus, il est maintenant acquis que les légendes patriarcales d'une part, les récits relatifs à la sortie d'Egypte et au séjour au désert d'autre part, ou ceux racontant l'installation en Canaan, sont des ensembles de 38 Le représentant le plus caractéristique et le plus mesuré de cette position fut Roland de Vaux, qui la développa de façon magistrale dans son Histoire ancienne d'Israël, Gabalda, Paris, 1971. 39 Deux ouvrages ont été déterminants sur ce sujet : T.L. THOMPSON, The Historicity of the Patriarchal Narratives, BZAW 133, W. de Gruyter, Berlin-New York, 1974 ; J. VAN SETERS, Abraham in History and Tradition, Yale University Press, New Haven, 1975. Seul le cycle de Jacob résiste bien, car il est attesté dès le VIII ème siècle de façon incontestable dans le livre du prophète Osée (chap. 12). 43 traditions primitivement indépendantes les unes des autres. Leur fusion en une seule séquence narrative est le fait d'une reconstruction du passé élaborée aux alentours de l'exil. Mais les textes sont là et, à moins de pratiquer une critique radicalement réductrice, l'historien doit considérer que les couches rédactionnelles les plus anciennes sont susceptibles de véhiculer les éléments épars d'une mémoire collective, d'autant plus qu'on a cessé de faire de l'archéologie « biblique «, cette discipline dont le but avoué fut, pendant la première moitié du XXème siècle, de retrouver dans le sol confirmation et illustration de la Bible. L'étude des texte et l'étude des restes matériels sont maintenant des disciplines distinctes, fonctionnant chacune selon des méthodes éprouvées également en d'autres champs de recherche. Le dialogue entre ces disciplines est plus exigeant, mais les résultats sont mieux assurés. Selon un état récent de la recherche, cette question des origines historiques des Hébreux se pose de la manière suivante : du côté des sources écrites, il semble qu'il y ait eu en fait, dans la mémoire collective d'Israël, deux ensembles de traditions distinctes et apparemment concurrentes sur l'origines des tribus et leur installation en Canaan : d'une part, des traditions faisant état d'une migration de clans nomades, vraisemblablement venus des royaumes araméens du nord-est et, plus lointainement peut-être, de Mésopotamie, se sédentarisant pacifiquement dans la région montagneuse de Cisjordanie, et dont les légendes patriarcales garderaient le souvenir. D'autre part, des traditions relatives à une migration de clans fuyant le Delta égyptien où ils avaient servi comme main d'oeuvre étrangère (habirû ?), traversant le Sinaï et le Néguev, et pénétrant en Cisjordanie par le sud et l'est. Deux origines distinctes donc, deux mouvements migratoires, probablement simultanés et dont les clans fusionnent plus tard dans une entité politique commune. Quant au témoignage de l'archéologie israélienne récente, il ne livre aucun indice contraignant pour situer une « époque patriarcale « au Bronze moyen. Au contraire, tout concourt à situer les premières traces de tribus israélites au tournant des XIIIème et -XIIème siècles. De vastes campagnes d'explorations de surface révèlent l'apparition, sur les hauteurs du massif palestinien central à partir du XIIème siècle, d'établissements agricoles d'un type bien caractéristique, témoignant d'une culture et d'une organisation sociale très différentes de celles des cités cananéennes. Ces faits suggèrent un processus de sédentarisation progressif, dans des zones inoccupées, de populations semi-nomades venues des franges du désert. Il s'agit d'un processus lent et pacifique, qui ne s'accompagne d'aucune destruction des villes cananéennes. Même s'il est légitime - bien que tout à fait hypothétique - de reconnaître dans les populations qui s'installent sur ces terres les ancêtres des Israélites, la question de leur origine est encore ouverte 40. 40 En dépit des affirmations de Finkelstein et Silberman (La Bible dévoilée, op. cit., p. 130-143), dont l'hypothèse d'une sédentarisation de populations nomades autochtones selon un processus récurrent depuis le Bronze ancien demande encore à être vérifiée. De toute façon, cela n'exclut pas un apport extérieur ; on ne peut faire l'impasse sur les textes attestant une origine araméenne pour une partie au moins des clans israélites. 44 Les origines du monothéisme biblique Étroitement liée aux recherches que je viens d'évoquer, la question des origines du monothéisme biblique se pose en des termes analogues et a fait l'objet de nombreux travaux ces quinze dernières années. Selon l'historiographie biblique que nous venons d'évoquer, les Hébreux sont monothéistes dès leur traversée du désert, après s'être enfuis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et c'est animés de cette foi monothéiste qu'ils se sont installés en Canaan. Les populations polythéistes de Canaan représentèrent alors un danger redoutable pour les Hébreux, en permanence tentés de renouer avec des pratiques « idolâtres «. L'Histoire deutéronomiste évalue la qualité des rois et la valeur de leur règne uniquement en référence à leur fidélité au monothéisme enseigné par Moïse et à l'alliance conclue avec Yahvé. Comme on l'a dit, ces historiens théologiens présentent la destruction de Jérusalem et la fin de la monarchie comme la sanction encourue en raison des incessantes infidélité d'Israël à cette foi. Or, ici encore, la recherche historique conteste cette présentation de l'histoire et en bouleverse complètement les termes41. Que le peuple juif ait professé une foi monothéiste au moment où s'achevait la composition de ses écrits sacrés, dans le courant de la période perse, est un fait historiquement incontestable. En revanche, que ce monothéisme tire son origine d'une révélation faite à Abraham, puis renouvelée à Moïse vers le début du XIIIème siècle, est du domaine de la foi, laquelle a une incidence directe sur la manière dont Israël a interprété son histoire. Non seulement, comme nous venons de le voir, les événements de la sortie d'Égypte et de la traversée du désert sont historiquement insaisissables, mais la personne même de Moïse restera sans doute à jamais une énigme historique. Ce que l'historien peut observer, c'est la présence d'une religion polythéiste en Syro-Palestine avant l'arrivée des Hébreux sur la scène de l'histoire. En s'appuyant sur les légendes patriarcales et sur des données historiques postérieures, il est également possible de reconstituer les grands traits de la religion des populations semi-nomades transhumant aux franges du désert : une religion tribale du dieu ancestral, du « dieu du père «, associée au culte de divers sanctuaires locaux où l'on vénérait en particulier le dieu El sous diverses épithètes, notamment celle de « créateur du ciel et de la terre «. Quant au dieu Yahvé, dieu de l'orage et de la fécondité, mais aussi de la guerre et des armées, son nom n'est pas attesté avant la fin du IXème siècle dans des documents extra-bibliques où il apparaît comme le dieu national du royaume d'Israël42. En se fondant sur l'étude des traditions anciennes véhiculées dans les textes bibliques, il semble que l'origine du culte de Yahvé soit à rechercher dans le sud du Néguev, à la bordure nord du Sinaï. Avec prudence, on pourra même préciser qu'il s'agissait du dieu tribal des clans madianites dont on dit que le prêtre Jéthro fut le beau-père de Moïse. Mais ici, de nouveau, il devient difficile de faire le partage entre la légende et l'histoire. Ce qui est 41 Voir la récente synthèse de André LEMAIRE, Naissance du monothéisme, Bayard, Paris, 2003. 42 La stèle araméenne d'Hazaël retrouvée à Tel Dan (ca. 820 av. J.C.) et la stèle moabite de Mésha' (ca. 810 av. J.C.). 45 historiquement assuré, c'est que Yahvé était le dieu national de la monarchie israélite et le souverain tutélaire de ses rois, aussi bien sous la monarchie unifiée des règnes de David et de Salomon que dans les deux royaumes de Samarie et de Jérusalem. Il ne s'agit cependant pas d'un monothéisme - au sens de la croyance en un dieu unique et universel -, mais de ce que l'on appelle une monolâtrie. On entend par là un culte officiel rendu exclusivement à une divinité, sans pour autant nier l'existence d'autres dieux, exclus du culte officiel ou présidant aux destinées des peuples ou des clans voisins. De nombreux passages de la Bible comportent encore les traces cet état ancien de la religion d'Israël où Yahvé apparaît comme « le dieu d'Israël «, « notre dieu «, parmi les autres dieux des nations. Il semble aussi qu'au nom d'une habile politique d'unification du royaume, la monarchie israélite se soit appliquée à intégrer au culte de Yahvé l'idéologie royale dominante dans le Proche-Orient, ainsi que certains éléments de la religion cananéenne, notamment le culte du dieu El et certains aspects du culte de Baal. A la fin de la période royale cependant, au VIIème siècle, cette politique d'assimilation fut abandonnée et une politique de centralisation du culte à Jérusalem entraîna le rejet de tout ce qui était jugé incompatible avec le culte exclusif de Yahvé. Ce qu'il faut souligner, c'est que cette forme de religion monolâtrique n'est pas isolée dans le contexte ouest-sémitique de l'époque. L'épigraphie livre suffisamment d'indices pour déduire que d'autres États de la région pratiquaient un culte analogue (notamment les Moabites, dont le dieu était Kamosh). Durant cette période monarchique (du IXème au -VIIème siècles), en fonction des relations diplomatiques avec les États voisins ou de l'influence politique des grandes puissances, l'exclusivité du culte de Yahvé était souvent relativisée et de nombreux cultes considérés comme « étrangers « - mais non pas « faux « - étaient également pratiqués en Israël. Les milieux prophétiques jouèrent un rôle important dans la promotion et le maintien du culte exclusif de Yahvé, et certains récits évoquent même des affrontements violents avec les tenants des cultes non yahvistes. Un débat eut lieu récemment à propos de la possible présence d'une divinité féminine à côté de Yahvé, appelée Ashérah, mais je suis de ceux qui pensent que les indices épigraphiques invoqués ne permettent pas de soutenir cette hypothèse43. On remarque également que cette monolâtrie connut peut-être à ses débuts une représentation de son dieu sous la forme d'un taureau, mais qu'on le représenta surtout par une simple stèle, comme l'atteste le temple yahviste de la citadelle d'Arad, et comme c'était également le cas dans de nombreux sanctuaires phéniciens à la même époque. Une évolution vers un anicônisme radical est visible dès le VIIème siècle, où l'archéologie constate que ces stèles même furent bannies des sanctuaires israélites. Ce n'est qu'à la faveur de l'exil - ici encore, cette période apparaît comme charnière - que cette monolâtrie évolua en un véritable monothéisme. Plusieurs facteurs ont contribué à la transformation du dieu national en un dieu universel, à côté duquel aucune autre divinité ne pouvait plus exister : le 43 Voir un résumé de la controverse dans l'ouvrage de A. LEMAIRE, Naissance du monothéisme, op. cit. 46 développement d'une forme de culte non sacrificiel indépendant du temple et de la terre d'origine, la nécessité de repenser les anciennes représentations théologiques en fonction de la catastrophe vécue (Yahvé avait-il été vaincu par les dieux de Babylone, ou avait-il lui-même utilisé les Babyloniens pour châtier son peuple ?). Il ne fait pas de doute aussi que l'environnement idéologique de l'empire perse qui succède à la domination babylonienne, avec sa théologie royale monothéiste, favorisa et encouragea la diffusion du monothéisme juif. Sur les origines du monothéisme biblique donc, on constate que l'approche historique renverse complètement la séquence des événements telle qu'elle est développée dans la Bible. Le monothéisme n'est plus aux origines du peuple d'Israël, mais au terme d'un processus historique qui arrive à maturité à la fin du VIème siècle. L'exclusivisme du culte yahviste, exigé par le courant prophétique avant l'exil, n'est pas la défense d'un monothéisme idéal issu du désert et sans cesse menacé de contamination par les cultes de la civilisation urbaine. Il apparaît plutôt comme la nécessité de maintenir une identité nationale face aux risques de dissolution auxquels étaient exposés tous les royaumes phéniciens et araméens, face à une super-puissance assyrienne qui imposait ses dieux en même temps que son tribut aux populations soumises. Au vu de ce rapide résumé, l'approche historique de la Bible apparaît singulièrement destructrice de sa nature même de document religieux fondateur. On aurait tort cependant, comme le fait parfois une vulgarisation trop superficielle, de considérer que la critique historique s'en tient là. Pour être complète, elle doit également prendre en compte la réception des textes, et c'est à ce stade de leur histoire, qui se poursuit dans le processus de canonisation, qu'ils reçoivent leur statut de documents fondateurs. Il serait ici indispensable, traitant de la religion juive ancienne dans les programmes, d'aborder ce point de la formation des écrits sacrés et de la constitution d'un canon scripturaire. Le caractère destructeur de la critique historique résulte uniquement d'une démarche qui ne va pas à son terme et s'arrête à l'examen du rapport entre le texte et le hors-texte, pour inévitablement y constater le décalage propre à tout acte d'écriture. Il est vrai que cet aspect de la recherche est assez récent et n'a pas encore fait l'objet d'une large diffusion. Il n'empêche, la dimension critique de la démarche historique à l'égard des textes fondateurs ne laisse pas de poser quelques problèmes à l'enseignant. Comment faire la part de la rigueur scientifique sans apparaître en même temps comme un démolisseur de la foi biblique ? S'il faut tirer des conclusions pédagogiques de cette approche historique d'un document fondateur, je dirais que la Bible ne doit certainement pas être utilisée de la même façon selon que l'on enseigne l'histoire des Hébreux et d'Israël, l'histoire du monothéisme biblique, ou encore les grands thèmes de ce monothéisme et de la religion juive. En opérant très nettement ces distinctions dans l'enseignement et dans le choix des documents pédagogiques, on peut éviter beaucoup de malentendus et aborder ces faits historiques, culturels et religieux dans le respect de leur spécificité et sans rien sacrifier aux exigences de la rigueur historique. On n'évitera pas, cependant, le délicat exercice consistant à faire prendre 47 conscience aux élèves que la vérité d'un tel texte ne réside pas dans sa conformité au réel, au hors texte, mais dans le sens qu'il entend donner à cette réalité. L'interprétation de l'histoire dans la Bible L'étude de l'interprétation de l'histoire développée dans la Bible peut être une manière d'intégrer un enseignement sur le fond du message biblique à un enseignement objectif de l'histoire. Certes, la conception de l'histoire des théologiens bibliques ne correspond pas à la nôtre, et leur reconstruction des faits ne peut être utilisée telle quelle pour documenter notre recherche et notre enseignement. Nous referions alors de l'histoire sainte. En revanche, elle est un fait religieux majeur, dont il nous faut pouvoir parler en tant que tel. En effet, c'est une évidence trop souvent ignorée que, en plus de ses lois éthiques et cultuelles, en plus de son enseignement proprement théologique et de sa réflexion sapientielle, la Bible développe une conception de l'histoire qui a connu différentes phases et orientations. Le poids théologique et l'importance quantitative des textes où s'expriment cette réflexion est considérable dans la Bible et a grandement contribué, à travers le christianisme, à former notre perception occidentale du temps et de l'histoire. On détecte tout d'abord une conception du temps que l'on peut qualifier de « circulaire «, bien que l'adjectif porte ici à confusion, car la séquence chronologique reste fondamentalement linéaire. A l'intérieur de ce temps linéaire cependant, les auteurs bibliques ont pratiqué une forme d'exégèse consistant à reconnaître dans des personnes, des lieux ou des événements du passé l'anticipation, l'annonce ou le « modèle « de personnes, de lieux ou d'événements ultérieurs. Je précise que ce rapport ne relève pas de l'idéalisation des personnages ou des temps passés, idéalisation observable en bien d'autre contextes. Le rapport ainsi établi entre un « type « et la réalité qu'il préfigure suppose une certaine ressemblance entre eux, une analogie structurelle et sémantique. La mise en relation du « type « et de la réalité préfigurée, analogues mais historiquement distincts, crée entre eux un lien herméneutique qui est censé révéler une identité profonde et mystérieuse entre eux et par là donner sens à la réalité présente. Par exemple, dans la deuxième partie du livre d'Esaïe, l'exode, la sortie d'Égypte à travers la Mer, sert de « type « pour annoncer le retour des déportés de Babylonie, et ce retour est décrit en termes de « nouvel exode « (Es. 43,16-21). A ce rapport exode / retour d'exil, on peut ajouter encore un petit récit qu'on a longtemps considéré comme une pure légende patriarcale, mais qui apparaît en fait comme un écrit théologique soigneusement composé à la fin de l'exil : l'histoire de la fuite d'Abraham et de Sara en Égypte (Gn 12,10-20). La structure narrative du récit (fuite en Égypte à cause d'une famine, enlèvement de Sara dans le harem du pharaon, enrichissement d'Abraham, intervention de Dieu qui « frappe « le pharaon, renvoi d'Abraham et de sa femme sains et saufs) et quelques correspondances lexicales très précises en font le modèle archétypique des événements de l'exode et, à travers eux, du retour d'exil et, encore au-delà, de toutes les errances d'Israël loin de sa terre. 48 Autre exemple : on a pu montrer que le fameux récit de la faute originelle dans le jardin d'Eden (Gn 2-3) annonce très précisément le schéma narratif qui conduit toute l'Histoire deutéronomiste, construit sur la séquence « don du jardin / de la terre - commandement(s) à observer - transgression - châtiments - expulsion du jardin / de la terre «. Ainsi, le récit place aux origines de l'humanité le schéma transgression-sanction qui, selon les théologiens deutéronomistes, annonce et explique la conduite des Israélites depuis leur installation en Canaan, cette « terre ruisselant de lait et de miel « associée au Paradis. Un tel procédé relève pour une part d'une conception mythique du temps, selon laquelle les événements originels fondent la réalité présente et lui servent de paradigme. Mais il suppose aussi une cohérence absolue de l'histoire, dans laquelle les êtres et les événements sont reliés entre eux par de multiples correspondances cachées. L'écrivain inspiré se donne précisément pour tâche d'identifier ces correspondances et de les signaler par divers moyens stylistiques, de manière à expliciter le sens profond des réalités dont il parle. Cette exégèse de l'histoire suppose également une cohérence littéraire et théologique du corpus scripturaire, au sein duquel elle fonctionne en intertextualité. A cette conception de l'histoire, dans laquelle les événements fondateurs des origines structurent et annoncent les événements présents, s'ajouta progressivement, après l'exil, une vision de l'histoire tournée vers l'attente des réalités dernières. Cette nouvelle conception intégrait la prise de conscience de la dimension universelle de l'histoire et l'achèvement d'une théologie pleinement monothéiste. Mais elle prenait surtout en compte les frustrations de populations juives toujours soumises au pouvoir étranger, et qui s'impatientaient de voir advenir la restauration d'Israël promise par les prophètes. Cette représentation de l'histoire tendue vers une eschatologie collective s'annonce dans plusieurs écrits prophétiques post-exiliques, mais s'épanouit dans la littérature apocalyptique à partir du IIème siècle av. J.-C. L'omniprésence des questions relatives au sens de l'histoire, les catégories de Jugement et de Salut appliquée à l'histoire universelle, le report dans l'eschaton, « à la fin des jours «, de la réalisation des promesses et des prophéties, l'abondance et l'importance des visions, tout ces traits appartiennent à la tradition prophétique antérieure, même s'ils sont traités d'une manière particulière. Comme leur nom l'indique, ces écrits relèves d'une littérature de « révélations « (du grec Apokalupteïn, « découvrir, révéler «), révélations qui concernent soit des réalités célestes, soit la signification des événements présents et passés de l'histoire, soit encore le déroulement des événements qui précéderont l'instauration du royaume de Dieu à la fin des temps. Principalement écrite entre le IIème siècle av. J.C. et le IIème siècle de notre ère, cette littérature est surtout transmise en dehors de la collection canonique des livres bibliques - notamment dans la littérature associée à Hénoch - ; mais on lit dans le livre biblique de Daniel les expressions parmi les plus anciennes et aussi les plus saisissantes de cette tradition. Entre autres traits caractéristiques de ces écrits, je retiens ici la division du temps et de l'histoire en périodes ou âges du monde, dont les caractéristiques sont déterminées dès l'origine et font l'objet de 49 ces révélations. L'exploitation de ce thème donne lieu à de nombreux indices chiffrés sur les dates et les computs calendaires, et l'on verra resurgir ces spéculations sur les échéances tout au long de l'histoire occidentale. Autres traits caractéristiques étroitement liés au précédent : l'attente d'une catastrophe mettant fin au monde présent et établissant une rupture radicale entre « ce monde-ci « et « le monde qui vient « ; l'attente aussi d'un salut ou d'une restauration du Peuple élu après la catastrophe finale, à laquelle succède un monde nouveau qualifié de Royaume de Dieu et décrit comme paradisiaque. Ajoutons enfin que le passage à l'eschaton est décrit selon un schéma narratif type qui présente les événements de la fin comme la reprise du combat qui, à l'origine, opposa le Créateur aux forces du chaos ; cette lutte eschatologique conduit ainsi à une véritable recréation du monde dans sa pureté originelle. On ne saurait avoir une vision plus mythique d'un temps linéaire. Les différentes conceptions du temps et de l'histoire dont la Bible a conservé l'empreinte ont trop profondément marqué nos propres représentations pour que nous les ignorions. Il suffit de penser combien elles ont inspiré et nourri d'espérances et d'idéologies en Occident et partout où celui-ci a exporté sa culture44, pour mesurer l'intérêt que représente leur prise en compte dans la formation des futurs adultes. La quête de sens qui s'exprime dans ces représentations de l'histoire est un fait de culture susceptible d'établir un lien extrêmement riche entre faits religieux, histoire et philosophie. Ainsi donc, si l'approche historique déconstruit les modèles mythiques et théologiques qui ont présidé à l'élaboration des documents fondateurs, elle permet également de rejoindre, replacées dans leur contexte, les préoccupations religieuses profondes qui les ont suscités. C'est en faisant la nette distinction entre les schémas théologiques inscrits dans les documents d'une part, et les faits historiques d'autre part, que l'on pourra, me semble-t-il, enseigner l'histoire et les faits religieux sans confusion, mais sans réduire non plus ceux-ci à celle-là. 44 La littérature relative aux courants apocalyptiques et millénaristes depuis le haut Moyen-Âge est consi- dérable ; je signale simplement ici deux titres classiques et un ouvrage récent livrant suffisamment de bibliographie : Norman COHN, Les Fanatiques de l'Apocalypse, Julliard, Paris, 1962 (Payot, 198 ? ?) ; Vittorio LANTERNARI, Les Mouvements religieux des peuples opprimés, Maspéro, Paris, 1962 (Maspéro-La Découverte, 1983) ; André VAUCHEZ (dir.), L'Attente des temps nouveaux : eschatologie, millénarismes et visions du futur du Moyen-Âge au XXe siècle, Brepols, Turnhout, 2002. 50 L'approche historique des figures religieuses : Muhammad Alfred-Louis de Prémare, professeur à l'Université de Provence L'approche historique de la personne et de l'action de Muhammad se heurte à une très grande difficulté, celle du traitement des sources disponibles. Pour illustrer cette difficulté, je citerai un historien des débuts de l'islam, Maxime Rodinson, deux fois successivement, parlant à deux années de distance. Voici ce qu'il disait en 1961 dans l'introduction à sa biographie de Muhammad : « Une biographie de Mahomet qui ne mentionnerait que des faits indubitables, d'une certitude mathématique, serait réduite à quelques pages et d'une affreuse sécheresse. Il est pourtant possible de donner de cette vie une image vraisemblable, parfois très vraisemblable. Mais il faut, pour cela, utiliser des données de sources sur lesquelles nous n'avons que peu de garanties de véracité45. « Deux ans après, en 1963, dans un article très riche où il dressait un « Bilan des études mohammediennes « , il estimait que, quoique délicat à utiliser, le Coran est, « parmi les sources de la biographie de Mohammed, la seule qui soit à peu près entièrement sûre46 «. Ces deux citations, un peu paradoxales, nous incitent à examiner la situation intellectuelle dans laquelle nous nous trouvons à propos d'une biographie éventuelle du fondateur de l'islam, ou, au moins, d'une présentation approximative de sa « figure «. Le Coran est-il « la seule source à peu près sûre « pour une biographie de Muhammad ? En disant cela du Coran, M. Rodinson se faisait l'expression d'une sorte de consensus des historiens des débuts de l'islam qui nous ont précédés. Jusqu'à une date récente, ce consensus s'appuyait sur la certitude qu'avec le Coran, ils avaient affaire à un document ancien, témoignant de la prédication de Muhammad, et mis par écrit peu de temps après la mort du fondateur (632), durant le califat de 'Othmân, son troisième successeur (644-656). Cette base de départ était confortée par les travaux historico-critiques des orientalistes allemands de l'école de Nöldeke, à la fin du XIXème et au début du XXème siècle.47 Mais cette certitude a été battue en brèche, depuis, par différents chercheurs. D'une part, c'est de sources islamiques tardives et unilatérales que nous tenons l'affirmation que le Coran est entièrement la prédication de Muhammad. D'autre part, l'examen du Coran lui-même nous indique que ce livre est 45 Maxime RODINSON, Mahomet, Seuil, coll. « Politique «, Paris, 1961, p. 12 . 46 Maxime RODINSON, « Bilan des études mohammediennes «, in Revue historique, CCXXIX, janvier-mars 1963, p. 192. 51 un corpus, la compilation de traditions fragmentaires et souvent hétérogènes, dont certaines peuvent être anciennes, mais dont d'autres portent la marque de son histoire éditoriale bien au delà du califat de 'Othmân. Pour ma part, lorsque je lis le Coran, je trouve étrange que l'on ait pu le considérer comme étant la seule base, « à peu près sûre «, pour établir une biographie du fondateur de l'islam. En effet, le Coran ne se présente absolument pas comme un document historico-narratif. Il ne comporte aucune narration sur Muhammad ou sur les événements du début de l'islam, à l'exception de quelques bribes purement allusives. Cette base estimée « sûre « me semble bien aléatoire lorsqu'il s'agit d'histoire et, plus particulièrement, de « biographie «, où il s'agit « d'écrire une Vie « et de présenter son personnage central. J'évoquerai quelques illustrations de ce caractère aléatoire, faute de ne pouvoir aller plus loin dans le cadre limité de cet exposé. Ces illustrations sont, cependant, significatives. Le nom de Muhammad n'apparaît que quatre fois dans le Coran : deux fois pour affirmer qu'il est l'envoyé de Dieu, une fois pour dire que le Coran est « descendu « sur lui, et une fois pour dire, dans un contexte particulier concernant une allusion à l'un de ses mariages contestés, qu'il est le sceau des prophètes. C'est même le seul cas où, à côté de Muhammad, apparaît le nom de l'un de ses compagnons, Zayd. Mis à part ce Zayd, dont on nous parlera ailleurs que dans le Coran, rien n'est dit, dans celui-ci, sur les grands « Compagnons « historiques figurant dans toute biographie de Muhammad comme étant, à ses côtés, des sortes de co-fondateurs : Abû-Bakr, 'Omar, 'Othmân, 'Alî, et beaucoup d'autres. Rien sur ceux qui auraient été ses scribes, ses familiers, etc. Plusieurs fois, il est fait allusion à certaines de ses épouses, mais de façon très contournée, et sans jamais qu'aucun nom n'en soit donné. S'il fallait nous appuyer uniquement sur le Coran, nous serions bien en peine de savoir de qui il s'agit ni, surtout, de quoi il s'agit. Le nom de La Mecque n'apparaît qu'une fois (48, 23) à propos d'un événement sur lequel, à s'en tenir au texte, on se demande de quoi il s'agit. Le nom de Quraysh, la tribu mecquoise de Muhammad, apparaît une fois seulement, dans un petit texte archaïque et tronqué, difficile à situer dans un contexte précis, où il n'est même pas indiqué que c'était la tribu de Muhammad et des principaux compagnons fondateurs ; ce texte de quelques lignes qui constitue actuellement la sourate 106 a fait couler beaucoup d'encre et d'imagination sur son interprétation possible. Aucun autre nom de tribu du Hedjâz n'apparaît dans le volume. Ce n'est donc pas par le Coran que nous pouvons connaître certains éléments importants du milieu socio-historique dans lequel est né l'islam, ni même quelques données sûres sur la figure de son fondateur. Nous avons deux allusions à deux expéditions militaires : une bataille à Badr, une fois (3, 123) ; une bataille à Hunayn, une fois (9, 25) ; chaque fois pour dire que Dieu avait assisté les musulmans. Ceci, sur le plan de l'information, est plutôt maigre lorsqu'on connaît les développements pléthoriques ultérieurs de la littérature islamique sur la bataille de Badr, par exemple : c'est la geste islamique 47 Theodor NÖLDEKE et alii, Geschichte des Qorans, I-III, Leipzig, 1919-1938. 52 guerrière par excellence, dont les développements littéraires tardifs traceront le cadre dans lequel furent définies les lois sur la répartition du butin. Le nom de la ville de l'hégire, Yathrib (la future Médine), figure une seule fois (33, 13-14), apparemment dans un contexte de dissension et de guerre, mais l'indication en est purement allusive. C'est bien maigre lorsqu'on apprend par ailleurs l'importance de l'hégire à Yathrib, qui fut l'an I de l'ère islamique. Le nom de « Médine « - al-madîna -, littéralement « la ville «, apparaît éventuellement trois fois, si toutefois il s'agit de « la Ville « du prophète, c'est-à-dire Yathrib ; c'est, chaque fois, dans des indications purement allusives, sans qu'aucune précision ne soit donnée sur le contexte. Si le mot veut désigner Médine, on peut même se demander, parfois, s'il s'agit de la Médine du temps de Muhammad (33, 60 ; 9, 101 et 120). En fait, les pôles historiques, géographiques et sociaux, que nous jugerions essentiels pour servir à une éventuelle biographie, se réduisent à cela. C'est bien peu. De plus, si nous parcourons les textes faisant allusion à quelque événement, ou à des controverses, nous en ressortons généralement avec la question suivante : qui parle à qui, de qui ou de quoi et dans quelles circonstances de temps ou de lieu ? Il n'existe aucun cadre narratif, fût-il fictif, qui puisse nous aider à y voir un peu plus clair. Qui sont « les Fils d'Israël « ? ceux de l'ancien temps ou ceux des débuts de l'islam ? et à quels temps de ces débuts ? Les juifs, les chrétiens, les hypocrites : qui sont-ils, à quels moments, en quels lieux ? « Les infidèles disent « : qui sont ces infidèles ?, etc. La littérature des commentaires essaiera de recomposer, pour chacune de ces allusions, un cadre historico-narratif. Mais cette littérature ne commencera à se faire jour et à quitter le domaine insaisissable d'une transmission que l'on qualifie d'orale que près de cent ans après la mort du fondateur, et les explications en seront très souvent contradictoires. Je reparlerai de cela dans un instant à propos de la littérature dite des « circonstances de la révélation «. Maigreur des sources et des données documentaires externes sur le berceau de l'islam. Les données externes, archéologiques et épigraphiques concernant l'Arabie occidentale, le Hedjaz, au début du VIIème siècle, qui pourraient pallier cette indigence et nous aider à situer les textes coraniques dans un ensemble, sont tout aussi maigres. Ces données existent avec une relative abondance pour le Yémen jusqu'à la fin du VIème siècle. Les inscriptions sud-arabiques ne manquent pas jusqu'à cette époque. Elles permettent d'appuyer les données historico-littéraires fournies par les auteurs du VIème siècle, par exemple le Livre des guerres de Procope, historien de Justinien, Empereur romain d'Orient (527-565). De plus, le Yémen était un pays de vieille civilisation sédentaire. Nous en avons des vestiges et des données sûres : par exemple la fameuse digue de Ma'rib sur le fleuve Dhana, et les attestations des derniers travaux entrepris pour sa réparation en 549 sous le règne du roi du Yémen Abraha, le royaume yéménite étant alors dans la mouvance chrétienne : ceci, avec bien d'autres données, est inscrit dans un très long texte gravé sur la fameuse stèle de Ma'rib. Mais à l'époque des débuts de l'islam, plus de soixante-dix ans après, cette 53 digue n'était plus en usage et avait été conquise par le désert. Un passage du Coran y fait allusion (34, 15-17) : le texte coranique voit dans cette usure du temps le châtiment de Dieu sur le peuple infidèle des Saba', dénomination antique de la population sud-arabique à partir de sa tribu dominante. Comme on sait, le royaume sud-arabique de Saba' est antérieur à notre ère de plusieurs siècles. Le Coran ne donne donc aucune information historique sur ce que Muhammad aurait pu voir de ces vestiges. Son objet est d'annoncer le châtiment apocalyptique destiné aux infidèles. Saba' et Ma'rib sont seulement des exempla antiques appropriés à cette annonce, comme bien d'autres sur les anciens peuples disparus. De même, nous avons les attestations épigraphiques et littéraires à la fois de la diffusion puis de l'implantation du judaïsme au Yémen dès le IVème siècle de notre ère. Par les sources littéraires grecques et syriaques, faute de pouvoir faire des fouilles sur le site jusqu'à présent, nous connaissons l'implantation du christianisme dans la grande oasis, agricole et commerciale, de Najran, au nord du Yémen (actuellement en Arabie saoudite). Les chrétiens y subsisteront longtemps après l'expansion de l'islam. Aussi l'historiographie arabe prendra-t-elle, à sa manière, le relais de l'information. Tout ceci concerne le Yémen, mais généralement loin dans le temps et l'espace. De toute façon, nous n'avons rien de tel pour le Hedjâz, berceau de l'islam au début du VIIème siècle. Même les implantations importantes du judaïsme dans les populations arabes de la chaîne d'oasis, depuis Yathrib en remontant vers le Nord le long du Wâdî al-Qurâ, ne font l'objet d'aucune documentation externe de quelque sorte que ce soit, et nous n'avons accès à la connaissance de ces communautés qu'à travers les sources de l'histoire sainte islamique. Il faut remarquer aussi le silence total des sources talmudiques sur ces communautés. On aurait pu espérer qu'elles en parlent, par exemple dans des notations sur des rabbins qui auraient pu figurer dans des filières d'enseignement ; mais il n'y a rien, et rien non plus, d'ailleurs, en ce qui concerne l'ancienne implantation judaïque au Yémen, alors que celle-ci est attestée par les documents épigraphiques. En fait, les juifs du Hedjaz, au VIIème siècle, ne semblent exister que dans le miroir de l'histoire sainte islamique. Est-ce à dire qu'ils n'existaient pas ? Loin de là. Mais les sources islamiques nous en donnent-elles des informations qui correspondent à la réalité ? Là est la question, qui fait, d'ailleurs, l'objet d'études approfondies actuellement48. Enfin, nous n'avons aucune documentation archéologique sur les religions traditionnelles des Arabes du Hedjâz que l'on pourrait qualifier de « païennes «. Nous en avons en Arabie intérieure, à Qaryat al-Fâw, mais pour une période bien antérieure, entre les IIème et Vème siècles, avec un écart d'un siècle et demi entre les dernières de ces données archéologiques et le début de l'islam au Hedjaz. Pour connaître ce que pouvait être le « paganisme arabe « au Hedjaz du temps de Muhammad, nous en sommes réduits aux matériaux de la littérature islamique traditionnelle tardive sur les idoles qui auraient fait l'objet d'un culte à cette époque. Ces matériaux ne sont pas dépourvus d'intérêt. Mais un 48 Cf. Michael LECKER, Muslims, Jews and Pagans. Studies on Early Islamic Medina, Brill, Leiden, 1995. 54 ouvrage récent de Gerald R. Hawting 49 montre à quel point ces données sur les idoles, que l'on a longtemps considérées comme fiables, sont elles aussi largement tributaires de la littérature exégétique sur le Coran ou de la perspective apologétique de « l'histoire sainte « de l'islam. Si bien que nous ne savons pas vraiment à quel genre de « païens « se serait adressée ce qui aurait été la première prédication de Muhammad à La Mecque, ni même à quel moment les textes invoqués s'adressent à des païens. A qui, par exemple, s'adressait le Coran lorsqu'il parlait « d'associateurs «, ceux qui donnent des associés à Dieu, donc, en principe, des idolâtres ? Nous le savons d'autant moins que les juifs et les chrétiens eux-mêmes, dans les polémiques coraniques, sont plus d'une fois catégorisés comme « associateurs « et « infidèles «. Nous le savons d'autant moins encore si nous remarquons que l'accusation d'« associationnisme « et d'« infidélité « fut portée souvent, aux premiers siècles de l'islam, par des musulmans les uns contre les autres, lorsqu'ils polémiquaient sur leurs propres idées politiques ou religieuses. Nous pouvons penser que le « paganisme « existait sans doute encore au temps de Muhammad. Mais quel était ce « paganisme « ? Il faudra sans doute attendre longtemps avant que des fouilles archéologiques soient permises à La Mecque, à Médine ou dans le Hedjaz, et donc pour que l'histoire puisse en dire un mot quelque peu assuré. Pour l'instant, nous ne pouvons faire que des hypothèses en projetant sur le Hedjaz des données attestées pour des régions situées beaucoup plus au Nord, le Néguev ou les steppes syro-jordaniennes par exemple. La littérature islamique traditionnelle est pléthorique, tardive et interprétative. En fait, toutes les « biographies de Muhammad « qui ont vu le jour depuis la seconde moitié du ème XIX siècle jusqu'à présent ont été basées sur la littérature islamique traditionnelle. Celle-ci, en regard de la maigreur des données externes, est pléthorique: Il s'agit du Hadîth, de la Sîra, et de l'exégèse coranique narrative appelée Circonstances de la révélation. Le Hadîth est devenu un nom générique servant à désigner les énormes corpus de traditions relatant dits, faits et gestes de Muhammad, et qui se sont constitués à partir du VIIIème siècle, plutôt la seconde moitié que la première moitié de ce siècle. Les grands corpus canoniques datent du IXème siècle. Ce sont donc des compilations tardives, organisant certaines collections antérieures en les amplifiant et en les augmentant de données nouvelles dont un très grand nombre, selon les experts musulmans anciens eux-mêmes, sont apocryphes. De plus, ces corpus correspondent à un projet particulier : Muhammad est « le beau modèle « (Coran 33, 21) : chacun de ses dits, faits et gestes, voire de ses silences, a valeur normative pour la communauté des croyants de l'islam. Ceux-ci, aux temps où se mettaient en place ces corpus, avaient connu une expansion militaire rapide dans les pays du Proche-Orient, en Egypte, puis au Maghreb et en Andalousie. A partir du VIIIème siècle, la communauté islamique était en train d'établir sa pratique 49 Gerald R. HAWTING, The Idea of Idolatry and the Emergence of Islam, Cambridge University Press, Cambridge, 1999. 55 rituelle, ses lois sociales, politiques, militaires, ses rapports avec les non-musulmans de son empire, etc. En somme, elle définissait son orthodoxie ou, plutôt et surtout, son « orthopraxie «, sa Sunna, sa pratique normative autorisée et fondée sur le modèle prophétique - d'où le nom de « sunnite «. La figure, les « dits « - hadîth-s - du prophète, les faits et gestes qu'on lui attribuait remplissaient une fonction d'exemplarité. Le prophète, « beau modèle «, était un symbole et un emblème, projeté sur un passé que l'on présentait comme réalité d'histoire. Sans doute certains éléments de cette pratique normative s'enracinaient-elles dans l'époque primitive de l'islam. Mais une masse d'autres s'enracine dans un ailleurs bien plus tardif. Or à chaque fois, pour justifier une prescription légale, une ordonnance morale, une tenue vestimentaire, une pratique rituelle ou alimentaire, un comportement social ou domestique, il y a un récit, une anecdote biographique à la clé, où Muhammad est mis en scène pour dire : c'est en telle et telle circonstance, avec tel et tel de ses contemporains, que la pratique a été édictée ou que le modèle a été fourni par « l'envoyé de Dieu «. C'est en grande partie dans cette perspective que s'est construite peu à peu la « biographie « islamique du prophète. La biographie islamique du prophète En effet, beaucoup de hadîth-s particuliers, toujours à partir du VIIIème siècle, ont été compilés pour constituer une biographie du prophète de l'islam plus ou moins ordonnée chronologiquement. Le noyau premier de ces compilations s'est constitué autour des récits concernant les « Expéditions militaires de l'envoyé de Dieu «, les Maghâzî. Tel ou tel transmetteur de traditions de ce type, à partir du VIIIème siècle, était dit avoir rassemblé « les Expéditions « du prophète. On disait qu'il était expert en « Maghâzî «, la geste glorieuse des premiers temps. Le mot Expéditions fut donc le terme générique pour désigner ce genre littéraire, fait de compilations partielles de récits de guerre de provenances diverses. Le cadre spatio-temporel, c'était Yathrib / Médine, à partir de l'an 1 de l'hégire, et les récits concernaient la conquête islamique à l'intérieur de la Péninsule arabe. Peu à peu, on y ajouta d'autres éléments biographiques sur le prophète : sa famille, sa naissance, son enfance et son adolescence (une jeunesse hagiographiquement prédestinée comme l'avait été celle de Jésus), son envoi en mission par l'ange (à l'image de certains prophètes d'Israël), sa première prédication à La Mecque, la persécution par ses compatriotes (car tout prophète doit avoir été persécuté par les siens), et enfin la rupture d'avec La Mecque et l'hégire, l'an I de l'islam. Alors commence la partie Expéditions . En fait, ce fut celle-ci qui, littérairement, précéda. Le premier à avoir organisé un ensemble de traditions alliant Expéditions et Vie du prophète de l'islam fut Ibn Ishâq (mort en 767). Il le fit, dit-on, sur la commande du deuxième calife abbasside, c'est à dire entre 754 et 767, date de sa propre mort. Mais nous n'avons aucun ouvrage d'Ibn Ishâq lui-même. Nous ne connaissons ce qu'il enseignait en la matière que par des recensions provenant de disciples de ses disciples : notes prises sous la dictée ou dans un enseignement oral. Nous en avons trois recensions principales, transmises aux IXème siècle, et qui comportent entre elles de grandes variations, mais sur un schéma commun. Il en a existé d'autres, dont on retrouve sporadiquement la 56 trace dans des ouvrages historiographiques ultérieurs, mais que nous n'avons plus en tant que recensions complètes. La recension la plus connue, et qui est devenue quasiment la version reçue de la Vie du prophète, est celle d'Ibn Hishâm. Celui-ci, au IXème siècle, réorganisa, sélectionna, ajouta, corrigea, amenda l'une des compilations issues des disciples d'Ibn Ishâq et donna à son ouvrage le titre de Sîra, ou Vie du prophète. Il existe d'autres sources du même genre, notamment la première partie de l'ouvrage d'Ibn Sa'd (Bagdad, mort en 845), ou l'ouvrage de Wâqidî (Bagdad, mort en 823), centré sur les Expéditions. C'est à partir de ces ouvrages de biographie traditionnelle qu'un auteur anglais contemporain, Martin Lings, a rédigé sa Vie du prophète « d'après les sources les plus anciennes «, précise-t-il50. Les « sources les plus anciennes « datent de la fin du VIIIème siècle et surtout du IXème siècle. Nous avons dans cet ouvrage, un reflet intéressant de ce que peut être le genre littéraire de la Sîra prophétique, en notant que celle de Martin Lings est un nouvel arrangement de sources tardives harmonisées, une nouvelle Sîra, en somme, sans aucune préoccupation critique. Un ensemble de données de la Sîra prophétique est constitué par ce que l'on appelle asbâb al-nuzûl « Les circonstances de la révélation «. Ces données ont pour base l'exégèse narrative du Coran. Le Coran est un corpus dont les rares indications historiques, comme je l'ai fait remarquer, ne sont qu'allusives : aucun cadre narratif ne précise de quoi ni de qui il s'agit. Il fallait donc fournir aux textes coraniques le cadre narratif qui leur manquait et pouvoir dire que c'était en telles et telles circonstances que tel passage du Coran, telle sourate, tel verset, étaient « descendus « sur le prophète. D'où le nom de asbâb al-nuzûl, littéralement « causes occasionnelles de la descente « des versets coraniques, plus habituellement traduit par Circonstances de la révélation. Un exemple : l'envoi en mission de Muhammad Un des exemples types en est le récit de l'envoi en mission de Muhammad par l'ange Gabriel. Le problème qui était posé par les récits concernant ce sujet était le suivant : quelle fut la sourate du Coran qui « descendit « la première sur le prophète et quel fut l'événement déclencheur de sa carrière prophétique ? Comme le Coran n'en dit rien, il y eut plusieurs propositions. J'en connais au moins trois. En y ajoutant l'option de certains savants anciens pour le : « on ne sait pas «, cela fait quatre possibilités. Une version a fini par dominer dans l'opinion consacrée par l'orthodoxie sunnite : la première sourate descendue fut la sourate 96 ou, à tout le moins, disent les plus prudents, les 5 premiers versets de cette sourate. On trouva donc, pour ces versets, un récit-cadre qu'on attribua à Muhammad racontant lui-même l'événement, et la transmission de ce récit fut attribuée à l'une de ses épouses, 'Aïcha. C'est le récit consacré de la grotte de Hirâ', tellement connu qu'il a pris place dans certains de nos manuels scolaires de la classe de Cinquième. On y fournit même parfois la date exacte de l'événement, l'année 610 : l'ange Gabriel apporte la sourate à Muhammad alors que celui-ci est en 50 Martin LINGS, Le Prophète Muhammad. Sa vie d'après les sources les plus anciennes, Seuil, Paris, 1986. 57 retraite dans une grotte proche de La Mecque, et il lui dit par trois fois : « Proclame ! «, premier mot de la sourate. « Que proclamerai-je ? « répond l'inspiré à chaque fois, etc. Bien qu'il fût attribué au prophète lui-même par l'intermédiaire de l'une de ses épouses, 'Aïcha, il a été composé longtemps après l'événement et même longtemps après la mort du fondateur : il y a donc déjà un décalage dans le temps. De plus, c'est un récit de synthèse, une composition littéraire réalisée à partir d'éléments disparates. On retrouve dans différents corpus de traditions chacun de ces éléments disjoints et isolés, sans même parfois que 'Aïcha y soit citée comme informatrice. Ou bien on en a l'écho dans des récits de synthèse agencés différemment, mais qui ne s'accordent pas avec celui attribué à 'Aïcha : la grotte de Hirâ' n'y figure pas et ce n'est pas la sourate 96 qui est concernée, mais une autre. Enfin, on peut remarquer que ce récit-cadre est directement inspiré d'un passage du livre biblique d'Isaïe (40, 6) : « Une voix dit : "Proclame !", et je dis : "Que proclamerai-je" ? «. Le récit devenu canonique est donc le produit d'une composition combinée. Inspiré du modèle biblique, c'est à partir d'une sélection effectuée dans des données disparates qu'il s'est organisé en un savoir catéchétique de consensus, lequel est devenu un « croire «. On aurait pu espérer, pour en avoir le coeur net, qu'une information ou une allusion à la grotte de Hirâ' soit donnée dans le Coran, au moins dans la sourate 96 elle-même. Il n'en est rien, et pas davantage dans le reste du corpus coranique. Il s'agit donc d'un récit du genre littéraire des Circonstances, reposant sur des « on dit « des VIIIème et IXème siècles, à l'exclusion d'autres « on dit «. Rien n'en figure même dans le plus ancien commentaire coranique que nous avons en entier, celui de Muqâtil (m. en 765) : celui-ci, pour les 5 premiers versets de la sourate 96, fournit de tout autres Circonstances, dans un cadre polémique mettant en scène un oncle du prophète réfractaire à la prédication de son neveu. Chaque fois que l'oncle païen présente une objection, un verset descend pour le contredire. En fait, ce que l'on appelle « la biographie de Muhammad « est très marqué par le genre littéraire dit des Circonstances de la révélation. Ceci a été souligné par R. Blachère en 1952, dans son ouvrage Le problème de Mahomet : « La Sîra ou "Vie de Mahomet" a pour substrat des allusions ou des expressions contenues dans le Coran, avec toutefois ce correctif que ce substrat n'est ni toujours identique ni toujours aussi ferme, en sorte que le midrasch qui se fonde sur lui varie également de sens et d'allure, selon la date des passages coraniques invoqués51. « La Sîra serait donc une sorte de grand midrasch, à l'image des commentaires narratifs de la tradition exégétique juive sur les textes bibliques. De toute manière, c'est « un sens « qu'elle veut délivrer, et « l'histoire « doit se plier à ce sens. Ce n'est donc pas un document d'histoire proprement 51 Régis BLACHERE, Le problème de Mahomet, P.U.F., Paris, 1952, p. 10-11. 58 dit, mais au mieux une histoire interprétée ; c'est l'« histoire islamique du salut «, dira le chercheur anglais J. Wansbrough plus récemment52. Que pouvons-nous faire de ces matériaux ? Connaissant la nature de ces matériaux, la perspective et le projet de leurs auteurs, les destinataires des oeuvres et des récits divers qu'ils contiennent, et même le contexte historique des VIIIème et IXème siècles au Proche-Orient, nous pouvons en dégager, au moins et tout d'abord, les significations que les musulmans, à partir du VIIIème siècle et jusqu'aujourd'hui, ont donné à leur histoire. L'historicité des événements qui sont relatés est sans doute aléatoire ; mais ce qui est relaté est emblématique pour la communauté qui le reçoit et le transmet. L'une des significations fondamentales concerne le prophète Muhammad en tant que « modèle « à imiter. Une plongée dans le Hadîth à ce propos, quelle qu'en soit la forme - hadîth-s dispersés, Expéditions, Sîra, Circonstances - peut nous révéler la prégnance de ce modèle jusqu'à nos jours dans la pensée et l'enseignement religieux, donc chez nombre de nos élèves musulmans qui suivent cet enseignement. Je ne peux qu'inciter les enseignants à faire cette plongée eux-mêmes, mais non pas dans les sélections expurgées et apologétiques diffusées à l'usage des Occidentaux. Pour connaître en quoi consiste ce modèle et comprendre en quoi il est tout à fait décalé par rapport à un enseignement qui se veut laïc, c'est dans les sources elles-mêmes qu'il faut aller voir. C'est difficile. Mais c'est possible53. Faute de l'avoir fait au moins pour soi-même, le décalage et l'incompréhension ne cesseront d'augmenter. Dans le contexte actuel, cela risque de devenir grave. C'est donc là une première chose, très importante à percevoir, si nous voulons connaître l'univers de pensée dans lequel se situe la culture religieuse des musulmans jusqu'à nos jours. Celle-ci est peu touchée par la perspective « critique « appliquée aux traditions religieuses et qui nous est plus familière. En particulier et sauf exception, le fil rouge de l'« étude critique « sur le Coran n'est jamais franchi, même par des universitaires que l'on estime être de culture moderne54. « On ne peut pas critiquer Dieu «, comme me disait une étudiante, jouant sur l'ambiguïté du mot « critique «. La littérature traditionnelle est-elle vide d'informations historiques ? C'est la seconde question importante qu'il faut se poser à propos des matériaux traditionnels. 52 John WANSBROUGH, The Sectarian Milieu. Content and Composition of Islamic Salvation History, Oxford University Press, Oxford, 1977. 53 Les librairies islamiques des grands villes, en France, ne manquent pas d'ouvrages et de manuels catéchétiques qu'il est intéressant de connaître et d'étudier. 54 Cf. par exemple l'univers de pensée dans lequel se situe Azeddine GUELLOUZ, dans son petit livre Le Coran, Flammarion, coll. Dominos, Paris, 1996. En 1996, l'auteur était professeur à Paris I. 59 Il est certes utile de nous rappeler le jugement de l'orientaliste italien du début du siècle dernier, Leone Caetani. Celui-ci fut l'auteur d'une énorme encyclopédie textuelle en 10 volumes, parue entre 1905 et 1926 sous le titre Annali dell'Islam : recueil de textes de la littérature historico-biographique islamique traditionnelle sur les débuts de l'islam, traduits, annotés, critiqués55. A l'issue de son parcours, il tirait « la conclusion pessimiste que nous ne pouvons trouver presque rien de vrai sur Muhammad dans la Tradition, et pouvons écarter comme apocryphes tous les matériaux traditionnels que nous possédons «. Cette conclusion est pourtant excessive. Peut-on dire vraiment que ces matériaux traditionnels sont vides de toute information véritable ? Je ne le crois pas. De même, le Coran, à sa manière, n'est pas vide d'informations. Mais il faut apprendre à le lire, et cela ne se fait pas à coup de citations. Derrière tout cet ensemble, il y a des informations que l'on peut dégager. C'est là précisément que se place le travail de l'historien et, au delà de l'historien, du critique littéraire, voire du théologien. En ce qui concerne l'histoire, on peut, à partir des matériaux de la littérature biographique islamique classique autour de Muhammad et des débuts de l'islam, dégager un certain nombre de données relativement solides. De l'avis de plusieurs chercheurs contemporains, ces données se trouvent surtout dans la partie « Expéditions « (Maghâzî) qui concerne les débuts de l'islam à Yathrib / Médine, moins obscure que ce qui est appelé la « période mecquoise « de la vie du fondateur. Ce n'est pas pour rien, à mon avis, que les premiers musulmans ont eux-mêmes choisi la fondation de la première communauté islamique à Yathrib comme point de départ de leur ère particulière : l'an I, pour eux, ce n'était pas tant l'envoi du prophète en mission par l'ange Gabriel que l'hégire à Yathrib. Nous avons même, dans les sources islamiques, la reproduction d'une sorte de document écrit de fondation qui tranche visiblement avec beaucoup d'autres données : c'est la charte de Yathrib, autrefois appelée de façon impropre par les orientalistes « constitution de Médine «56. Quoi qu'il en soit des débats érudits sur la valeur historique de ce « document «, celui-ci donne une idée valable des bases et de l'esprit de cette première fondation de l'islam, et du rôle du fondateur. D'autres études minutieuses ont été faites sur un certain nombre d'événements particuliers développés dans la littérature islamique d'Expéditions57. L'analyse aboutit plus d'une fois à des résultats intéressants et probants. Certes, ce qui en reste est souvent « d'une affreuse sécheresse «, selon l'expression de Maxime Rodinson. Mais cette sécheresse, finalement, n'est pas si affreuse que cela et elle est précieuse et de bon aloi pour l'historien. Il faut simplement accepter de sortir du cadre du « roman historique « qui est si souvent celui des biographies de Muhammad d'usage courant. 55 Leone CAETANI, Annali dell'Islam, 10 vol., Milan, 1905-1926. 56 Un aperçu dans Alfred-Louis de PREMARE, Les fondations de l'islam, Seuil, Paris, 2002, chap. 5. 57 Cf. en particulier Harald MOTZKI (dir.), The Biography of Muhammad. The Issue of the Sources, Brill, Leiden, 2000, notamment la partie II. 60 Cependant, pour bien comprendre les données traditionnelles, je pense que nous devons également sortir du cercle fermé des sources islamiques et tenter de situer cette histoire devenue emblématique dans un ensemble plus vaste. Le domaine arabe du Nord : Syrie-Jordanie-Transjordanie et Mésopotamie. Nous n'avons pratiquement aucune donnée externe, archéologique ou épigraphique, sur le Hedjâz au VIIème siècle. En revanche, nous sommes relativement mieux documentés sur ce que j'appellerai le domaine arabe du Nord. Il s'agit des populations arabes établies de longue date dans les franges steppiques de la Jordanie, de la Transjordanie et de la Syrie. Il s'agit aussi des populations arabes qui étaient établies le long des rives du Tigre et de l'Euphrate en Irak. Les Arabes, dans ces régions, étaient même représentés par des pouvoirs politiques arabes locaux : les Ghassân à l'ouest, alliés des Byzantins, et les rois de Hîra, en Mésopotamie, alliés des Perses. Les documents littéraires, voire épigraphiques, sont représentés notamment par les sources syriaques, grecques et persanes, et parfois arabes mêmes (par exemple, les premières inscriptions en écriture arabe au VIème siècle, les inscriptions arabes du Néguev dont certaines sont antérieures ou contemporaines des débuts de l'islam, etc.). Il nous faut connaître, au moins dans ses grandes lignes, ce background à la fois politique, religieux et culturel et linguistique des royaumes arabes du Nord avant l'islam et aux débuts de l'islam : les options religieuses monophysites des rois de Ghassân ; la diversité des courants religieux représentés dans le royaume arabe de Mésopotamie (manichéens, nestoriens, jacobites) ; les vieilles coutumes religieuses arabes de certains rois de Hîra, le christianisme de certains autres ; l'histoire de l'écriture arabe antérieurement à l'islam, les cours littéraires autour des rois arabes ; les anciens témoins de la poésie arabe archaïque, source essentielle pour l'établissement des canons de la langue arabe classique ; les relations constantes, par les voies commerciales, entre le domaine arabe du Nord et le coeur de la Péninsule elle-même, etc. Tout nous dit, même dans la littérature islamique, que le Hedjaz non seulement n'était pas isolé de cette ensemble, mais encore qu'il était orienté culturellement et commercialement vers le Nord, comme il était orienté, de l'autre côté, vers le Sud, Yémen et Ethiopie. Enfin, nous ne manquons pas d'informations externes dans la littérature historiographique sur la conquête arabe dans le Proche-Orient et en Egypte : les chroniques syriaques, grecques, arménienne et copte et les récits sur les conquêtes que nous trouvons plus tard dans l'historiographie de langue arabe elle-même. Chacune de ces sources, dans sa perspective propre, est importante si nous voulons connaître non seulement les événements, mais surtout l'état d'esprit des uns et des autres à propos du phénomène nouveau de l'expansion conquérante des Arabes venus du Sud. L'étude du Coran lui-même peut grandement profiter de cette ouverture sur le large. Je me borne ici à évoquer l'histoire des mots, toujours significative de quelque chose de plus important qu'euxmêmes. Peut-on ignorer, par exemple, que des mots importants et structurants pour la perspective religieuse islamique sont issus de l'hébreu, de l'araméen et du syro-araméen dit syriaque, voire de 61 l'éthiopien et du persan ? Des mots, certes, mais pas des moindres : Qur'ân (Coran), Salât (prière), sûrat (sourate), janna ou firdaws (paradis), etc. Le mot mushaf (codex), qui deviendra usuel pour désigner le corpus coranique, est un mot éthiopien, déjà repéré comme tel par les philologues arabes anciens, comme bien d'autres de ceux qu'ils appelaient les termes « arabisés « du Coran. Le mot Tûr (montagne) est un mot syriaque. C'est par lui que commencent deux sourates (95 et 56) sous la forme de serments évoquant respectivement le Sinaï et le mont du Temple à Jérusalem. Le mot Safara (scribes), qui désigne les porteurs des écritures saintes antérieures, est l'arabisation des Soferîm juifs (sourate 80, 15). Les mots ne sont que des signes. Lorsqu'on étudie le Coran, on voit que ces signes indiquent des choses plus importantes qu'eux-mêmes, qu'ils situent bien la naissance de l'islam dans un contexte spatio-temporel élargi et non dans un petit canton que l'on estimerait perdu et isolé en Arabie occidentale. C'est dire que, si nous avons quelques raisons de nous défier, sur le plan historique strict, d'une « biographie de Muhammad « formée unilatéralement sur ce que nous en disent les sources islamiques traditionnelles, nous ne sommes pas démunis d'outils d'analyse pour situer cette biographie ellemême, les débuts de l'islam et la constitution de ses écritures, dans le temps et l'espace plus larges du Proche-Orient aux VIème, VIIème et VIIIème siècles de notre ère. Conclusion Pour ce qui est de l'enseignement du « fait religieux « islamique à ses débuts, se concentrer sur une « biographie de Muhammad « risque de nous replonger inévitablement dans le catéchisme, avec tous les risques d'affrontements entre des élèves formés à ce catéchisme et des enseignants qui prétendraient leur donner le fin mot de « l'histoire « à ce sujet. Je n'ai pas la prétention de dire ce qu'il faut faire concrètement devant une classe où se trouvent des élèves musulmans. J'entrevois ce que l'on pourrait faire éventuellement pour proposer aux professeurs, en ces matières, des outils d'enseignement appropriés qui, les aidant à sortir des discours conventionnels pleins de « bonnes intentions «, les mettent dans une dynamique de recherche intellectuelle à partir d'informations exactes. Mon propos, en conclusion, sera donc axé sur l'acquisition par les enseignants d'une bonne connaissance des sujets abordés au cours de cet exposé. Cette connaissance devrait, à mon avis, porter sur deux points essentiels. Tout d'abord la plongée, dont j'ai évoqué la nécessité il y a un instant, dans l'univers propre aux sources islamiques traditionnelles interprétant l'histoire de l'islam primitif ; tout particulièrement lorsqu'elles se réfèrent au « beau modèle « que représente pour elles la figure de Muhammad. Ces références, en effet, n'ont rien perdu de leur impact aujourd'hui. Il faut donc les connaître, en ellesmêmes d'abord et, par voie de conséquence, en vue de mieux connaître l'univers de référence des élèves musulmans. En même...
Liens utiles
- La religion face aux défis de la modernité
- Relationship between religion, spirituality, and young Lebanese university students’ well-being.
- : En quoi ce passage est-il une parodie des romans de chevalerie et une satire de la religion ?
- ANTHROPOLOGIE POLITIQUE ET SOCIALE. THEME : LE MOUVEMENT ALMORAVIDE ENTRE ECONOMIE ET RELIGION.
- Zone d'Apollinaire texte bac: modernité































