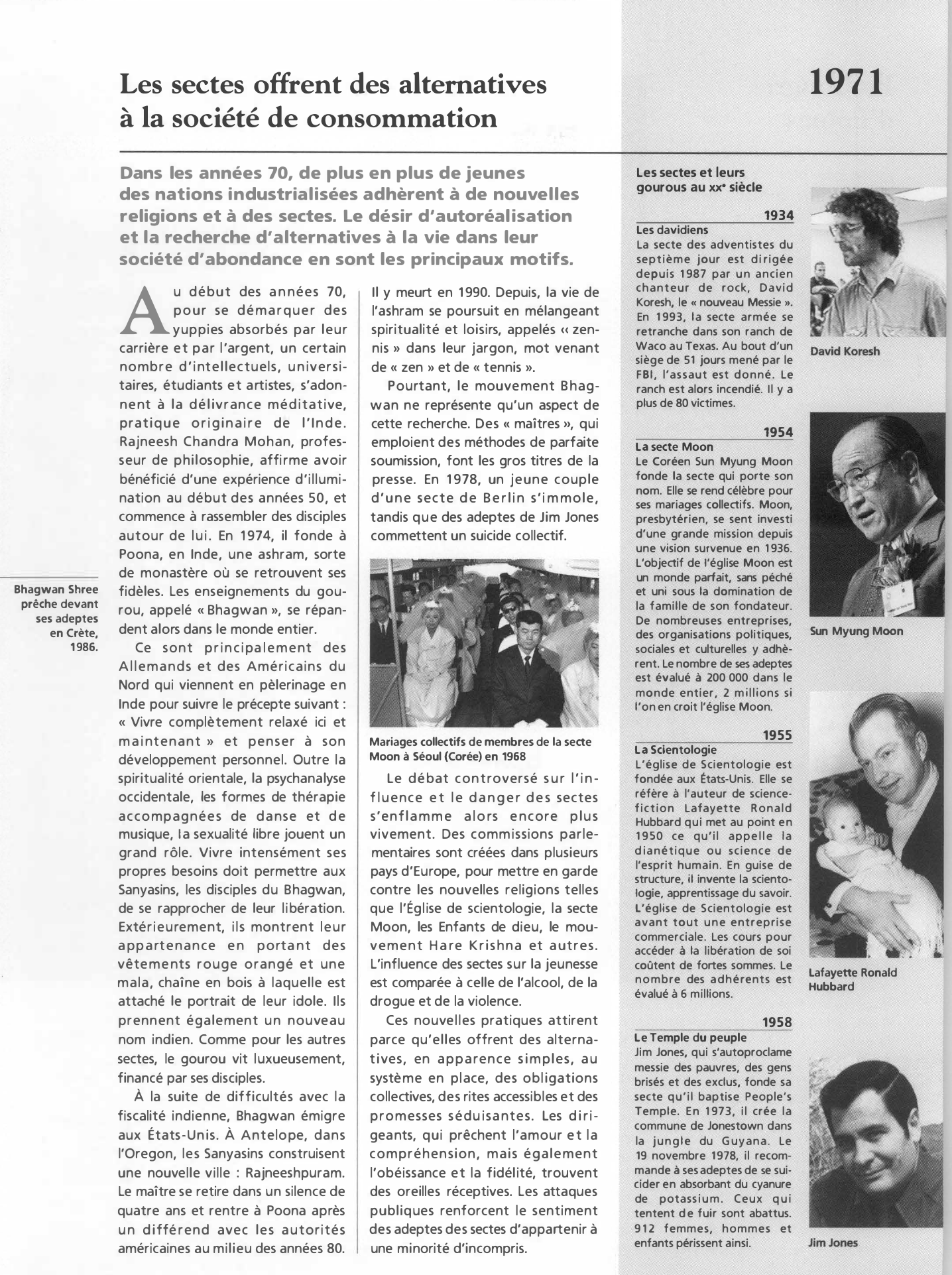Les sectes offrent des alternatives à la société de consommation
Publié le 26/03/2019
Extrait du document
Les sectes offrent des alternatives à la société de consommation
Dans les années 70, de plus en plus de jeunes des nations industrialisées adhèrent à de nouvelles religions et à des sectes. Le désir d'autoréalisation et la recherche d'alternatives à la vie dans leur société d'abondance en sont les principaux motifs.
Bhagwan Shree prêche devant ses adeptes en Crète, 1986.
Au début des années 70, pour se démarquer des yuppies absorbés par leur carrière et par l'argent, un certain nombre d'intellectuels, universitaires, étudiants et artistes, s'adonnent à la délivrance méditative, pratique originaire de l'Inde. Rajneesh Chandra Mohan, professeur de philosophie, affirme avoir bénéficié d'une expérience d'illumination au début des années 50, et commence à rassembler des disciples autour de lui. En 1974, il fonde à Poona, en Inde, une ashram, sorte de monastère où se retrouvent ses fidèles. Les enseignements du gourou, appelé « Bhagwan », se répandent alors dans le monde entier.
Ce sont principalement des Allemands et des Américains du Nord qui viennent en pèlerinage en Inde pour suivre le précepte suivant : « Vivre complètement relaxé ici et maintenant » et penser à son développement personnel. Outre la spiritualité orientale, la psychanalyse occidentale, les formes de thérapie accompagnées de danse et de musique, la sexualité libre jouent un grand rôle. Vivre intensément ses propres besoins doit permettre aux Sanyasins, les disciples du Bhagwan, de se rapprocher de leur libération. Extérieurement, ils montrent leur appartenance en portant des vêtements rouge orangé et une mala, chaîne en bois à laquelle est attaché le portrait de leur idole. Ils prennent également un nouveau nom indien. Comme pour les autres sectes, le gourou vit luxueusement, financé par ses disciples.
À la suite de difficultés avec la fiscalité indienne, Bhagwan émigre aux États-Unis. À Antelope, dans l'Oregon, les Sanyasins construisent une nouvelle ville : Rajneeshpuram. Le maître se retire dans un silence de quatre ans et rentre à Poona après un différend avec les autorités américaines au milieu des années 80.
Il y meurt en 1990. Depuis, la vie de l'ashram se poursuit en mélangeant spiritualité et loisirs, appelés << zen-nis » dans leur jargon, mot venant de « zen » et de « tennis ».
«
Bhagwan
Shree
prêche devant
ses adeptes
en Crète,
19 86.
Les
sectes off rent des alternative s
à la soci été de consom mation
Dans les années 70, de plus en plus de jeunes
des nations industri alisées adhèrent à de nouv elles
religions et à des sectes.
Le désir d'autoréa lisation
et la recherche d'alternatives à la vie dans leur
société d'abondance en sont les principaux motifs.
A u début des années 70,
pour
se démarquer des
yuppie s absorbés par leur
carrière et par l'argent, un certain
nombre d'intellectuels, universi
tai res, étudia nts et artis tes, s'adon
nen t à la dél ivrance méditativ e,
prat ique originaire de l'Inde.
Rajneesh Chandra Mohan , profes
seur de philosophie, affirme avoir
bénéficié d'une expérience d'illumi
nation au début des années 50, et
commence à ras sembler des disciples
autour de lui.
En 1974, il fonde à
Poona, en Inde, une ashram, sorte
de mona stère où se retrouvent ses
fidèles.
Les enseignem ents du gou
rou, appelé « Bhagwan », se répan
dent alors dans le monde entier.
Ce sont princip alemen t des
Allemands et des Américains du
Nord qui viennent en pèlerinage en
Inde pour suivre le précepte suivant :
« Vivre complètement relaxé ici et
main tenant » et penser à son
développement personnel.
Outre la
spiritual ité orientale, la psyc hana lyse
occidentale, les formes de thérapie
accompagnées de danse et de
musique, la sexualité libre jouent un
grand rôle.
Vivre intensément ses
propres besoins doit perm ettre aux
Sanyasins, les disciples du Bhagwan,
de se rapprocher de leur libération.
Exté rieur emen t, ils montrent leur
ap par tenanc e en portant des
vête ments rouge orangé et une
mala, chaîne en bois à laquelle est
attaché le portrait de leur idole.
Ils
prenn ent égalem ent un nouv eau
nom indien.
Comme pour les autres
sectes, le gourou vit luxueusement,
financé par ses disciples.
À la suite de difficultés avec la
fiscalité indienne, Bhagwan émigre
aux État s-Un is.
À Antelo pe, dans
l'Oregon, les Sanyasins construisent
une nouv elle ville : Rajnee shpuram.
Le maître se retire dans un silence de
quatre ans et rentre à Poona après
un di fférend avec les autorités
américaines au milieu des années 80.
Il
y meurt en 1990.
Depuis, la vie de
l'ashram se poursuit en mélangeant
spiritualité et loisir s, appelés >.
En 1993, la secte armée se
retranche dans son ranch de
Waco au Texas.
Au bout d'un
siège de 51 jours mené par le
FBI, l'assaut est donné.
Le
ranch est alors incendié.
Il y a
plus de 80 victimes.
1954
La secte Moon
Le Coréen Sun Myung Moon
fonde la secte qui porte son
nom.
Elle se rend célèbre pour
ses mariages collectifs.
Moon,
presbyté rien, se sent investi
d'une grande mission depuis
une vision survenue en 1936.
L'objectif de l'églis e Moon est
un monde parfait, sans péché
et uni sous la domination de
la famille de son fondateur.
De nombreuses entreprises, 197
1
des organisations politiques, Sun
Myung Moon
sociales et culturelles y adhè-
rent.
Le nombre de ses adeptes
est évalué à 200 000 dans le
monde entier, 2 mil lions si
l'on en croit l'église Moon.
1955
La Scientologie
L'église de Scientologie est
fondée aux Ëtats -Unis.
Elle se
réfère à l'auteur de science
fiction Lafayette Ronald
Hubbard qui met au point en
19 50 ce qu'il appelle la
di anétique ou science de
l'esprit humain.
En guise de
structure, il invente la sciento
logie, apprentissage du savoir.
L'église de Scientologie est
avant tout une entreprise
commerciale.
Les cours pour
accéder à la libération de soi
coûtent de fortes sommes.
Le
nombr e des adhér ents est
évalué à 6 millions.
1958
Le Temple du peuple
Jim Jones, qui s'autoproclame
messie des pauvres, des gens
brisés et des exclus, fonde sa
secte qu'il baptise People's
Temple.
En 1973, il crée la
commune de Jonestown dans
la jungle du Guyana.
Le
19 novembre 1978, il recom
mande à ses adeptes de se sui·
eider en absorbant du cyanure
de potas sium.
Ceux qui
tentent de fuir sont abattus.
912 femmes, hommes et
enfants périssent ainsi.
Lafayette
Ronald
Hubbard
55.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Peut-on atteindre le bonheur dans le cadre d'une société de consommation ?
- Introduction « L’expression de « société de consommation » est
- Quelle est la conception du bonheur dans notre société de consommation ?
- la société de consommation depuis 1945
- La société de consommation est-elle en crise ?