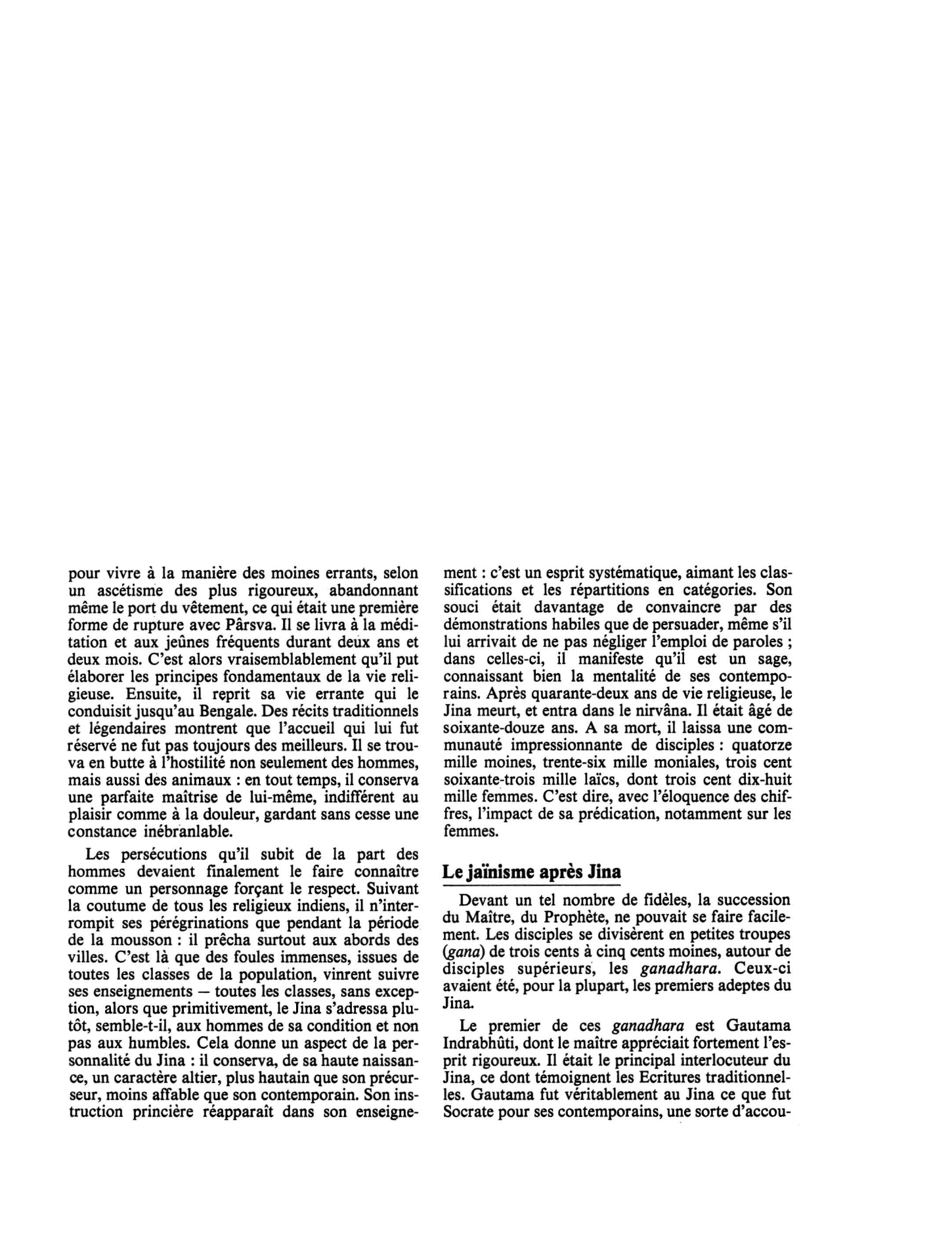Le jaïnisme
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
Dans la période qui suivit la mort de Sudharman, s'inscrit la crise qui ébranla le jaïnisme des origines. Une longue famine - elle dura douze ans - obligea les religieux à entreprendre une migration vers la côte occidentale de l'Inde d'une part et vers le Deccan au sud d'autre part, sous la conduite et la direction de deux grands chefs spirituels, Bhadrabâhu - qui se suicida ultérieurement par inanition - et Sthûlabhadra. Cette séparation géographique ne tarda pas à se transformer en une véritable scission religieuse.
«
pour vivre à la manière des moines errants, selon un ascétisme des plus rigoureux, abandonnant même le port du vêtement, ce qui était une première
forme de rupture avec Pârsva.
Il se livra à la médi
tation et aux jeûnes fréquents durant delix ans et
deux mois.
C'est alors vraisemblablement qu'il put
élaborer les principes fondamentaux de la vie reli
gieuse.
Ensuite,
il reprit sa vie errante qui le conduisit jusqu'au Bengale.
Des récits traditionnels
et légendaires montrent que l'accueil qui lui fut
réservé
ne fut pas toujours des meilleurs.
Il se trou
va en butte à l'hostilité non seulement des hommes,
mais aussi
des animaux : en tout temps, il conserva
une parfaite maîtrise de lui-même, indifférent au
plaisir comme à la douleur, gardant sans cesse une
constance
inébranlable.
Les persécutions qu'il subit de la part des
hommes devaient finalement le faire connaître
comme un personnage forçant le respect.
Suivant la coutume de tous les religieux indiens, il n'inter
rompit ses pérégrinations que pendant la période
de la mousson :
il prêcha surtout aux abords des
villes.
C'est là que des foules immenses, issues de toutes les classes de la population, vinrent suivre ses enseignements -toutes les classes, sans excep
tion, alors que primitivement, le Jina s'adressa plu
tôt, semble-t-il, aux hommes de sa condition et non
pas aux humbles.
Cela donne un aspect de la per
sonnalité du Jina :
il conserva, de sa haute naissan ce, un caractère altier, plus hautain que son précur
seur, moins affable que son contemporain.
Son ins
truction princière réapparaît dans son enseigne- ment
: c'est
un esprit systématique, aimant les clas
sifications et les répartitions en catégories.
Son souci était davantage de convaincre par des démonstrations habiles que de persuader, même s'il lui arrivait de ne pas négliger l'emploi de paroles ;
dans celles-ci, il manifeste qu'il est un sage,
connaissant bien la mentalité de ses contempo
rains.
Après quarante-deux ans de vie religieuse, le Jina meurt, et entra dans le nirvâna.
Il était âgé de soixante -douze ans.
A sa mort, il laissa une com
munauté impressionnante de disciples : quatorze
mille moines, trente-six mille moniales, trois cent
soixante-trois mille laïcs, dont trois cent dix-huit
mille femmes.
C'est dire, avec l'éloquence des chif
fres, l'impact de sa prédication, notamment sur les femmes.
Le jaïnisme après Jina
Devant un tel nombre de fidèles, la succession du Maître, du Prophète, ne pouvait se faire facile
ment.
Les disciples se divisèrent en petites troupes (gana) de trois cents à cinq cents moines, autour de
disciples supérieurs, les ganadhara.
Ceux-ci
avaient été, pour la plupart, les premiers adeptes du
Jina.
Le premier de ces ganadhara est Gautama
Indrabhûti, dont le maître appréciait fortement l'es
prit rigoureux.
Il était le principal interlocuteur du
Jina, ce dont témoignent les Ecritures traditionnel les.
Gautama fut véritablement au Jina ce que fut Socrate pour ses contemporains, une sorte d'accou-.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- jaïnisme o u jinisme.
- Religions d'Asie méridionale Religions d'Asie méridionale L'Asie méridionale est le berceau de nombreuses religions dont l'hindouisme, le bouddhisme ainsi que le jaïnisme et le sikhisme.
- Le Jaïnisme