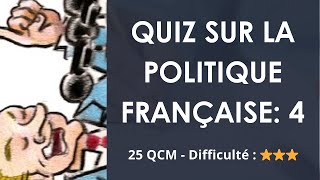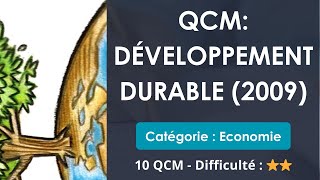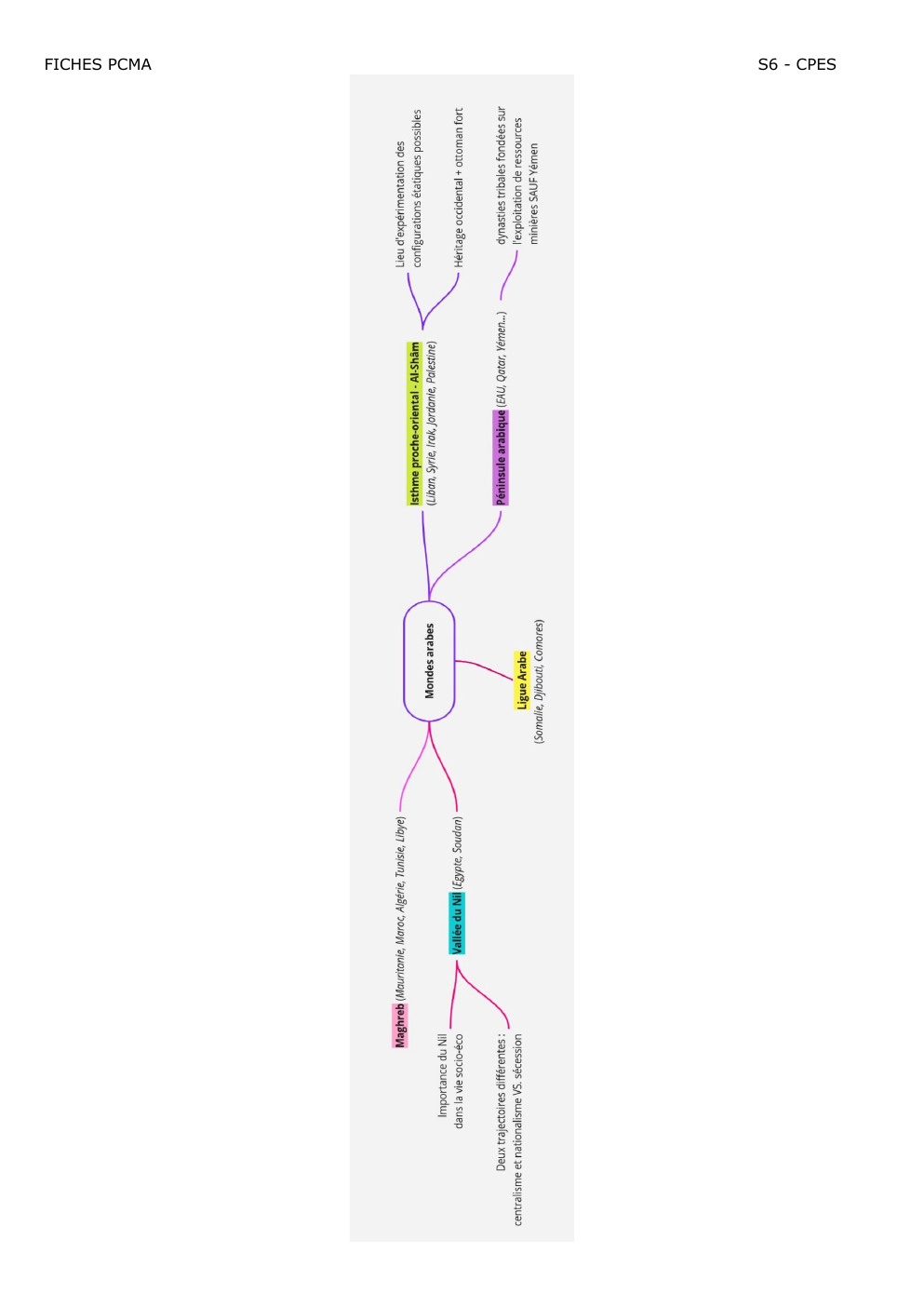Fiches politiques comparées du monde arabe
Publié le 26/03/2025
Extrait du document
«
FICHES PCMA
S6 - CPES
FICHES PCMA
Les mondes arabes existent-ils ?
S6 - CPES
INTRODUCTION
Monde arabe = région scrutée car des conflits récurrents, insistant sur la différence
avec l’Occident MAIS méconnaissance des structures sociales, culturelles et politiques de la
zone utiliser la politique comparée pour analyser les phénomènes dans un contexte socio
historique en comparaison avec d’autres
LES MONDES ARABES ENTRE UNITE ET DIVERSITE : fantasmes occidentaux + ambitions locales
Différents espaces (voir carte) MAIS des caractéristiques communes pensées par les discours
indigènes/exogènes.
Terminologie toujours définie en fonction de l’Europe
FR, UK = délimitent la région au 19 e siècle selon leurs perceptions des impératifs de la
domination.
Levant = France (des Balkans à la Jordanie, comptoirs de commerce)
Moyen Orient / Middle East / Proche-Orient = UK, USA (milieu de l’Orient car l’Inde est
le fleuron de l’empire colonial + administration US : Maroc jusqu’aux Indes UK)
Monde musulman = UK (distingue les communautés musulmanes des communautés
hindoues dans leur empire)
Monde arabe : ensemble des pays ayant l’arabe classique comme langue officielle,
administrative, culturelle et littéraire
Catégorie née des discours indigènes (identité arabe revendiquée) et exogènes (orientaliste,
mentalité arabe, idée que la région est toujours en conflit)
Arabisme : solidarité de la langue/culture, partage de réf.
culturelles par opposition aux
normes religieuses de l’Islam
Nationalisme arabe : projet politique post WW2, union des pays arabes, prend fin après
armées arabes / israéliennes en 1967 et la mort de Nasser en 1970
Orientalisme : mouvement littéraire et artistique, exotisme fantasmé (cf.
Edward Saïd
critiquant comment les représentations occidentales de l’Orient ont créé l’Orient)
Mondes arabes : Pour mettre en avant les métissages, les conflits sociaux, culturels,
politiques dans les sociétés, montrer l’hétérogénéité du terme « arabe » + diversité
linguistique
L’ECOLOGIE DES MONDES ARABES
Territoires dominés par l’Empire Ottoman depuis le 13e siècle (apogée de l’empire au 17e siècle
où le monde arabe = 2/5e de l’Empire).
Déclin au 19e siècle avec les réformes (Tanzimat) +
chute pendant WW1.
Fin avec le traité de Sèvres + Traité de Lausanne en 1923-24.
Domination coloniale de l’Algérie en 1830 = début du processus colonial qui s’achève
vers 1920.
Statut des colonies dépendant du pays, de la date de colonisation et de l’importance
stratégique du territoire (Algérie = colonie de peuplement // protectorat = finance et pol ext.
Gérée par le pays colonisateur avec une administration indigène // mandats en Libye, Syrie,
Palestine… après WW1).
Déclin des colonies et indépendances entre 1922 (Égypte) et 1975
(Comores)
Structures socio-économiques / politiques communes : formation étatique par une
dynastie étrangère DONC notion d’État fragile mais structures sociales pérennes + États
rentiers (rente militaire, commerciale, pétrolière, touristique) = ressources exogènes des États
qui les redistribuent et font fonctionner l’État sans utiliser les impôts DONC pas de demandes
démocratiques car pas de redevabilité de l’État.
Clivages socio-éco : urbanisation rapide créant des inégalités + population jeune et
chômage élevé + identités religieuses ethniques (minorités remettant en question le
discours homogénéisant)
Traits communs entre républiques/monarchies : parti unique et contrôle de l’opposition +
répression + rôle ambivalent de l’armée (politique + maintien de l’ordre)
Organisation pol commune (Ligue des États arabes, 1945) + Coupe arabe de foot, 2021 +
Grande Zone Arabe de Libre Échange (GZALE), 2009 + Printemps arabes transnationaux
DES MONDES EN REVOLUTION : histoire contestataire de longue durée
Causes communes aux révolutions : contrôle de l’opposition, système sécuritaire et
répression, domination patrimoniale, corruption, chômage des jeunes… Revendiquent la
citoyenneté politique + droits économiques et sociaux à travers la chute des régimes
+ départ des dirigeants autoritaires.
Pour qu’un mouvement se maintienne : groupes
sociaux liés + qualification politique des revendications + déjouer les contraintes
FICHES PCMA
S6 - CPES
Soulèvement de 2011 : analyse dressant des typologies des nouvelles situations
étatiques (régimes décapités, ébranlés, contestations mineures…).
LIMITES : guerre civile en
Syrie, nouvelles mobilisations au Maroc en 2017, 2015 au Liban…
Michel Camau, Frédéric Varel Montréal, Soulèvements et recompositions,
2014 : insistent sur la crise de vulnérabilité des régimes et pas sur leur
chute.
Crise de légitimation < révolutions montrant la vulnérabilité < équilibre
précaire
Comment appréhender les mondes arabes en 2025 ? Pourquoi et comment opérer la
désoccidentalisation du regard porté sur les mondes arabes ?
Nécessité d’une pluralité des voix dans la production du savoir pour ne pas raconter
l’histoire du point de vue dominant.
Positionnalité : impact des structures de pouvoir
explicites / implicites sur le processus de recherche, sur les relations entre le chercheur et les
personnes étudiées, sur le transfert de connaissance affecte les résultats de recherche DONC
réflexivité sur sa propre positionnalité
VERS UNE LECTURE PROFANE DES CONFLITS DANS LES MONDES ARABES (G.
CORM)
Matrice dominante des conflits au Moyen Orient = anthropologie religieuse.
L’EU
justifie ses conflits de colonisation par des traits anthropologiques négatifs des opprimés.
o Valorisation du christianisme européen comme supérieur
o Tradition intellectuelle de la « question d’Orient » : racisme, valorisation et
dénigrement de communautés
o Explication abandonnée après WW2 au profit de l’école aronienne (évènements =
lutte idéologique entre démocratie libérale et totalitarisme soviétique) et marxiste
(capitalisme dominant et forces anti impérialistes) modèles obsolètes après
1991.
Samuel Huntington : thèse sur le choc des civilisations (1997)
Retour du cadre anthropologique expliquant la nature des R.I et dynamique des conflits.
Après Guerre Froide = redéfinition des rapports de force et de la façon d’en rendre
compte
Georges Corm : conflits mondiaux / sociétés interprétés comme des affrontements de
valeur MAIS il faut restituer la conflictualité = analyse multi factorielles des
conflits (pol, éco, sociales) + prise en compte des structures néo-impériales (car
sinon on simplifie les conflits entre les bons/méchants)
VERS UNE LECTURE DESORIENTALISEE DE LA REALITE SOCIOHISTORIQUE ET POLITIQUE DES
MONDES ARABES (E.
SAÏD)
Edward Saïd, L’orientalisme (1978) : orientalisme = dimension de la culture politique,
intellectuelle moderne qui a plus de rapport avec « notre » monde qu’avec l’Orient.
Orient
et Occident se soutiennent et se reflètent l’une l’autre.
Analyse l’orientalisme comme un
système d’idées (cf.
Foucault).
Hégémonie culturelle par consensus perpétuant des
représentations stéréotypées de l’Orient servant les intérêts de pouvoir et de domination
culturelle de l’Occident.
o Orientaliste : personne qui effectue des recherches sur l’Orient institution de
savoir + style de pensée (ontologique VS.
épistémologique) + style de pouvoir
(comment l’Orient est pensé en Occident)
o Critiques : peut enlever au sujet étudié sa capacité d’action (minimise la capacité
des sociétés orientales à produire leurs représentations) + manque de solutions
concrètes + généralise les expériences coloniales oubliant les spécificités + théorie
occidentalocentrée et focus sur rapports post coloniaux (Chandra Talpade
Mohanty montre que les études postcoloniales minimisent les expériences
coloniales des minorités de genre + Vivek Chibber : néglige le rôle du capitalisme
dans relations coloniales) + relativisme culturel défendant sans discernement des
pratiques locales
FONDEMENTS ET METHODOLOGIE DE L’ETUDE SOCIOLOGIQUE ET HISTORIQUE COMPAREE DES
REGIMES POLITIQUES DES MONDES ARABES
Politique comparée / histoire à parts égales :
FICHES PCMA
o
S6 - CPES
comparatisme cherchant à rapprocher des cultures en établissant des similarités
MAIS risque de gommer les différences.
Comparatisme et orientalisme déclinent en
même temps fin 1990s.
Banaliser différences = nier spécificités culturelles +
perpétuer exclusions + enfermer dans des catégories.
o Histoire
connectée :
faire
émerger
modes
d’interaction
entre
local/régional/supranational.
Frederick Cooper critique la mondialisation « le
concept de mondialisation sert-il à quelque chose », 2001 : vocabulaire impliquant
le seul cadre planétaire causant des problèmes
o Histoire à parts égales (Romain Bertrand, 2011) : il écrit à un moment où on
parle d’échelle mondiale, mais pour réécrire la même histoire du monde
(EU/expansion) diversifier les sources pour rendre justice à la symétrisation des
actes
Centralité de la sociologie : analyses emics (issues de = moins scientifiques,
subjectives) VS.
etics (extérieures à = approche objective de l’étude des cultures) =
manque de respect de la spécificité des expériences + néglige la réflexivité.
Marginaliser
emics = ethnocentrisme.
Importance de l’empirisme + maîtriser les langues du
terrain de recherche pour produire ses propres données
Printemps arabes : révoltes ou révolutions ?
Compréhension partielle des révolutions à cause de la méconnaissance sur les mondes arabes.
2011 = attraction pour les effets et résultats au détriment des processus révolutionnaires.
DES SITUATIONS HISTORIQUES EXCEPTIONNELLES : LA SCISSION DES LEGITIMITES ENTRE
GOUVERNANTS ET GOUVERNES
Révolution : catégorie de la pratique (utilisée par les acteurs) et scientifique (Charles
Tilly : distinction entre intentions, situations et dénouements révolutionnaires.
Les
situations évoluent souvent indépendamment des conditions qui les ont fait naître et
les dénouements ne suffisent pas à expliquer les causes initiales des révolutions)
o Situation d’ouverture radicale des possibles, de renversement de l’histoire et
d’inclusion politique sans précédent.
Moment où la parole politique est
collectivement arrachée par des groupes minorisés, de façon quasiment
simultanée mais non coordonnée.
o Histoire globale des révolutions montrant leur dimension transnationale : sociologie
de la diffusion des modes d’action, des répertoires discursifs, des....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Régimes politiques du Liban et du Monde Arabe
- Institut du monde arabe [IMA] - architecture.
- Pont insulaire morcelé, jeté entre les deux Amériques, de la Floride au Venezuela, le monde caraïbe et ses annexes guyanaises montrent une mosaïque extraordinairement variée de souverainetés politiques et de langues.
- LE MONDE ARABE.
- arabe, musique - musique du monde.