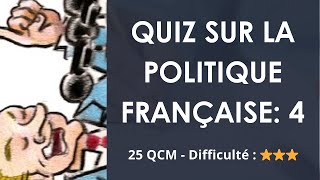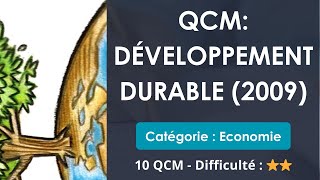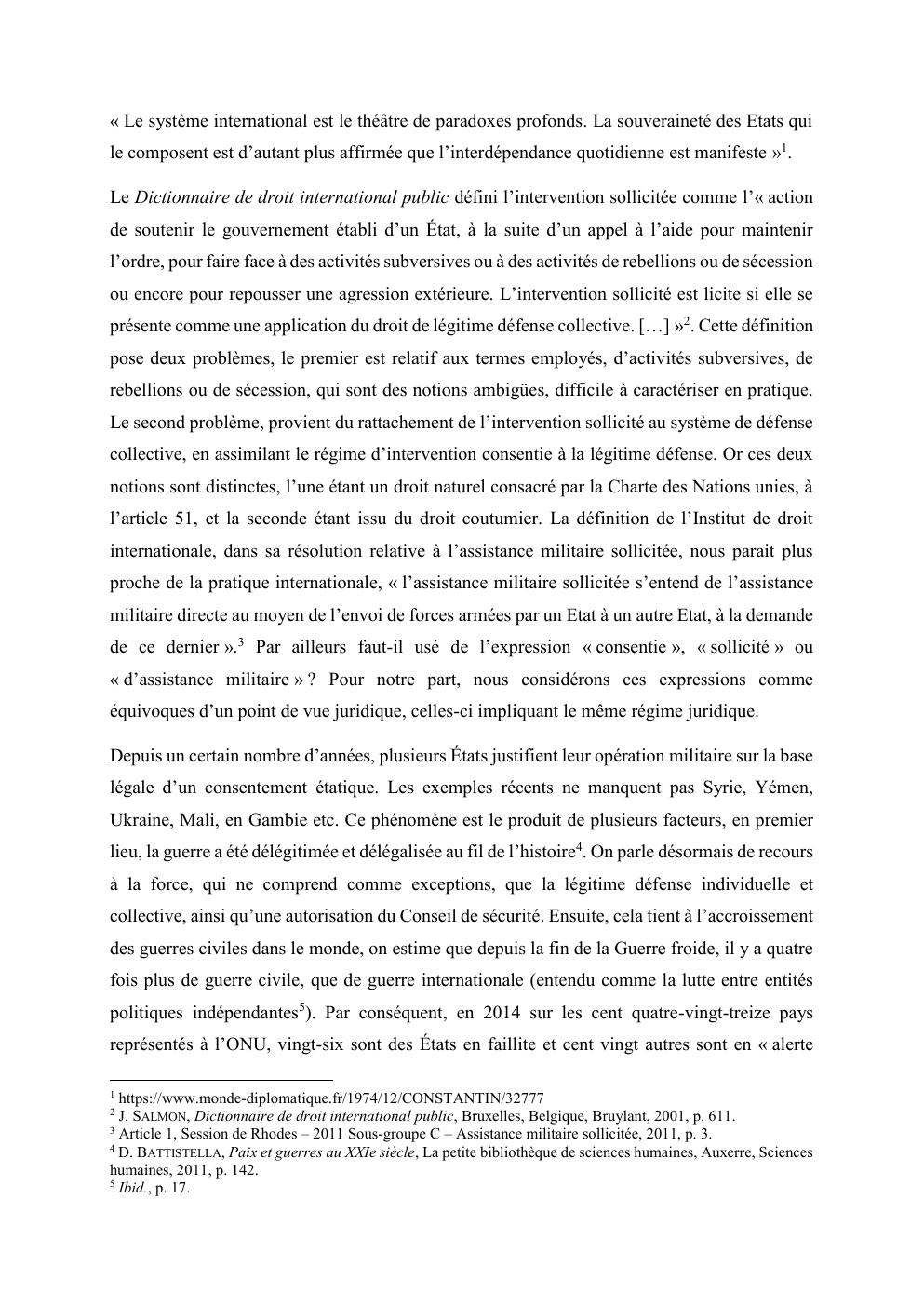Consentement des interventions étatiques.
Publié le 09/02/2025
Extrait du document
«
« Le système international est le théâtre de paradoxes profonds.
La souveraineté des Etats qui
le composent est d’autant plus affirmée que l’interdépendance quotidienne est manifeste »1.
Le Dictionnaire de droit international public défini l’intervention sollicitée comme l’« action
de soutenir le gouvernement établi d’un État, à la suite d’un appel à l’aide pour maintenir
l’ordre, pour faire face à des activités subversives ou à des activités de rebellions ou de sécession
ou encore pour repousser une agression extérieure.
L’intervention sollicité est licite si elle se
présente comme une application du droit de légitime défense collective.
[…] »2.
Cette définition
pose deux problèmes, le premier est relatif aux termes employés, d’activités subversives, de
rebellions ou de sécession, qui sont des notions ambigües, difficile à caractériser en pratique.
Le second problème, provient du rattachement de l’intervention sollicité au système de défense
collective, en assimilant le régime d’intervention consentie à la légitime défense.
Or ces deux
notions sont distinctes, l’une étant un droit naturel consacré par la Charte des Nations unies, à
l’article 51, et la seconde étant issu du droit coutumier.
La définition de l’Institut de droit
internationale, dans sa résolution relative à l’assistance militaire sollicitée, nous parait plus
proche de la pratique internationale, « l’assistance militaire sollicitée s’entend de l’assistance
militaire directe au moyen de l’envoi de forces armées par un Etat à un autre Etat, à la demande
de ce dernier ».3 Par ailleurs faut-il usé de l’expression « consentie », « sollicité » ou
« d’assistance militaire » ? Pour notre part, nous considérons ces expressions comme
équivoques d’un point de vue juridique, celles-ci impliquant le même régime juridique.
Depuis un certain nombre d’années, plusieurs États justifient leur opération militaire sur la base
légale d’un consentement étatique.
Les exemples récents ne manquent pas Syrie, Yémen,
Ukraine, Mali, en Gambie etc.
Ce phénomène est le produit de plusieurs facteurs, en premier
lieu, la guerre a été délégitimée et délégalisée au fil de l’histoire4.
On parle désormais de recours
à la force, qui ne comprend comme exceptions, que la légitime défense individuelle et
collective, ainsi qu’une autorisation du Conseil de sécurité.
Ensuite, cela tient à l’accroissement
des guerres civiles dans le monde, on estime que depuis la fin de la Guerre froide, il y a quatre
fois plus de guerre civile, que de guerre internationale (entendu comme la lutte entre entités
politiques indépendantes5).
Par conséquent, en 2014 sur les cent quatre-vingt-treize pays
représentés à l’ONU, vingt-six sont des États en faillite et cent vingt autres sont en « alerte
1
https://www.monde-diplomatique.fr/1974/12/CONSTANTIN/32777
J.
SALMON, Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Belgique, Bruylant, 2001, p.
611.
3
Article 1, Session de Rhodes – 2011 Sous-groupe C – Assistance militaire sollicitée, 2011, p.
3.
4
D.
BATTISTELLA, Paix et guerres au XXIe siècle, La petite bibliothèque de sciences humaines, Auxerre, Sciences
humaines, 2011, p.
142.
5
Ibid., p.
17.
2
rouge »6.
D’autre part la montée en puissance des groupes armées non étatiques concurrencent
désormais les gouvernements à l’intérieur de leur État.
Ceux-ci sont de plus en plus équipés,
grâce à au progrès technique et à l’individualisation de la puissance de feu7.
Mais aussi en raison
des financements de plus en plus important, qui permettent à des États de se faire des guerres
par procuration.
C’est le cas en Syrie, où chaque camp est soutenu par des puissances
étrangères, que ce soit le Hezbollah et les milices chiites, appuyés par l’Iran ou les groupes
rebelles sunnites, appuyés par les pays de golfe et la Turquies.
A l’heure de la mondialisation,
de la remise en cause des frontières, le consentement des interventions militaires questionne le
modèle d’État-nation.
Déjà en 1991, Martin Van Creveld, prévoyait la fin du monopole de la violence étatique,
susceptible d’entrainer de la fin de la distinction traditionnelle gouvernement-arméepopulation8.
Il ajoutait les guerres ne seraient plus le fait des armées, mais celui des groupes,
questionnant l’efficacité militaire de l’État moderne, et donc son existence9.
La revue
stratégique de défense justifiait ses interventions par « la contraction de l’espace géopolitique,
résultat de l’accroissement des interdépendances, facilite la propagation rapide des effets des
crises, même lointaines, jusque sur le continent européen, plaçant ses pays et ses populations
au contact direct des tensions de toute nature »10.
Pourtant si un ou plusieurs États ont la
capacité d’intervenir pour assister un ou plusieurs autres États, cela est bien la preuve de son
efficacité militaire, ou au moins de capacité de projection et de réponse à une ou plusieurs
menaces identifiées.
L’intervention consentie de ce point de vue, fait l’objet de plusieurs paradoxes.
Elle est à la fois
caractéristique de la fragilisation du modèle de l’État-nation, étant donné que si un État sollicite
un autre, pour maintenir l’ordre, c’est qu’il ne maitrise pas pleinement et entièrement ses
pouvoirs régaliens.
D’un autre côté, sa capacité à pouvoir faire appel à un autre État, est la
preuve de son existence et l’affirmation de sa souveraineté.
Cela entendu que le gouvernement
demandant une assistance militaire ne fasse lui-même l’objet de pression de la part d’un État
tiers.
Cette question est centrale, à l’heure où l’État est interconnecté dans un « nœud de
réseaux », la décision d’un gouvernement doit prendre en compte une multitude d’informations
6
P.
SERVENT, Extension du domaine de la guerre, Paris, France, Perrin, 2017, p.
23.
J.
HENROTIN, « Techno-guérillas - Anatomie de l’ennemi probable.
DSI HS N° 64 », Areion Group, mars 2019,
pp.
8‑9.
8
J.
COLIN et L.
POIRIER, Les Transformations de la guerre, Bibliothèque stratégique, Paris, Économica, 1989, p.
245.
9
Ibid., pp.
251‑252.
10
MINISTERE DES ARMEES, Revue stratégique de défense et de sécurité nationale, 2017, § 23.
7
et d’obligations11.
L’avènement du libre-échange et la dépendance économique des pays
émergents à l’égard des pays du nord, l’ingérence institutionnelle, de la surveillance des
élections à celles des politiques économiques, font du consentement un processus complexe12.
C’est donc un autre paradoxe d’une intervention consentie, elle fait à la fois office de décision
étatique, tout en laissant planer un doute sur la capacité d’émettre librement un consentement à
une intervention militaire étrangère.
Si son régime juridique interagis de plus en plus avec le
système de sécurité collective, comme nous le verrons plus en détails, il n’en reste pas moins
étranger.
Le régime des interventions consenties est de source coutumière.
Or la coutume....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- INTERVENTIONS AUX CAUSERIES SUR LA LITTÉRATURE ET L’ART A YENAN Mao Tsé-toung
- Spinoza: « la liberté n’est qu’à celui qui de son entier consentement vit sous la seule conduite de la Raison ».
- vices du consentement.
- Les vices du consentement (cas pratiques)
- Le consentement au mariage