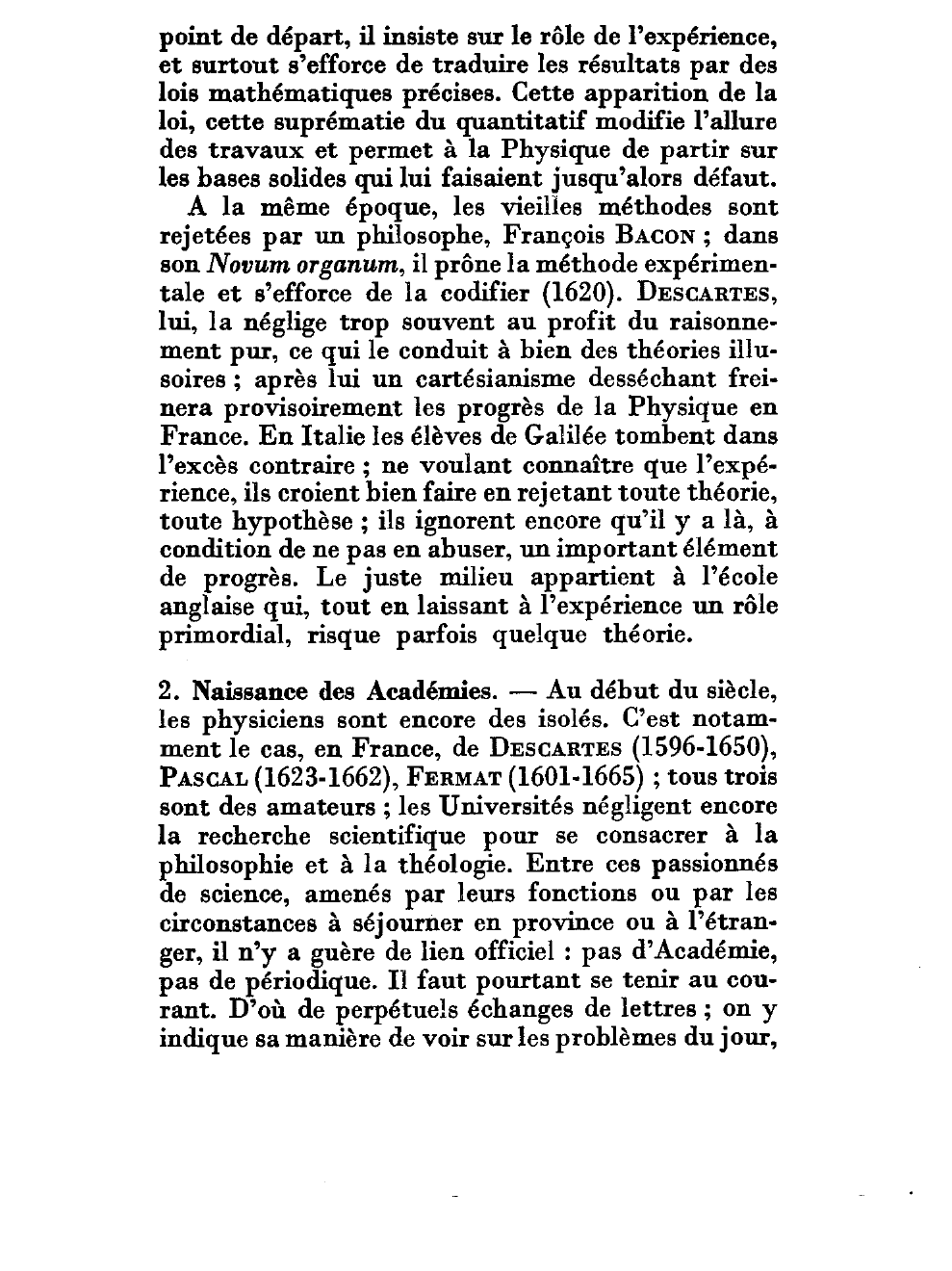HISTOIRE DE LA PHYSIQUE DE GALILÉE A NEWTON
Publié le 16/09/2013
Extrait du document

Toutefois, si elle semblait confirmer les vues de Torricelli, cette expérience n'était pas concluante; elle démontrait qu'une certaine action fait s'élever les liquides à une hauteur variable avec leur densité, mais ne prouvait pas que c'est la pesanteur de l'air. Torricelli délaissa la question, et mourut prématurément. Mais le P. Mersenne fit connaître en France ses travaux. Son hypothèse plut à PASCAL, qui
comprit la nécessité de réaliser une expérience décisive et eut le mérite de l'imaginer : s'élever à une certaine altitude, car la pression de l'air, si elle est cause de tout, y sera moins forte et fera monter le mercure moins haut. Pascal habitait alors Rouen ; la Normandie se prêtant mal à un essai de ce genre, il écrivit à son beau-frère PÉRIER, lequel résidait à Clermont-Ferrand, et lui donna des instructions minutieuses. Sans être un spécialiste, Périer s'intéressait à la Physique; il accepta avec joie et exécuta soigneusement cette expérience capitale en 1648 : il nota le niveau du mercure dans un tube de Torricelli au pied du Puy de Dôme, 26 pouces et 3 lignes 1/2; puis, accompagné de quelques amis, il alla mettre le tube en station au sommet, 23 pouces et 2 lignes ! L'idée de Pascal était bonne. En redescendant, les physiciens amateurs firent plusieurs mesures intermédiaires, et en bas retrouvèrent le niveau initial. Ainsi fut donné le coup de grâce à l'horreur du vide. Pascal refit l'expérience à la tour Saint-Jacques (qui sera plus tard ornée de sa statue en souvenir de ces exploits) ; une faible différence d'altitude, 25 toises environ, lui donna une différence de niveau appréciable, à peu près deux lignes.

«
point de départ, il insiste sur le rôle de l'expérience,
et surtout s'efforce de traduire les résultats par des
lois
mathématiques précises.
Cette apparition de la
loi, cette suprématie du quantitatif modifie l'allure
des travaux et permet à la Physique de partir sur
les hases solides qui lui faisaient jusqu'alors défaut.
A la même époque, les vieilles méthodes sont
rejetées par un philosophe, François BACON ; dans
son Novum organum, il prône la méthode expérimen
tale et s'efforce de la codifier (1620).
DESCARTES,
lui, la néglige trop souvent au profit du raisonne
ment pur, ce qui le conduit à bien des théories illu
soires ; après lui un cartésianisme desséchant frei
nera provisoirement les progrès de la Physique en
France.
En Italie les élèves de Galilée tombent dans
l'excès contraire; ne voulant connaître que l'expé
rience, ils croient bien faire en rejetant toute théorie,
toute hypothèse ; ils ignorent encore qu'il y a là, à
condition de ne pas en abuser, un important élément
de progrès.
Le juste milieu appartient à l'école
anglaise
qui, tout en laissant à l'expérience un rôle
primordial, risque parfois quelque théorie.
2.
Naissance des Académies.
- Au début du siècle,
les physiciens
sont encore des isolés.
C'est notam
ment le cas, en France, de DESCARTES (1596-1650),
PASCAL (1623-1662), FERMAT (1601-1665); tous trois
sont des amateurs; les Universités négligent encore
la recherche scientifique pour se consacrer à la
philosophie et à la théologie.
Entre ces passionnés
de science, amenés
par leurs fonctions ou par les
circonstances
à séjourner en province ou à l'étran
ger, il n'y a guère de lien officiel : pas d'Académie,
pas de périodique.
Il faut pourtant se tenir au cou
rant.
D'où de perpétuels échanges de lettres; on y
indique sa manière de voir sur les problèmes du jour,.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L'histoire est-elle déterminée par des lois comme la physique ?
- Un peu d’histoire… La notion de dérivée a vu le jour au XVIIe siècle dans les écrits de Leibniz et de Newton qui la nomme fluxion et qui la définit comme « le quotient ultime de deux accroissements évanescents ».
- Histoire de la physique de l'Antiquité à la Renaissance (Science & Techniques)
- Peut-on parler des enseignements de l'histoire dans le même sens où l'on parle des enseignements de la physique ou de la biologie ?
- Les disciples de Newton ne s'en tinrent d'ailleurs pas tous à la prudente réserve de leur maître. Pierre Duhem, la Théorie physique, son objet, sa structure, ABU, la Bibliothèque universelle