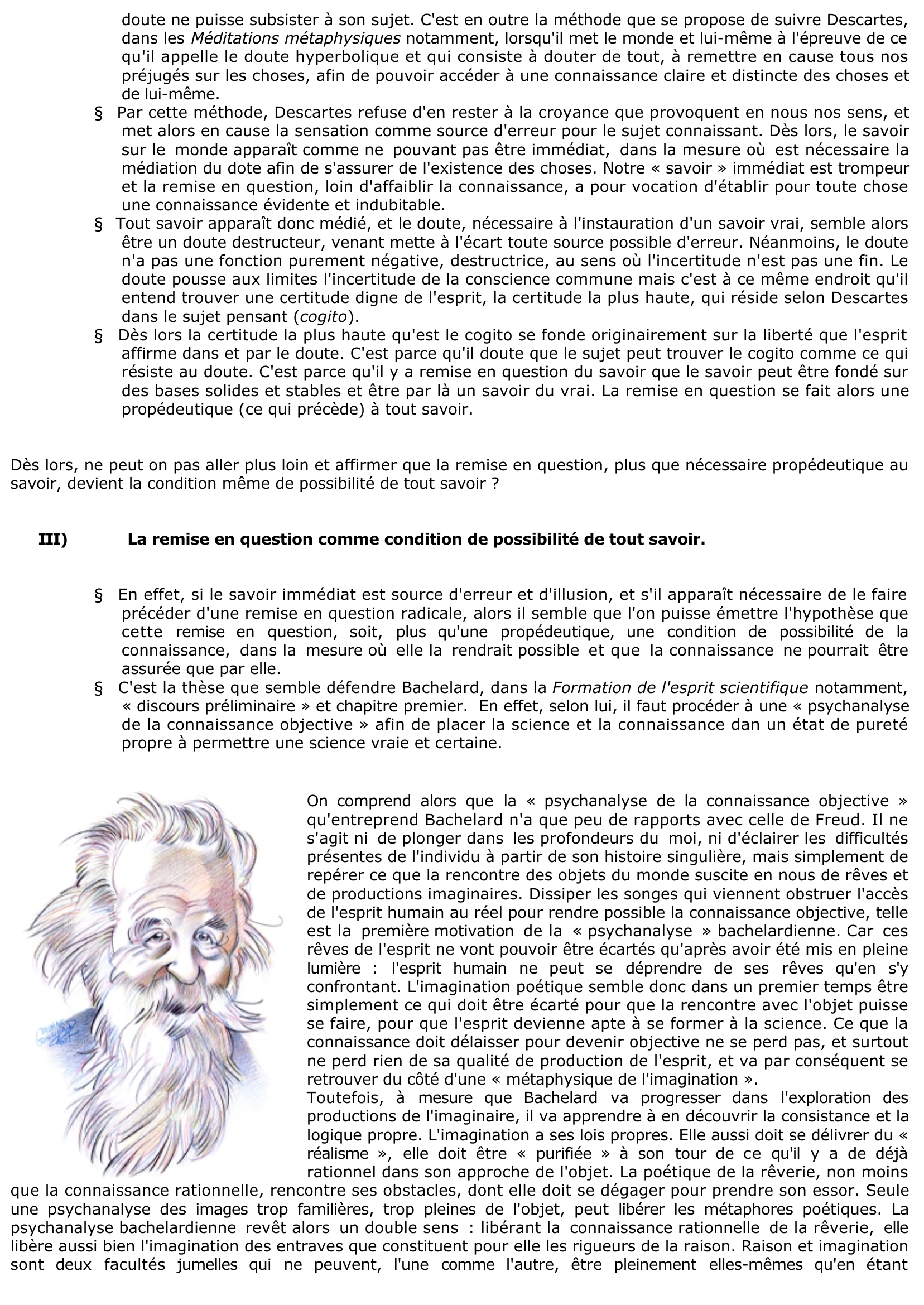Tout savoir doit-il être précédé par une remise en question ?
Publié le 27/02/2008
Extrait du document


«
doute ne puisse subsister à son sujet.
C'est en outre la méthode que se propose de suivre Descartes,dans les Méditations métaphysiques notamment, lorsqu'il met le monde et lui-même à l'épreuve de ce qu'il appelle le doute hyperbolique et qui consiste à douter de tout, à remettre en cause tous nospréjugés sur les choses, afin de pouvoir accéder à une connaissance claire et distincte des choses etde lui-même. § Par cette méthode, Descartes refuse d'en rester à la croyance que provoquent en nous nos sens, etmet alors en cause la sensation comme source d'erreur pour le sujet connaissant.
Dès lors, le savoirsur le monde apparaît comme ne pouvant pas être immédiat, dans la mesure où est nécessaire lamédiation du dote afin de s'assurer de l'existence des choses.
Notre « savoir » immédiat est trompeuret la remise en question, loin d'affaiblir la connaissance, a pour vocation d'établir pour toute choseune connaissance évidente et indubitable. § Tout savoir apparaît donc médié, et le doute, nécessaire à l'instauration d'un savoir vrai, semble alorsêtre un doute destructeur, venant mette à l'écart toute source possible d'erreur.
Néanmoins, le douten'a pas une fonction purement négative, destructrice, au sens où l'incertitude n'est pas une fin.
Ledoute pousse aux limites l'incertitude de la conscience commune mais c'est à ce même endroit qu'ilentend trouver une certitude digne de l'esprit, la certitude la plus haute, qui réside selon Descartesdans le sujet pensant ( cogito ). § Dès lors la certitude la plus haute qu'est le cogito se fonde originairement sur la liberté que l'espritaffirme dans et par le doute.
C'est parce qu'il doute que le sujet peut trouver le cogito comme ce quirésiste au doute.
C'est parce qu'il y a remise en question du savoir que le savoir peut être fondé surdes bases solides et stables et être par là un savoir du vrai.
La remise en question se fait alors unepropédeutique (ce qui précède) à tout savoir. Dès lors, ne peut on pas aller plus loin et affirmer que la remise en question, plus que nécessaire propédeutique ausavoir, devient la condition même de possibilité de tout savoir ? III) La remise en question comme condition de possibilité de tout savoir. § En effet, si le savoir immédiat est source d'erreur et d'illusion, et s'il apparaît nécessaire de le faireprécéder d'une remise en question radicale, alors il semble que l'on puisse émettre l'hypothèse quecette remise en question, soit, plus qu'une propédeutique, une condition de possibilité de laconnaissance, dans la mesure où elle la rendrait possible et que la connaissance ne pourrait êtreassurée que par elle. § C'est la thèse que semble défendre Bachelard, dans la Formation de l'esprit scientifique notamment, « discours préliminaire » et chapitre premier.
En effet, selon lui, il faut procéder à une « psychanalysede la connaissance objective » afin de placer la science et la connaissance dan un état de puretépropre à permettre une science vraie et certaine.
On comprend alors que la « psychanalyse de la connaissance objective »qu'entreprend Bachelard n'a que peu de rapports avec celle de Freud.
Il nes'agit ni de plonger dans les profondeurs du moi, ni d'éclairer les difficultésprésentes de l'individu à partir de son histoire singulière, mais simplement derepérer ce que la rencontre des objets du monde suscite en nous de rêves etde productions imaginaires.
Dissiper les songes qui viennent obstruer l'accèsde l'esprit humain au réel pour rendre possible la connaissance objective, telleest la première motivation de la « psychanalyse » bachelardienne.
Car cesrêves de l'esprit ne vont pouvoir être écartés qu'après avoir été mis en pleinelumière : l'esprit humain ne peut se déprendre de ses rêves qu'en s'yconfrontant.
L'imagination poétique semble donc dans un premier temps êtresimplement ce qui doit être écarté pour que la rencontre avec l'objet puissese faire, pour que l'esprit devienne apte à se former à la science.
Ce que laconnaissance doit délaisser pour devenir objective ne se perd pas, et surtoutne perd rien de sa qualité de production de l'esprit, et va par conséquent seretrouver du côté d'une « métaphysique de l'imagination ».Toutefois, à mesure que Bachelard va progresser dans l'exploration desproductions de l'imaginaire, il va apprendre à en découvrir la consistance et lalogique propre.
L'imagination a ses lois propres.
Elle aussi doit se délivrer du «réalisme », elle doit être « purifiée » à son tour de ce qu'il y a de déjàrationnel dans son approche de l'objet.
La poétique de la rêverie, non moins que la connaissance rationnelle, rencontre ses obstacles, dont elle doit se dégager pour prendre son essor.
Seuleune psychanalyse des images trop familières, trop pleines de l'objet, peut libérer les métaphores poétiques.
Lapsychanalyse bachelardienne revêt alors un double sens : libérant la connaissance rationnelle de la rêverie, ellelibère aussi bien l'imagination des entraves que constituent pour elle les rigueurs de la raison.
Raison et imaginationsont deux facultés jumelles qui ne peuvent, l'une comme l'autre, être pleinement elles-mêmes qu'en étant.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Vous discuterez de la question de savoir ce qui peut être à l'origine des grandes inventions techniques de l'humanité.
- • Se poser la question de savoir si la nature fait bien les choses, c'est se demander s'il faut rester naturel, ou si, au contraire, il faut dépasser le donné, et pour quelles raisons.
- On pose la question de savoir si l'homme est par nature moralement bon ou mauvais.
- Depuis les Grecs, nous savons qu'une vie politique réellement développée conduit à une remise en question du domaine de la vie privée, et à un profond ressentiment vis-à-vis du miracle le plus troublant : le fait que chacun de nous a été fait ce qu'il est - singulier, unique et immuable.
- De l'inutilité du théâtre au théâtre Article dans Le Mercure de France, N° 81, septembre 1896 Alfred Jarry Je crois que la question est définitivement tranchée de savoir si le théâtre doit s'adapter à la foule ou la foule au théâtre.