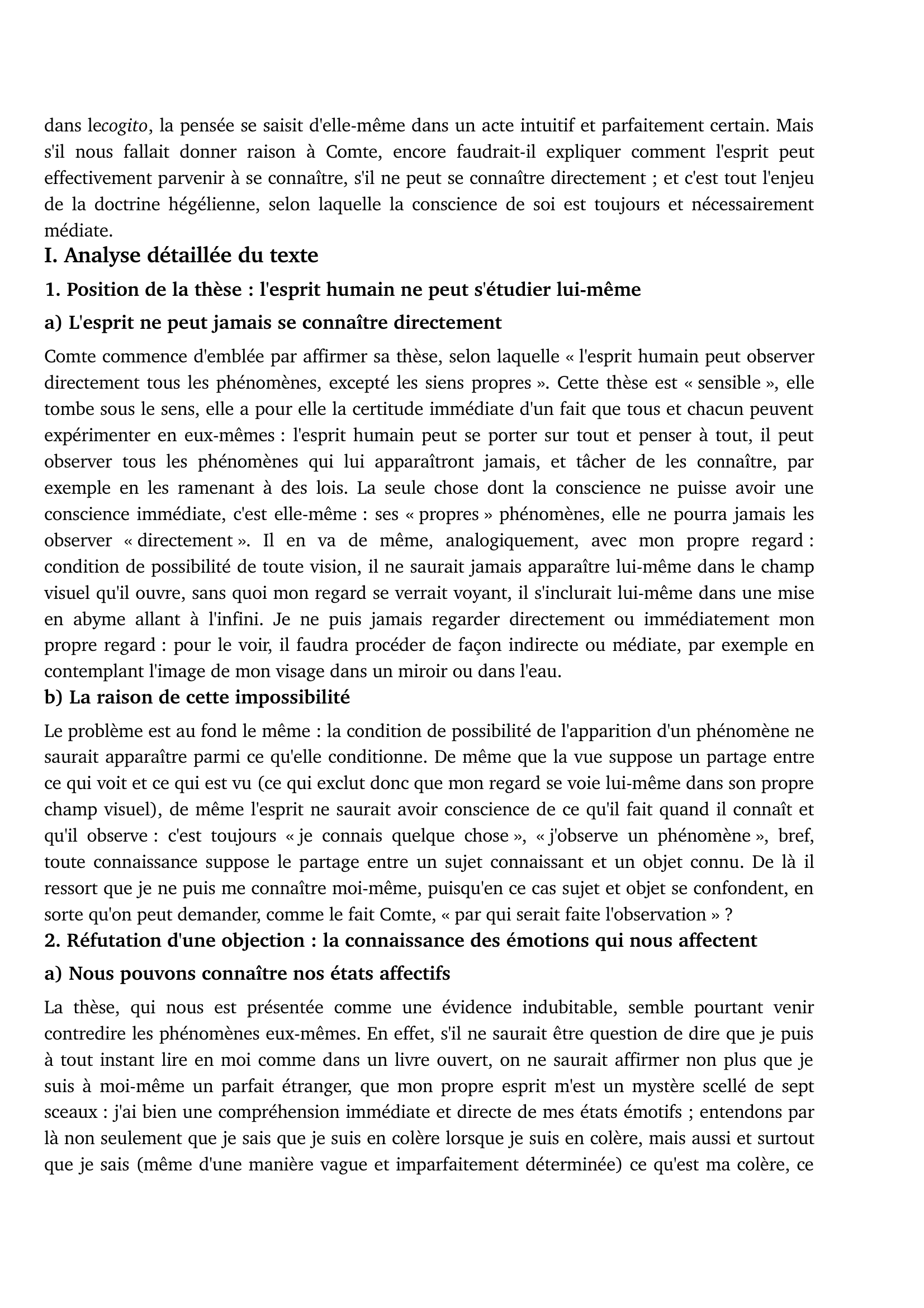Texte de Auguste COMTE
Publié le 29/10/2013

Extrait du document
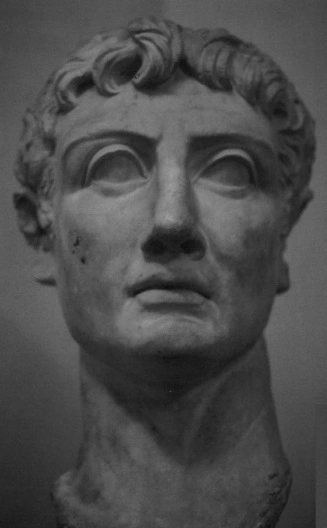
Introduction Dans ce texte, Comte entend démontrer que « l'esprit humain peut observer directement tous les phénomènes, excepté les siens propres « ; en d'autres termes que la conscience ne saurait être immédiatement à elle-même son propre objet. C'est en effet dans mon « esprit « que tout ce qui peut bien exister se manifeste : tout phénomène n'est phénomène que pour une conscience, tout ce qui apparaît apparaît à un sujet. La conscience ou esprit est donc ce qui m'ouvre à la totalité des phénomènes, elle est en quelque sorte la scène sur laquelle le monde lui-même m'apparaît (quand je perds conscience, plus rien n'existe pour moi). Mais, précisément parce qu'il est le lieu où tout se manifeste, l'esprit ne saurait lui-même se manifester à lui-même, sans quoi on sombrerait dans une régression à l'infini.On peut cependant élever une objection bien évidente, celle précisément que Comte envisage immédiatement : je puis bien me connaître moi-même, m'observer moi-même, quand cette observation porte sur des « phénomènes moraux «, c'est-à-dire des passions. Quand je suis triste, je sais que je suis triste. Je puis même, si le coeur m'en dit, me pencher au-dedans de moi et étudier cette tristesse, me demander d'où elle vient, par quels comportements en moi elle se caractérise, ce qu'il faudrait faire pour la voir cesser. Je puis donc connaître, dans une certaine mesure du moins, mes états émotifs et les observer « objectivement «, c'est-à-dire les contempler comme s'il s'agissait d'autant d'objets distincts de moi-même. Comment alors cela est-il possible ? La raison en est simple : ce qui est observé, ce sont des humeurs, des passions, des dispositions ou tonalités émotives ; ce qui observe, c'est la partie intellective de l'esprit. Je puis bien connaître mon état affectif alors, parce que la partie de l'esprit qui observe n'est pas celle qui est observée. Cette connaissance de soi par soi a toutefois elle-même ses limites : une observation rigoureuse réclame le calme et le silence des passions ; en sorte qu'au moment même où l'émotion s'empare de moi, je ne suis pas dans une disposition d'esprit adéquate pour bien l'étudier. Celui qui veut savoir ce qu'est la colère fera mieux alors d'en observer les effets chez autrui plutôt que sur lui-même ; car enfin être en colère, c'est ne pas être en de bonnes dispositions pour connaître quoi que ce soit. Ainsi donc, l'objection nous permet de comprendre le cas plus général de la connaissance de l'esprit par lui-même : si nous pouvons (du moins dans certaines limites) observer nos dispositions émotives, c'est précisément parce que l'esprit peut alors se dédoubler entre partie observée et partie observante. Or un tel dédoublement est impossible quand il s'agit d'étudier la partie intellective de l'esprit elle-même : je puis connaître tous les phénomènes qui se manifestent à mon esprit, hormis l'esprit lui-même, car alors ce qui doit être observé et ce qui observe sont confondus, ce qui rend toute observation impossible. De là s'ensuit que « l'individu pensant&nbs...
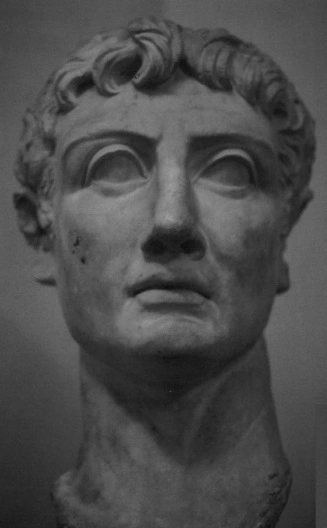
«
dans le cogito , la pensée se saisit d'ellem ême dans un acte intuitif et parfaitement certain. Mais
s'il nous fallait donner raison
à Comte, encore faudraitil expliquer comment l'esprit peut
effectivement parvenir
à se conna ître, s'il ne peut se conna ître directement ; et c'est tout l'enjeu
de la doctrine h
égélienne, selon laquelle la conscience de soi est toujours et n écessairement
m
édiate.
I. Analyse d
étaill ée du texte
1. Position de la th
èse : l'esprit humain ne peut s' étudier luim ême
a) L'esprit ne peut jamais se conna
ître directement
Comte commence d'embl
ée par affirmer sa th èse, selon laquelle « l'esprit humain peut observer
directement tous les ph
énom ènes, except é les siens propres ». Cette th èse est « sensible », elle
tombe sous le sens, elle a pour elle la certitude imm
édiate d'un fait que tous et chacun peuvent
exp
érimenter en euxm êmes : l'esprit humain peut se porter sur tout et penser à tout, il peut
observer tous les ph
énom ènes qui lui appara îtront jamais, et t âcher de les conna ître, par
exemple en les ramenant
à des lois.
La seule chose dont la conscience ne puisse avoir une
conscience imm
édiate, c'est ellem ême : ses « propres » ph énom ènes, elle ne pourra jamais les
observer « directement ».
Il en va de m
ême, analogiquement, avec mon propre regard :
condition de possibilit
é de toute vision, il ne saurait jamais appara ître luim ême dans le champ
visuel qu'il ouvre, sans quoi mon regard se verrait voyant, il s'inclurait luim
ême dans une mise
en abyme allant
à l'infini.
Je ne puis jamais regarder directement ou imm édiatement mon
propre regard : pour le voir, il faudra proc
éder de fa çon indirecte ou m édiate, par exemple en
contemplant l'image de mon visage dans un miroir ou dans l'eau.
b) La raison de cette impossibilit
é
Le probl
ème est au fond le m ême : la condition de possibilit é de l'apparition d'un ph énom ène ne
saurait appara
ître parmi ce qu'elle conditionne. De m ême que la vue suppose un partage entre
ce qui voit et ce qui est vu (ce qui exclut donc que mon regard se voie luim
ême dans son propre
champ visuel), de m
ême l'esprit ne saurait avoir conscience de ce qu'il fait quand il conna ît et
qu'il observe : c'est toujours « je connais quelque chose », « j'observe un ph
énom ène », bref,
toute connaissance suppose le partage entre un sujet connaissant et un objet connu.
De l
à il
ressort que je ne puis me conna
ître moim ême, puisqu'en ce cas sujet et objet se confondent, en
sorte qu'on peut demander, comme le fait Comte, « par qui serait faite l'observation » ?
2.
R
éfutation d'une objection : la connaissance des émotions qui nous affectent
a) Nous pouvons conna
ître nos états affectifs
La th
èse, qui nous est pr ésent ée comme une évidence indubitable, semble pourtant venir
contredire les ph
énom ènes euxm êmes. En effet, s'il ne saurait être question de dire que je puis
à
tout instant lire en moi comme dans un livre ouvert, on ne saurait affirmer non plus que je
suis
à moim ême un parfait étranger, que mon propre esprit m'est un myst ère scell é de sept
sceaux : j'ai bien une compr
éhension imm édiate et directe de mes états émotifs ; entendons par
l
à non seulement que je sais que je suis en col ère lorsque je suis en col ère, mais aussi et surtout
que je sais (m
ême d'une mani ère vague et imparfaitement d étermin ée) ce qu'est ma col ère, ce .
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Commentaire de texte Auguste Comte
- Commentaire de texte Auguste Comte « Les gouvernants voudraient faire admettre la maxime qu'eux seuls sont susceptibles de voir juste en politique »
- COURS DE PHILOSOPHIE POSITIVE Auguste Comte (résumé & analyse)
- JEUNESSE D’AUGUSTE COMTE ET LA FORMATION DU POSITIVISME (LA), 1933, 1936 et 1941. Henri Gouhier
- CATÉCHISME POSITIVISTE d'Auguste Comte (résumé)