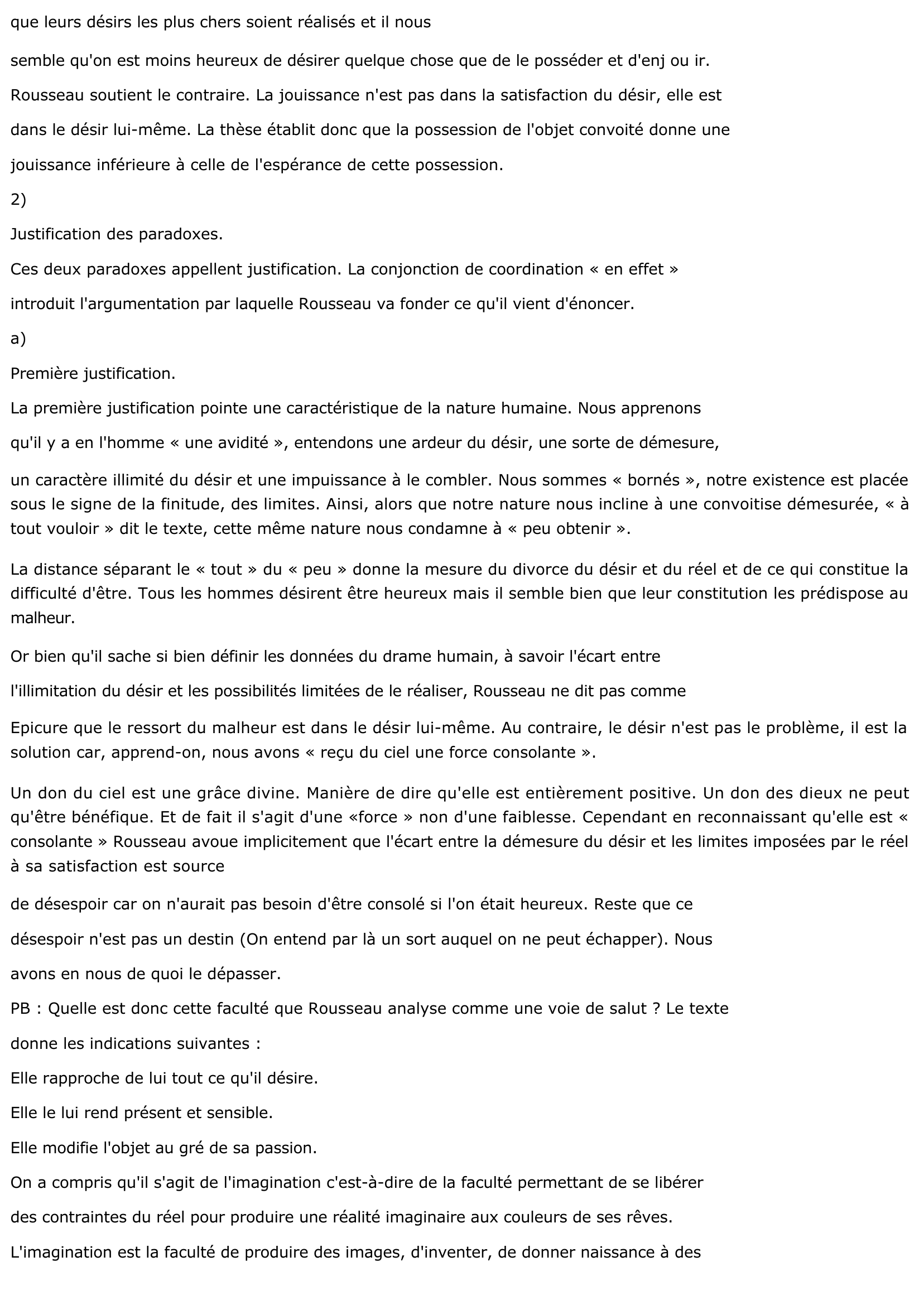« Tant qu'on désire on peut se passer d'être heureux » (Rousseau)
Publié le 15/12/2010
Extrait du document

On croit bien souvent que le bonheur consiste dans la satisfaction du désir mais est-ce bien le cas ? N’y a-t-il pas plus de bonheur dans les illusions du bonheur que dans la jouissance que procure son accomplissement ?
Pour Rousseau, paradoxalement, le bonheur est dans le désir non dans la possession de son objet ou dans la réalisation de sa fin.
Alors l’homme est-il condamné au malheur ? Non, affirme Rousseau, car le désir qui nous y expose est aussi ce qui nous en sauve. « Tant qu’on désire on peut se passer d’être heureux « soutient-il, puisque l’imagination peut ouvrir les portes du « vierge Azur « (Mallarmé) et donner les jouissances que le réel hideux refuse.

«
que leurs désirs les plus chers soient réalisés et il nous
semble qu'on est moins heureux de désirer quelque chose que de le posséder et d'enj ou ir.
Rousseau soutient le contraire.
La jouissance n'est pas dans la satisfaction du désir, elle est
dans le désir lui-même.
La thèse établit donc que la possession de l'objet convoité donne une
jouissance inférieure à celle de l'espérance de cette possession.
2)
Justification des paradoxes.
Ces deux paradoxes appellent justification.
La conjonction de coordination « en effet »
introduit l'argumentation par laquelle Rousseau va fonder ce qu'il vient d'énoncer.
a)
Première justification.
La première justification pointe une caractéristique de la nature humaine.
Nous apprenons
qu'il y a en l'homme « une avidité », entendons une ardeur du désir, une sorte de démesure,
un caractère illimité du désir et une impuissance à le combler.
Nous sommes « bornés », notre existence est placée
sous le signe de la finitude, des limites.
Ainsi, alors que notre nature nous incline à une convoitise démesurée, « à
tout vouloir » dit le texte, cette même nature nous condamne à « peu obtenir ».
La distance séparant le « tout » du « peu » donne la mesure du divorce du désir et du réel et de ce qui constitue la
difficulté d'être.
Tous les hommes désirent être heureux mais il semble bien que leur constitution les prédispose au
malheur.
Or bien qu'il sache si bien définir les données du drame humain, à savoir l'écart entre
l'illimitation du désir et les possibilités limitées de le réaliser, Rousseau ne dit pas comme
Epicure que le ressort du malheur est dans le désir lui-même.
Au contraire, le désir n'est pas le problème, il est la
solution car, apprend-on, nous avons « reçu du ciel une force consolante ».
Un don du ciel est une grâce divine.
Manière de dire qu'elle est entièrement positive.
Un don des dieux ne peut
qu'être bénéfique.
Et de fait il s'agit d'une «force » non d'une faiblesse.
Cependant en reconnaissant qu'elle est «
consolante » Rousseau avoue implicitement que l'écart entre la démesure du désir et les limites imposées par le réel
à sa satisfaction est source
de désespoir car on n'aurait pas besoin d'être consolé si l'on était heureux.
Reste que ce
désespoir n'est pas un destin (On entend par là un sort auquel on ne peut échapper).
Nous
avons en nous de quoi le dépasser.
PB : Quelle est donc cette faculté que Rousseau analyse comme une voie de salut ? Le texte
donne les indications suivantes :
Elle rapproche de lui tout ce qu'il désire.
Elle le lui rend présent et sensible.
Elle modifie l'objet au gré de sa passion.
On a compris qu'il s'agit de l'imagination c'est-à-dire de la faculté permettant de se libérer
des contraintes du réel pour produire une réalité imaginaire aux couleurs de ses rêves.
L'imagination est la faculté de produire des images, d'inventer, de donner naissance à des.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- "Tant qu'on désire on peut se passer d'être heureux ; on s'attend à le devenir : si le bonheur ne vient point, l'espoir se prolonge et le charme de l'illusion dure autant que la passion qui le cause." Rousseau, Julie ou la Nouvelle Héloïse, 1 761 .Commentez cette citation. ?
- DESIR ET ILLUSION "Tant qu'on désire on peut se passer d'être heureux ; on s'attend à le devenir : si le bonheur ne vient point, l'espoir se prolonge et le charme de l'illusion dure autant que la passion qui le cause." Rousseau, Julie ou la Nouvelle Héloise, 1761. Commentez cette citation.
- Voilà tout ce que les hommes ont pu inventer pour se rendre heureux; et ceux qui font sur cela les philosophes et qui croient que le monde est bien peu raisonnable de passer tout le jour à courir après un lièvre qu'ils ne voudraient pas avoir acheté, ne connaissent guère notre nature. Ce lièvre ne nous garantirait pas de la vue de la mort et des misères qui nous en détournent, mais la chasse nous en garantit.
- « On jouit moins de ce qu'on obtient que de ce qu'on espère et l'on n'est heureux qu'avant d'être heureux. » (Rousseau, La Nouvelle Héloïse, 5e partie, lettre VIII)
- Le concept de bonheur est un concept si indéterminé, que, malgré le désir qu'a tout homme d'arriver à être heureux, personne ne peut jamais dire en termes précis et cohérents ce que véritablement il désire et il veut.