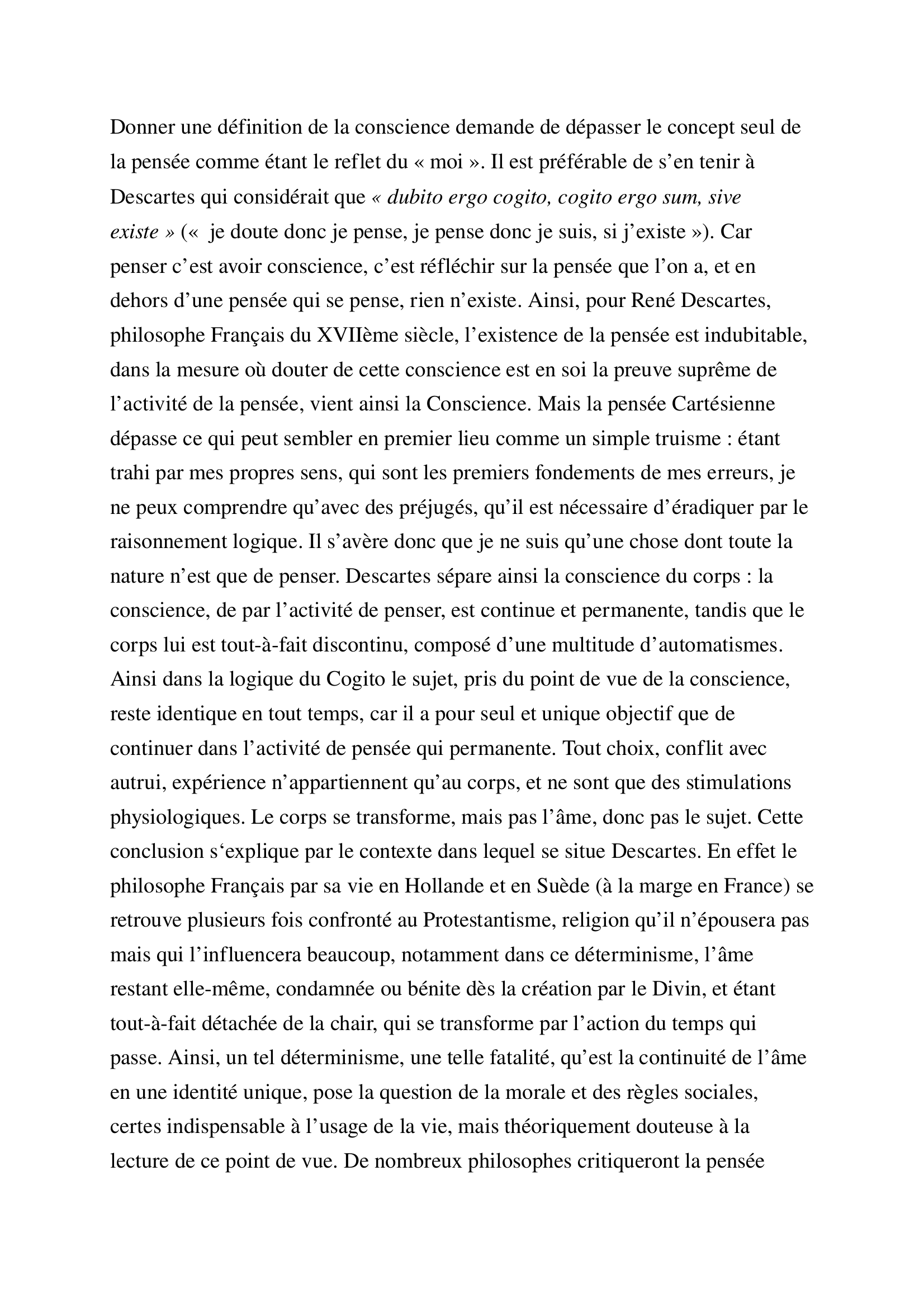Suis-je le même en des temps différents ?
Publié le 09/01/2013
Extrait du document


«
Donner une définition de la conscience demande de d épasser le concept seul de
la pens
ée comme étant le reflet du « moi ». Il est pr éférable de s’en tenir à
Descartes qui consid
érait que « dubito ergo cogito, cogito ergo sum, sive
existe » (« je doute donc je pense, je pense donc je suis, si j’existe »). Car
penser c’est avoir conscience, c’est r
éfléchir sur la pens ée que l’on a, et en
dehors d’une pens
ée qui se pense, rien n’existe. Ainsi, pour Ren é Descartes,
philosophe Fran
çais du XVII ème si ècle, l’existence de la pens ée est indubitable,
dans la mesure o
ù douter de cette conscience est en soi la preuve supr ême de
l’activit
é de la pens ée, vient ainsi la Conscience. Mais la pens ée Cart ésienne
d
épasse ce qui peut sembler en premier lieu comme un simple truisme : étant
trahi par mes propres sens, qui sont les premiers fondements de mes erreurs, je
ne peux comprendre qu’avec des pr
éjug és, qu’il est n écessaire d’ éradiquer par le
raisonnement logique. Il s’av
ère donc que je ne suis qu’une chose dont toute la
nature n’est que de penser. Descartes s
épare ainsi la conscience du corps : la
conscience, de par l’activit
é de penser, est continue et permanente, tandis que le
corps lui est tout
àfait discontinu, compos é d’une multitude d’automatismes.
Ainsi dans la logique du Cogito le sujet, pris du point de vue de la conscience, reste identique en tout temps, car il a pour seul et unique objectif que de continuer dans l’activit é de pens ée qui permanente. Tout choix, conflit avec autrui, exp érience n’appartiennent qu’au corps, et ne sont que des stimulations physiologiques. Le corps se transforme, mais pas l’ âme, donc pas le sujet. Cette conclusion s‘explique par le contexte dans lequel se situe Descartes. En effet le philosophe Fran çais par sa vie en Hollande et en Su ède ( à la marge en France) se retrouve plusieurs fois confront é au Protestantisme, religion qu’il n’ épousera pas mais qui l’influencera beaucoup, notamment dans ce d éterminisme, l’ âme restant ellem ême, condamn ée ou b énite d ès la cr éation par le Divin, et étant tout àfait d étach ée de la chair, qui se transforme par l’action du temps qui passe. Ainsi, un tel d éterminisme, une telle fatalit é, qu’est la continuit é de l’ âme en une identit é unique, pose la question de la morale et des r ègles sociales, certes indispensable à l’usage de la vie, mais th éoriquement douteuse à la lecture de ce point de vue. De nombreux philosophes critiqueront la pens ée . »
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Le temps est invention. Bergson
- Texte d’étude : Charles Baudelaire, « L’Ennemi », Les Fleurs du Mal (1857): Le temps mange-t-il la vie ? (HLP Philo)
- Penser le temps
- Faut-il craindre de perdre son temps ?
- Barjavel_La_nuit_des_temps