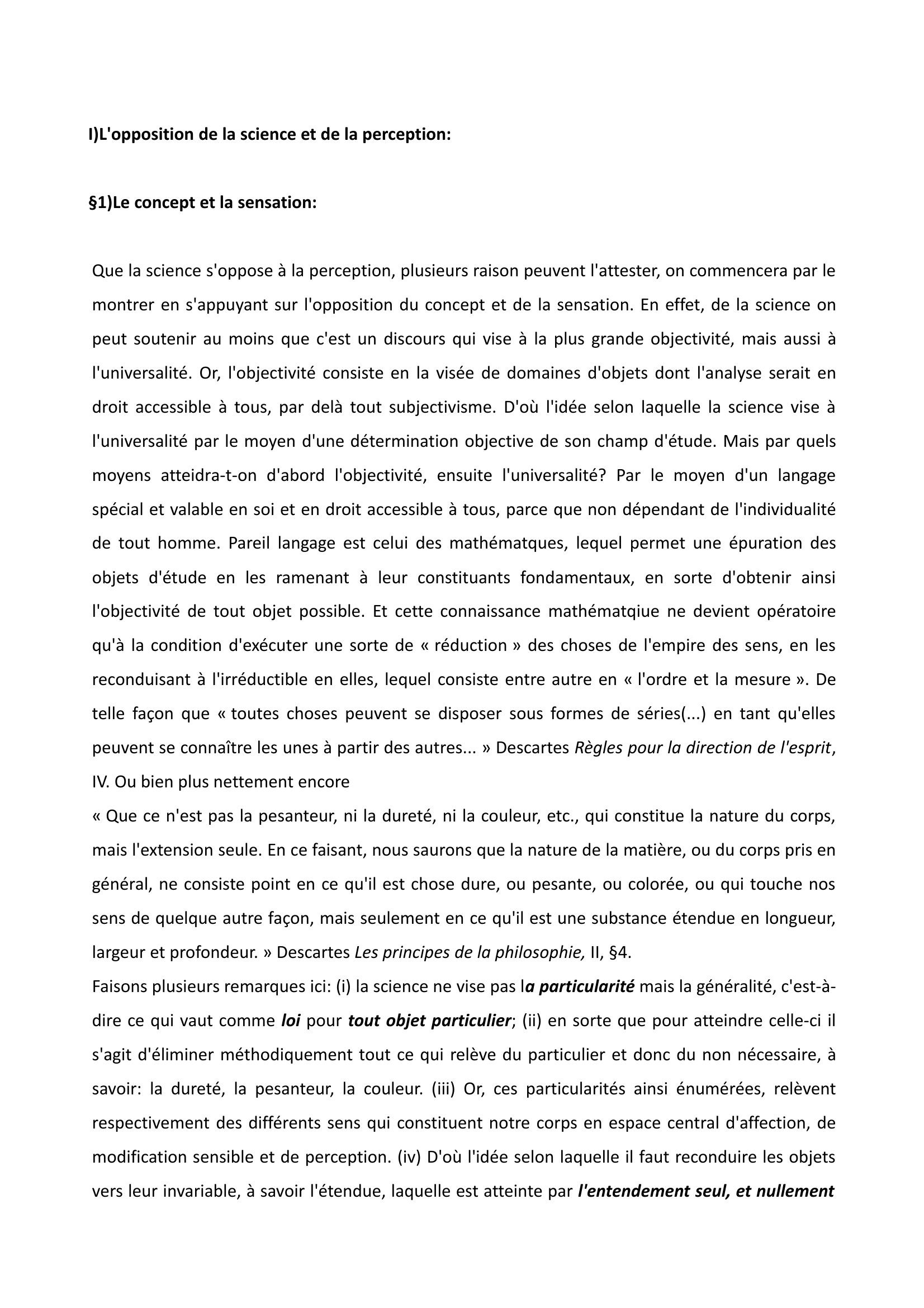Science perception et réalité
Publié le 02/02/2012
Extrait du document

Introduction
Dans les représentations les plus répandues, lorsque l'on parle de la science, on se figure un
processus, en gros, en deux temps, et cependant très complexe, d'hypothèses et de vérifications,
s'opérant au moyen du langage mathématique. Lequel langage apporterait la précision et le calcul
nécessaires à la manipulation des faits. De sorte que sous le mot « science « on n'hésitera pas à
classer aussi bien: les mathématiques, la physique, la biologie que la chimie, etc. Cependant que le
concept de perception renvoie le plus souvent à des sensations vives, à des impressions présentes
qui seraient au principe de notre vision spontanée du monde. Néanmoins, pareille perception ne
se limite nullement aux organes de la vue, puisque nous percevons aussi bien par l'ouïe, par le
toucher que par le goût et l'odorat. Si bien que la perception relèverait des « impressions « et des
sensations, des sentiments et des présentiments, bref tout ce qui renvoie au flou, au vague, à
l'imprécis, à l'expérience vécu, en un mot au subjectif. Tandis que la science relèverait du domaine
du maîtrisable et du calculable, de la précision et de l'objectivité. C'est donc assez spontanément
que l'on opposera la science à la perception.

«
I)L'opposition
de la scie nce et d e la p erception: §1)Le
concept et la sensa tion: Que
la sc ienc e s'oppose à la per cep tion, plus ieurs r a ison p euv ent l'at tes ter , on c ommen cera par le
mon
trer en s' appu yan t sur l'opposition du c oncep t e t de la sensa tion.
En e ffe t, de la sc ienc e on
peut
sout enir au mo ins que c'es t un d isc our s qui v ise à la plus gr ande object ivité, ma is auss i à
l'univ
ersalit é.
Or , l'obje ctivité c ons iste en la visé e de dom aines d'obje ts don t l'a naly se s er ait en
dr
oit acce ssible à t ous, par de là t out subject ivisme.
D' où l' idée se lon laquel le la sc ience vise à
l'univ
ersalit é par le mo yen d'une dé term ination obj ectiv e d e son champ d 'é tude.
Ma is par que ls
mo
yens at te idr a-t-on d 'abo rd l'object ivité, en suit e l'un iver sal ité? P ar le mo yen d'un lang age
spéc
ial e t v alable e n soi e t en dr oit access ible à t ous, par ce que non dépendan t de l' individual ité
de
t out homme.
P ar eil lang age e st c elu i des ma théma tques, leque l per met une épu ra tion des
obje
ts d'é tude en les ramenan t à leur c ons tituan ts fond amen taux, en sort e d'o bteni r ainsi
l'object
ivité de t out obje t possib le.
E t ce tt e c onnaissance ma théma tqiue ne de vien t opé ra toir e
qu'
à la c ond ition d'e xé cut er une sort e d e « r
éduction »
des chos es d e l'empir e d es sens, en le s
r
ec onduisan t à l'irr éduct ible en e lles, lequ el c ons iste en tre au tre e n « l'or
dre e t la mesur e ».
De
t
e lle faç on que « t
out es choses peuv ent s e d isposer sous formes de sé ries(...
) e n t an t qu'el les
peuv
ent se c onnaîtr e le s un es à partir des aut res...
»
D esc artes R
èg les p our la di rection de l'espr it ,
IV
.
Ou bien plus ne tt emen t encore « Qu
e ce n'es t pas la pesan teu r, ni la dur eté, ni la c ouleu r, e tc., qui c ons titue la na tur e du c orp s,
mais
l'e xtension seu le.
E n ce fa isant, nous saurons que la na ture de la ma tièr e, ou du corp s pris en
g
énér al, ne c ons iste poin t e n c e qu'il es t chose dur e, ou pesan te, ou c o lor ée, ou qu i t ouche nos
sens
d e que lque autr e f aç on, ma is seu lem ent en c e qu'i l e st une sub stance é tendu e en longueur ,
lar
geur et pr ofondeur .
» Desc
artes Les pri
ncipes de la ph ilos oph ie, II,
§4.
F
aisons plusieurs remar ques ici: (i) la sc ience ne vise pas l a
pa rticu larit é mais
la gén éralité, c'es t-à- dir
e c e qu i v aut c om me
loi
pour t
out obje t p artic ulier ;
(i i) en sort e que pour at te indr e ce lle-ci il
s'
agit d'él imin er mé thodique ment t out ce qui r elè ve du particul ier e t donc du non né cessair e, à
sa
voi r: la dur eté, la pesan teu r, la c ou leur .
(ii i) Or , c es particular ités ainsi énu mér ées, r e lè ven t
r
espect ivem ent de s d if fér en ts sens qu i c on stituen t notr e c orp s en espace c en tral d' affect ion, de
modif
ication sens ible e t de per ception.
(iv) D'où l' idée se lon laqu elle il f aut r e conduir e le s obje ts
v
er s leur in variable, à sa voi r l'é tendue, laquel le e st at te in te par l'en
tendemen t seul, e t nu llemen t.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Vérité, réalité et science Science : Définition :
- Expliquez et discutez l’une des trois assertions suivantes : la perception est une hallucination vraie (Taine); les enfants, n’étant pas capables de jugement, n’ont pas de véritable mémoire Rousseau); en réalité, la conscience est une conséquence de la personnalité et nullement son constitutif
- Expliquer et discuter cette affirmation de G. Belot : La science est née à la chasse, à la cuisine, à l'atelier, dans l'exercice libre et profane des activités techniques et intellectuelles directement déterminées par le besoin ou la curiosité et faisant leur apprentissage au contact de la réalité.
- Expliquez et discutez cette affirmation de G. Belot : « La science est née à la chasse, à la cuisine, à l'atelier, dans l'exercice libre et profane des activités techniques et intellectuelles directement déterminées par le besoin ou la curiosité et faisant leur apprentissage au contact de la réalité. »
- Expliquer et discuter cette affirmation de G. Belot : e La science est née à la chasse, à la cuisine, à l'atelier, dans l'exercice libre et profane des activités techniques et intellectuelles directement déterminées par le besoin ou la curiosité et faisant leur apprentissage au contact de la réalité. »