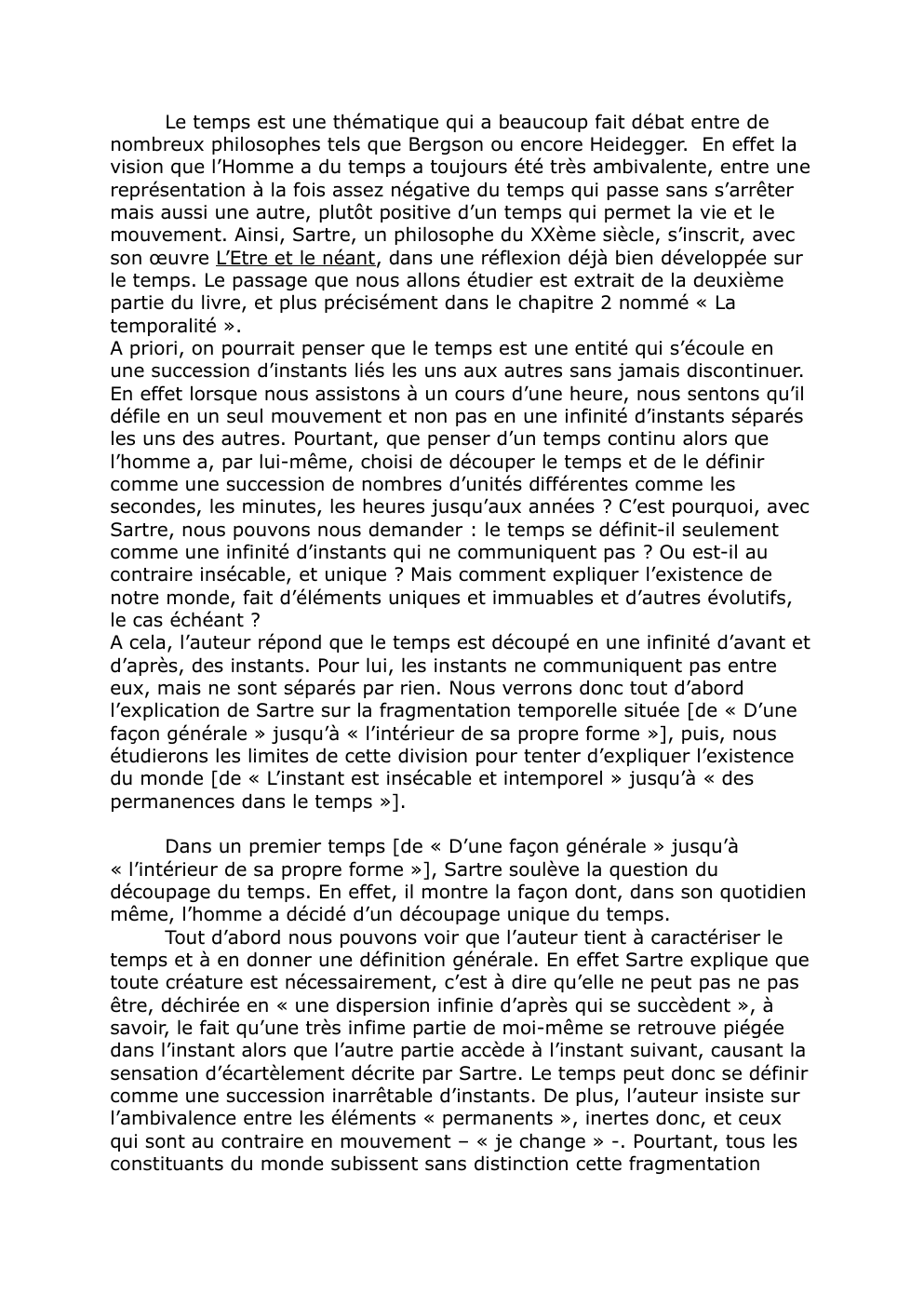Sartre, l'Être et le Néant: extrait de la deuxième partie du livre, et plus précisément dans le chapitre 2 nommé « La temporalité ».
Publié le 26/03/2025
Extrait du document
«
Le temps est une thématique qui a beaucoup fait débat entre de
nombreux philosophes tels que Bergson ou encore Heidegger.
En effet la
vision que l’Homme a du temps a toujours été très ambivalente, entre une
représentation à la fois assez négative du temps qui passe sans s’arrêter
mais aussi une autre, plutôt positive d’un temps qui permet la vie et le
mouvement.
Ainsi, Sartre, un philosophe du XXème siècle, s’inscrit, avec
son œuvre L’Etre et le néant, dans une réflexion déjà bien développée sur
le temps.
Le passage que nous allons étudier est extrait de la deuxième
partie du livre, et plus précisément dans le chapitre 2 nommé « La
temporalité ».
A priori, on pourrait penser que le temps est une entité qui s’écoule en
une succession d’instants liés les uns aux autres sans jamais discontinuer.
En effet lorsque nous assistons à un cours d’une heure, nous sentons qu’il
défile en un seul mouvement et non pas en une infinité d’instants séparés
les uns des autres.
Pourtant, que penser d’un temps continu alors que
l’homme a, par lui-même, choisi de découper le temps et de le définir
comme une succession de nombres d’unités différentes comme les
secondes, les minutes, les heures jusqu’aux années ? C’est pourquoi, avec
Sartre, nous pouvons nous demander : le temps se définit-il seulement
comme une infinité d’instants qui ne communiquent pas ? Ou est-il au
contraire insécable, et unique ? Mais comment expliquer l’existence de
notre monde, fait d’éléments uniques et immuables et d’autres évolutifs,
le cas échéant ?
A cela, l’auteur répond que le temps est découpé en une infinité d’avant et
d’après, des instants.
Pour lui, les instants ne communiquent pas entre
eux, mais ne sont séparés par rien.
Nous verrons donc tout d’abord
l’explication de Sartre sur la fragmentation temporelle située [de « D’une
façon générale » jusqu’à « l’intérieur de sa propre forme »], puis, nous
étudierons les limites de cette division pour tenter d’expliquer l’existence
du monde [de « L’instant est insécable et intemporel » jusqu’à « des
permanences dans le temps »].
Dans un premier temps [de « D’une façon générale » jusqu’à
« l’intérieur de sa propre forme »], Sartre soulève la question du
découpage du temps.
En effet, il montre la façon dont, dans son quotidien
même, l’homme a décidé d’un découpage unique du temps.
Tout d’abord nous pouvons voir que l’auteur tient à caractériser le
temps et à en donner une définition générale.
En effet Sartre explique que
toute créature est nécessairement, c’est à dire qu’elle ne peut pas ne pas
être, déchirée en « une dispersion infinie d’après qui se succèdent », à
savoir, le fait qu’une très infime partie de moi-même se retrouve piégée
dans l’instant alors que l’autre partie accède à l’instant suivant, causant la
sensation d’écartèlement décrite par Sartre.
Le temps peut donc se définir
comme une succession inarrêtable d’instants.
De plus, l’auteur insiste sur
l’ambivalence entre les éléments « permanents », inertes donc, et ceux
qui sont au contraire en mouvement – « je change » -.
Pourtant, tous les
constituants du monde subissent sans distinction cette fragmentation
temporelle.
Sartre prend en exemple une table comme « permanent »
mais un ordinateur convient tout autant à cette catégorie.
En effet, le
temps va entrainer un changement de l’ordinateur, plutôt négatif, qui finira
par être inutilisable.
La dualité des éléments quant à leur nature n’est
donc pas un critère modifiant la façon dont on subit le temps.
De plus, Sartre expose par la suite, la vision que l’homme possède
du temps, à la fois plutôt négative comme celle d’un temps qui passe sans
jamais discontinuer et qui est un rappel constant de notre contingence,
mais aussi celle d’un temps qui constitue le fondement de notre vie.
Selon
l’auteur, le temps me sépare de ce que je suis, car je suis « écartelé »
entre le passé et le futur.
C’est le temps qui cause cette sensation, comme
nous l’avons dit précédemment, et qui me force à laisser dans chaque
instant une partie du Moi.
Ainsi, l’homme est constamment séparé « de ce
[qu’il a] été », c’est à dire de la personne qu’il était dans le passé mais
aussi « de ce [qu’il] veut être, car après tout le futur n’est pas encore
présent.
C’est cette conception du temps qui nous apparait de façon très
négative.
C’est malgré tout le temps qui se trouve « choisi » comme unité
plus significative de la distance.
C’est l’homme lui-même qui a décidé de
ce découpage, utilisé notamment pour exprimer, comme le dit l’auteur, le
temps nécessaire pour faire une tâche ou un trajet.
Par exemple, un jeune
étudiant s’organise dans ses révisions en fonction du temps qu’il lui faut
pour exécuter la tâche et va donc commencer à réviser une semaine avant
le devoir.
Mais si le devoir en question étais plus rapide, il s’y attèlerait
que deux jours avant.
Cette unité qu’est le temps possède donc un réel
sens pour l’homme qui l’utilise dans tous les domaines de sa vie.
Enfin, Sartre dépeint sa représentation de la fragmentation
temporelle qui vient s’inscrire dans le contexte de la vision humaine du
temps décrite plus tôt dans l’explication du texte.
En effet, il découle du
fait que le temps soit la « mesure pratique de la distance », que la façon
temporelle d’appréhender ce qui nous entoure peut-être perçue comme un
« émiettement d’avant et d’après » infini.
En effet le temps a été défini
comme une dispersion infinie d’après, donc à l’échelle de la terre, le temps
vécu par les hommes et leur monde ne représente qu’une poussière
d’instants.
Sartre défini ensuite « l’unité de cet émiettement », qu’il
nomme instant et qui représente la façon dont le temps est découpé.
Les
instants sont successifs et forment un passé et un futur.
Ils ne possèdent
pas « d’avant » ou « d’après » d’où le fait qu’ils puissent former, selon
Sartre, une unité temporelle.
Le philosophe défini même l’instant comme
un « atome temporel », percevable analogiquement à un atome physique,
soit un constituant de la base du temps.
Par exemple, une montre ou
encore une horloge est un outil pour que l’homme puisse séparer le temps
et qu’il puisse donc s’appuyer dessus pour organiser sa vie.
Bergson,
philosophe français, s’oppose à cette façon de percevoir le temps.
Il
distingue, en effet, le temps objectif des horloges, une commodité sociale,
du temps subjectif intérieur, la durée, qui correspond au temps ressenti
par l’homme.
Ainsi, il considère que l’homme vit dans le temps long, le
temps de la mémoire, opposé au temps mesuré défendu par Sartre.
Ainsi, l’auteur de L’Être et le Néant présente le temps comme une
fraction d’instants qui se suivent et dont l’homme se sert tout au long de
sa vie pour donner sens aux dimensions de l’espace.
Mais comment
expliquer la continuité du temps alors qu’il est....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Les conduites de mauvaise foi dans L'Etre et le Néant - 1re partie, chapitre II - Sartre (commentaire)
- Situation du texte dans L'Etre et le Néant - 1re partie, chapitre II - Sartre (commentaire)
- Mauvaise foi et mensonge dans L'Etre et le Néant - 1re partie, chapitre II - Sartre (commentaire)
- La « foi » de la mauvaise foi dans L'Etre et le Néant - 1re partie, chapitre II - Sartre (commentaire)
- Fiche de lecture. Sartre, L'Etre et le néant (Étude du premier chapitre de la deuxième partie : La présence à soi)