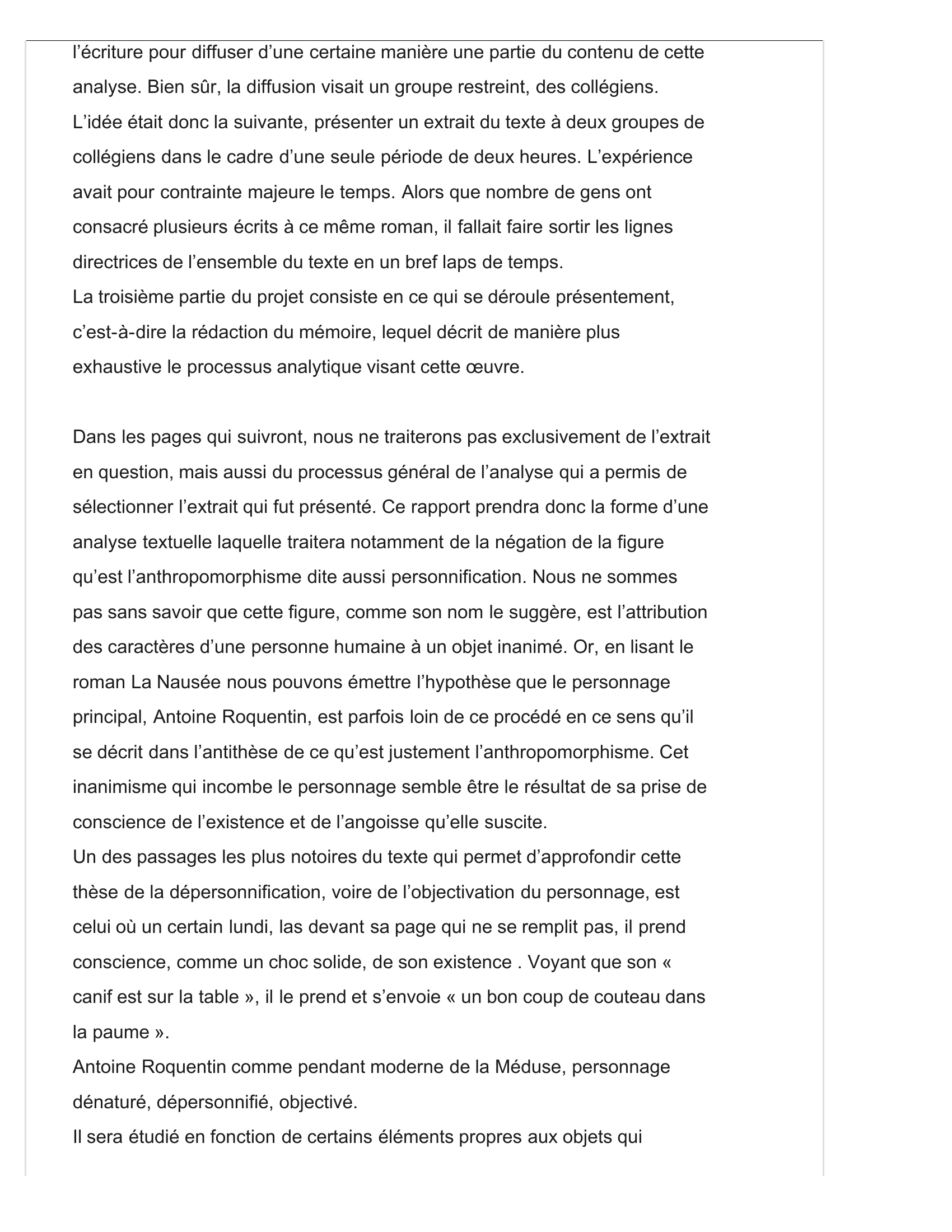SARTRE ET LA DENATURATION
Publié le 27/02/2014
Extrait du document

que le morcellement aboutit à son plein épanouissement. On lit dans le
même paragraphe les mots : doigts, ventre, pattes, dos, ongles, poils,
phalanges, bras, main et cuisse. En aucun instant il ne fait directement appel
au mot « corps « . Il y renvoie sans cesse par l’entremise de ses constituants.
C’est la division de l’être, le démembrement de l’individu. De plus, lorsqu’il
regarde sa main, il la voit sur le dos la comparant à un crabe. Disant « ma
main, c’est moi «, il établit un parallèle entre sa main et un crustacé, ce qui,
par le réseau de signification qui s’est implanté, induit que le crabe, c’est lui.
Le crabe est tombé sur le dos. On voit facilement que le rapport à l’être
humain est directement en corrélation avec le monde animal; il n’y a plus
seulement une métaphore qui oppose l’être à ses parties, mais également
l’être à un crustacé. (Cette image du crustacé n’est pas isolée à travers le
roman, elle est reprise notamment à la page 177 :
« Tout d’un coup, j’ai perdu mon apparence d’homme et ils ont vu un crabe
qui s’échappait à reculons de cette salle si humaine. «)
La déhumanisation est d’autant plus forte. Ses doigts deviennent des pattes,
le dos de sa main « on dirait un poisson « – il surenchérit avec l’aspect
visqueux –, la main sur le dos est « une bête à la renverse « ainsi qu’un
crabe mort. Il n’a plus rien d’humain ou presque puisqu’il lui reste toujours
l’aspect psychologique.
LE LANGAGE, LA PENSÉE
Arrive ensuite le paragraphe où il aborde l’aspect psychologique de son être
où encore une fois survient l’idée de douceur, de fadeur. Il faut préciser que
lorsqu’on parle de douceur, on induit immanquablement l’idée de quelque
chose qui est présent de manière subtile, que ce soit en terme de goût, de
son, de couleur, etc. Roquentin nous dit que « les pensées c’est ce qu’il y a
de plus fade. Plus fade encore que la chair. « alors que le texte semblait
nous suggérer que l’existence de son corps était ce qui le dérangeait le plus,
nous nous apercevons qu’il y a pire, les pensées. – « Dans […] la mélancolie,
c’est l’aversion morale du malade à l’égard de son propre moi qui vient en
premier plan [..] « [Freud, 1968; p.153] – Le corps, oui, il dérange, mais les
pensées c’est pis. C’est à nouveau la gradation qui reprend de manière plus
précise celle où il nous présentait l’éveil de l’existence dans sa personne. La
découverte de l’existence se déroulait en trois temps, c’est-à-dire la prise de
conscience, l’englobement qui touche strictement l’aspect physique et plus
tard le remplissage, phénomène qui concerne l’intérieur de l’être. Cette idée
de progression dans la découverte de l’existence est maintenant reprise
cohésivement en plus d’y adjoindre le choc de l’angoisse qu’elle suscite.
Roquentin s’acharne maintenant sur son aspect psychologique. Terminé le
morcellement du corps, abordons, celui de la pensée en s’attaquant à un de
ses organisateurs majeurs, le langage.
« et puis il y a les mots, au-dedans des pensées, les mots inachevés, les
ébauches de phrases qui reviennent tout le temps. «

«
l’écriture pour diffuser d’une certaine manière une partie du contenu de cette
analyse.
Bien sûr, la diffusion visait un groupe restreint, des collégiens.
L’idée était donc la suivante, présenter un extrait du texte à deux groupes de
collégiens dans le cadre d’une seule période de deux heures.
L’expérience
avait pour contrainte majeure le temps.
Alors que nombre de gens ont
consacré plusieurs écrits à ce même roman, il fallait faire sortir les lignes
directrices de l’ensemble du texte en un bref laps de temps.
La
troisième partie du projet consiste en ce qui se déroule présentement,
c’est-à-dire la rédaction du mémoire, lequel décrit de manière plus
exhaustive le processus analytique visant cette œuvre.
Dans
les pages qui suivront, nous ne traiterons pas exclusivement de l’extrait
en question, mais aussi du processus général de l’analyse qui a permis de
sélectionner l’extrait qui fut présenté.
Ce rapport prendra donc la forme d’une
analyse textuelle laquelle traitera notamment de la négation de la figure
qu’est l’anthropomorphisme dite aussi personnification.
Nous ne sommes
pas sans savoir que cette figure, comme son nom le suggère, est l’attribution
des caractères d’une personne humaine à un objet inanimé.
Or, en lisant le
roman La Nausée nous pouvons émettre l’hypothèse que le personnage
principal, Antoine Roquentin, est parfois loin de ce procédé en ce sens qu’il
se décrit dans l’antithèse de ce qu’est justement l’anthropomorphisme.
Cet
inanimisme qui incombe le personnage semble être le résultat de sa prise de
conscience de l’existence et de l’angoisse qu’elle suscite.
Un
des passages les plus notoires du texte qui permet d’approfondir cette
thèse de la dépersonnification, voire de l’objectivation du personnage, est
celui où un certain lundi, las devant sa page qui ne se remplit pas, il prend
conscience, comme un choc solide, de son existence .
Voyant que son «
canif est sur la table », il le prend et s’envoie « un bon coup de couteau dans
la paume ».
Antoine
Roquentin comme pendant moderne de la Méduse, personnage
dénaturé, dépersonnifié, objectivé.
Il sera
étudié en fonction de certains éléments propres aux objets qui.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- « Tout existant naît sans raison, se prolonge par faiblesse et meurt par rencontre » JEAN-PAUL SARTRE
- [La condition humaine] Sartre (texte)
- La morale de Sartre
- philo texte de Sartre sur l'amour
- Cours "Sartre - l'existentialisme"