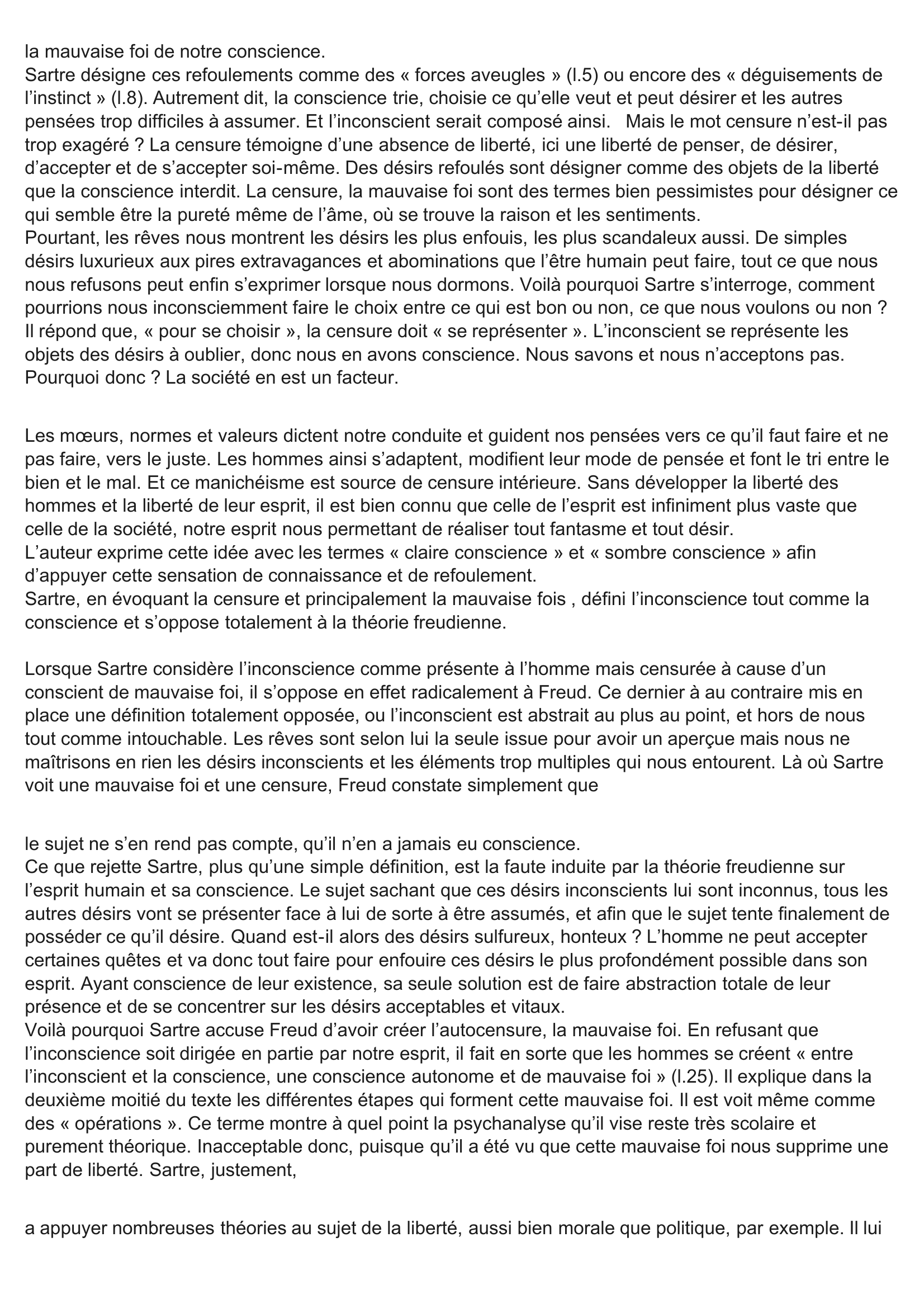Sartre contre Freud
Publié le 12/01/2013
Extrait du document

Pour conclure, Sartre donne une définition de l’inconscient opposée à celle de Freud, et appui son
argumentation sur de nombreux exemples que d’autres auteurs comme Alain ont auparavant avancés.
La conscience, connu principalement comme le repère de nos désirs sains et de nos pensées, ne serait
en vérité qu’un espace de clarté dans une zone plus vaste qu’elle cherche à dissimuler, qu’elle nous
interdit. L’homme qui se dit maître de ses pensées, de ses désirs et pense que l’esprit possède une
liberté sans limite, connaît en réalité une censure quotidienne et violente, lui laissant simplement
percevoir des courts symboles représentants ce qui lui est interdit. Le problème n’est plus de savoir si la
conscience est de mauvaise foi, mais plutôt de savoir où se trouve la limite à la liberté humaine, si elle
n’est qu’extérieure à l’homme ou si c’est justement l’extérieur, la société, qui le rend prisonnier au coeur
même de son

«
la mauvaise foi de notre conscience.
Sartre désigne ces refoulements comme des « forces aveugles » (l.5) ou encore des « déguisements de
l’instinct » (l.8).
Autrement dit, la conscience trie, choisie ce qu’elle veut et peut désirer et les autres
pensées trop difficiles à assumer.
Et l’inconscient serait composé ainsi.
Mais le mot censure n’est-il pas
trop exagéré ? La censure témoigne d’une absence de liberté, ici une liberté de penser, de désirer,
d’accepter et de s’accepter soi-même.
Des désirs refoulés sont désigner comme des objets de la liberté
que la conscience interdit.
La censure, la mauvaise foi sont des termes bien pessimistes pour désigner ce
qui semble être la pureté même de l’âme, où se trouve la raison et les sentiments.
Pourtant, les rêves nous montrent les désirs les plus enfouis, les plus scandaleux aussi.
De simples
désirs luxurieux aux pires extravagances et abominations que l’être humain peut faire, tout ce que nous
nous refusons peut enfin s’exprimer lorsque nous dormons.
Voilà pourquoi Sartre s’interroge, comment
pourrions nous inconsciemment faire le choix entre ce qui est bon ou non, ce que nous voulons ou non ?
Il répond que, « pour se choisir », la censure doit « se représenter ».
L’inconscient se représente les
objets des désirs à oublier, donc nous en avons conscience.
Nous savons et nous n’acceptons pas.
Pourquoi donc ? La société en est un facteur.
Les mœurs, normes et valeurs dictent notre conduite et guident nos pensées vers ce qu’il faut faire et ne
pas faire, vers le juste.
Les hommes ainsi s’adaptent, modifient leur mode de pensée et font le tri entre le
bien et le mal.
Et ce manichéisme est source de censure intérieure.
Sans développer la liberté des
hommes et la liberté de leur esprit, il est bien connu que celle de l’esprit est infiniment plus vaste que
celle de la société, notre esprit nous permettant de réaliser tout fantasme et tout désir.
L’auteur exprime cette idée avec les termes « claire conscience » et « sombre conscience » afin
d’appuyer cette sensation de connaissance et de refoulement.
Sartre, en évoquant la censure et principalement la mauvaise fois , défini l’inconscience tout comme la
conscience et s’oppose totalement à la théorie freudienne.
Lorsque Sartre considère l’inconscience comme présente à l’homme mais censurée à cause d’un
conscient de mauvaise foi, il s’oppose en effet radicalement à Freud.
Ce dernier à au contraire mis en
place une définition totalement opposée, ou l’inconscient est abstrait au plus au point, et hors de nous
tout comme intouchable.
Les rêves sont selon lui la seule issue pour avoir un aperçue mais nous ne
maîtrisons en rien les désirs inconscients et les éléments trop multiples qui nous entourent.
Là où Sartre
voit une mauvaise foi et une censure, Freud constate simplement que
le sujet ne s’en rend pas compte, qu’il n’en a jamais eu conscience.
Ce que rejette Sartre, plus qu’une simple définition, est la faute induite par la théorie freudienne sur
l’esprit humain et sa conscience.
Le sujet sachant que ces désirs inconscients lui sont inconnus, tous les
autres désirs vont se présenter face à lui de sorte à être assumés, et afin que le sujet tente finalement de
posséder ce qu’il désire.
Quand est-il alors des désirs sulfureux, honteux ? L’homme ne peut accepter
certaines quêtes et va donc tout faire pour enfouire ces désirs le plus profondément possible dans son
esprit.
Ayant conscience de leur existence, sa seule solution est de faire abstraction totale de leur
présence et de se concentrer sur les désirs acceptables et vitaux.
Voilà pourquoi Sartre accuse Freud d’avoir créer l’autocensure, la mauvaise foi.
En refusant que
l’inconscience soit dirigée en partie par notre esprit, il fait en sorte que les hommes se créent « entre
l’inconscient et la conscience, une conscience autonome et de mauvaise foi » (l.25).
Il explique dans la
deuxième moitié du texte les différentes étapes qui forment cette mauvaise foi.
Il est voit même comme
des « opérations ».
Ce terme montre à quel point la psychanalyse qu’il vise reste très scolaire et
purement théorique.
Inacceptable donc, puisque qu’il a été vu que cette mauvaise foi nous supprime une
part de liberté.
Sartre, justement,
a appuyer nombreuses théories au sujet de la liberté, aussi bien morale que politique, par exemple.
Il lui.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Sartre contre Freud : l'inconscient et la liberté
- « Tout existant naît sans raison, se prolonge par faiblesse et meurt par rencontre » JEAN-PAUL SARTRE
- [La condition humaine] Sartre (texte)
- La morale de Sartre
- commentaire de texte sur l’extrait de Le Moi et le Ça, Sigmund Freud, 1923