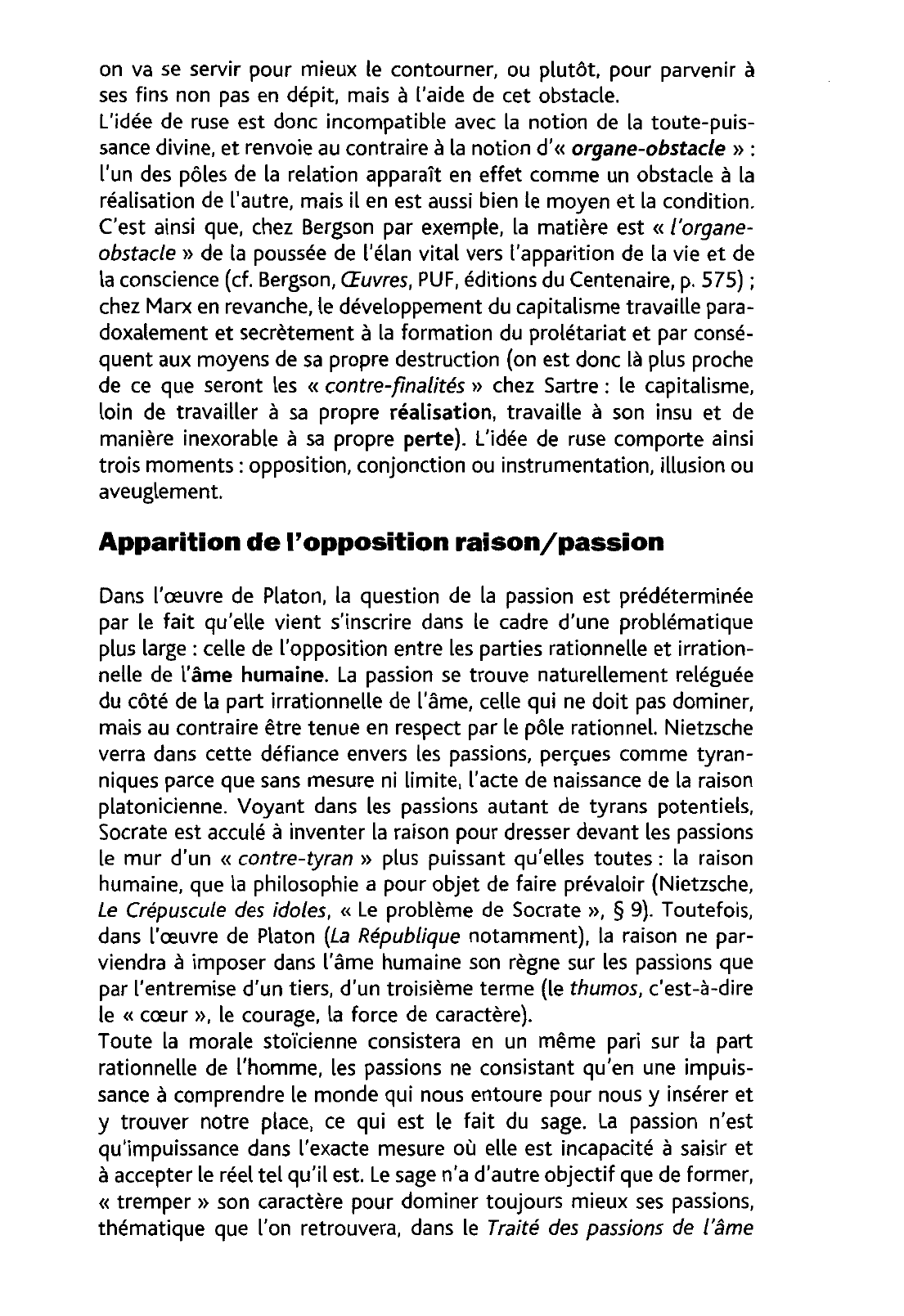Ruse de la raison, ruse de la passion chez Hegel
Publié le 28/03/2015
Extrait du document
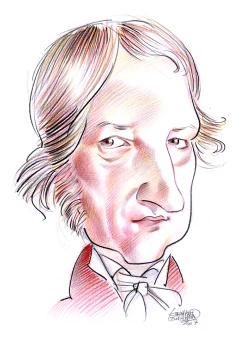
On sait que Hume, en empiriste cohérent, ne reconnaît pas dans l'esprit humain le lieu de naissance de quoi que ce soit.
Il se produit simplement dans l'âme humaine un processus de duplication en vertu duquel certaines impressions au moins se «subliment« en idées.
Chez l'homme, une tendance ou une inclination ne peut s'exacerber en passion que dans la mesure où elle vient se heurter à cet obstacle que constitue ta raison.
«On n'accordera pas le nom de passion, chez les simples animaux, à l'inclination même la plus violente, car ils sont privés de toute raison qui, seule, fonde le concept de liberté et avec laquelle la passion entre en collision« (Kant, Anthropologie, première partie, III, § 82, éditions Gallimard, collection «Pléiade«, tome III, p. 1085).
Pour que ce passage de l «être doué de raison« à l «être rationnel« soit possible, il faut que l'homme puisse agir en l'absence de tout mobile sensible, de toute passion, voire à l'encontre de toutes ses passions, en vertu de la seule représentation de son devoir que la raison en lui représente.
L'objection que Hegel va faire à ta morale kantienne peut s'exposer à partir de la distinction entre deux sens du mot «intérêt« : une chose est d'agir par intérêt (c'est-à-dire en attendant un bénéfice tout autre de l'action que l'on entreprend), c'en est une tout autre de s'intéresser à ce que l'on fait, c'est-à-dire de s'investir tout entier, passionnément, dans l'action que l'on entreprend.
Autant, dans le premier cas, l'homme reste étranger à l'action qu'il entreprend, elle n'est pour lui qu'un moyen pour réaliser une fin tout autre (il est «aliéné«, dira Marx plus tard, en ce sens que sa propre activité lui demeure étrangère), autant dans le second il s'investit et se reconnaît dans son oeuvre qu'il fait ainsi pleinement sienne.
La Raison universelle (non plus ta faculté de l'individu humain) n'a pas d'autre ressource que de se réaliser par le biais des passions humaines.
«L'universel [la Raison] doit se réaliser par le particulier [la passion]« (Hegel, La Raison dans l'histoire, 10/18, p. 108).
It y a d'une part le concept de justice, de ce qui est conforme au droit, le principe de la reconnaissance réciproque de citoyens se considérant mutuellement comme des personnes libres.
Il y a d'autre part la réalisation de ce concept, son effectuation dans la réalité.
Et si la raison peut bien concevoir le droit, elle est impuissante à le faire advenir dans la réalité, à faire en sorte que ce que je comprends par ma raison vienne étreindre et façonner le monde.
A cet égard la «raison pure« est impuissante, elle culmine dans un tragique «sollen« (devoir) qui reste éternellement à distance de la réalité effective, de l'effectivité (die Wirklichkeit).
Sans craindre de se salir les mains, la raison doit donc emprunter à ce qui domine l'histoire humaine les moyens de sa propre réalisation, faute de quoi elle restera à jamais aspiration impuissante et voeu pieux.
Quelque exemple que l'on prenne dans l'histoire (César, Napoléon ou encore tes hommes participant à la Révolution française), on aura beau jeu de montrer que chacun d'eux est profondément mû par des passions personnelles : ambition, gloire, désir de conquête, volonté de renverser un ordre injuste, de se trouver mieux loti, etc.
Mais les résultats, les conséquences de ces actions vont bien au-delà des passions qui agitent les acteurs, et des buts qu'ils pouvaient se représenter consciemment.
C'est donc commettre une profonde erreur que de prétendre disqualifier les passions humaines comme indignes du but visé, qui n'est autre que l'avènement de la liberté humaine en ce monde.
La raison seule serait impuissante, il ne peut suffire de convaincre intellectuellement les hommes, encore faut-il leur faire partager notre passion : c'est ce que savent si bien faire les «grands hommes«, ceux en qui s'incarnent l'esprit et les nécessités du temps (cf. «Passion et histoire«, p. 196).
Ce n'est donc que de manière partiellement aveugle que les hommes sont amenés à prendre part à l'histoire qu'ils vivent et qu'ils font : la passion est le nom de cet aveuglement.
«On peut appeler ruse de la raison le fait qu'elle fasse agir la passion pour son propre compte« (Hegel).
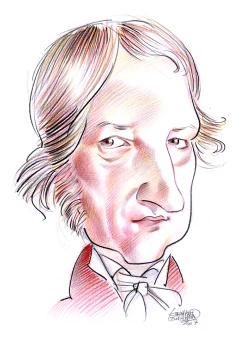
«
Philosophie de la passion
on va se servir pour mieux le contourner, ou plutôt, pour parvenir à
ses
fins non pas en dépit, mais à l'aide de cet obstacle.
L'idée de ruse est donc incompatible avec la notion de la toute-puis
sance divine,
et renvoie au contraire à la notion d' « organe-obstacle » :
l'un des pôles de la relation apparaît en effet comme un obstacle à la
réalisation de l'autre, mais il en est aussi bien le moyen et la condition.
C'est
ainsi que, chez Bergson par exemple, la matière est «l'organe
obstacle » de la poussée de l'élan vital vers l'apparition de la vie et de
la conscience (cf.
Bergson, Œuvres, PUF, éditions du Centenaire, p.
575) ;
chez
Marx en revanche, le développement du capitalisme travaille para
doxalement
et secrètement à la formation du prolétariat et par consé
quent aux moyens de sa propre destruction
(on est donc là plus proche
de ce que seront
les « contre-finalités » chez Sartre : le capitalisme,
loin de travailler à sa propre réalisation, travaille à son insu et de
manière inexorable à
sa propre perte).
L'idée de ruse comporte ainsi
trois moments: opposition, conjonction ou instrumentation, illusion ou
aveuglement.
Apparition de l'opposition raison/passion
Dans l'œuvre de Platon, la question de la passion est prédéterminée
par
le fait qu'elle vient s'inscrire dans le cadre d'une problématique
plus large : celle de l'opposition entre les parties rationnelle et irration
nelle de
l'âme humaine.
La passion se trouve naturellement reléguée
du côté de la part irrationnelle de l'âme, celle qui ne doit pas dominer,
mais
au contraire être tenue en respect par le pôle rationnel.
Nietzsche
verra dans cette défiance envers
les passions, perçues comme tyran
niques parce que sans mesure
ni limite, l'acte de naissance de la raison
platonicienne.
Voyant dans
les passions autant de tyrans potentiels,
Socrate est acculé à inventer
la raison pour dresser devant les passions
le mur d'un « contre-tyran » plus puissant qu'elles toutes: la raison
humaine, que
la philosophie a pour objet de faire prévaloir (Nietzsche,
Le Crépuscule des idoles, « Le problème de Socrate », § 9).
Toutefois,
dans l'œuvre de
Platon (La République notamment), la raison ne par
viendra à imposer dans l'âme humaine son règne sur
les passions que
par l'entremise d'un tiers, d'un troisième terme
(le thumos, c'est-à-dire
le « cœur », le courage, la force de caractère).
Toute
la morale stoïcienne consistera en un même pari sur la part
rationnelle de l'homme,
les passions ne consistant qu'en une impuis
sance à comprendre
le monde qui nous entoure pour nous y insérer et
y trouver notre place, ce qui est le fait du sage.
La passion n'est
qu'impuissance dans l'exacte mesure
où elle est incapacité à saisir et
à accepter le réel tel qu'il est.
Le sage n'a d'autre objectif que de former,
« tremper » son caractère pour dominer toujours mieux ses passions,
thématique que l'on retrouvera, dans
le Traité des passions de l'âme
- 91 -.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Peut-on dire avec Hegel que le travail est une ruse de la raison contre la nature ?
- PODCAST: "Rien de grand dans le monde ne s'est accompli sans passion" HEGEL, La Raison dans l'Histoire.
- « Rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion. » Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), La Raison dans l'Histoire
- On peut appeler ruse de la Raison le fait que celle-ci laisse agir à sa place les passions, en sorte que c'est seulement le moyen par lequel elle parvient à l'existence qui éprouve des pertes et subit des dommages. Hegel, La Raison dans l'histoire, 10/18, p.129. Commentez cette citation.
- « Rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion. » Hegel, La Raison dans l'histoire, 1837 (posth.). Commentez cette citation.