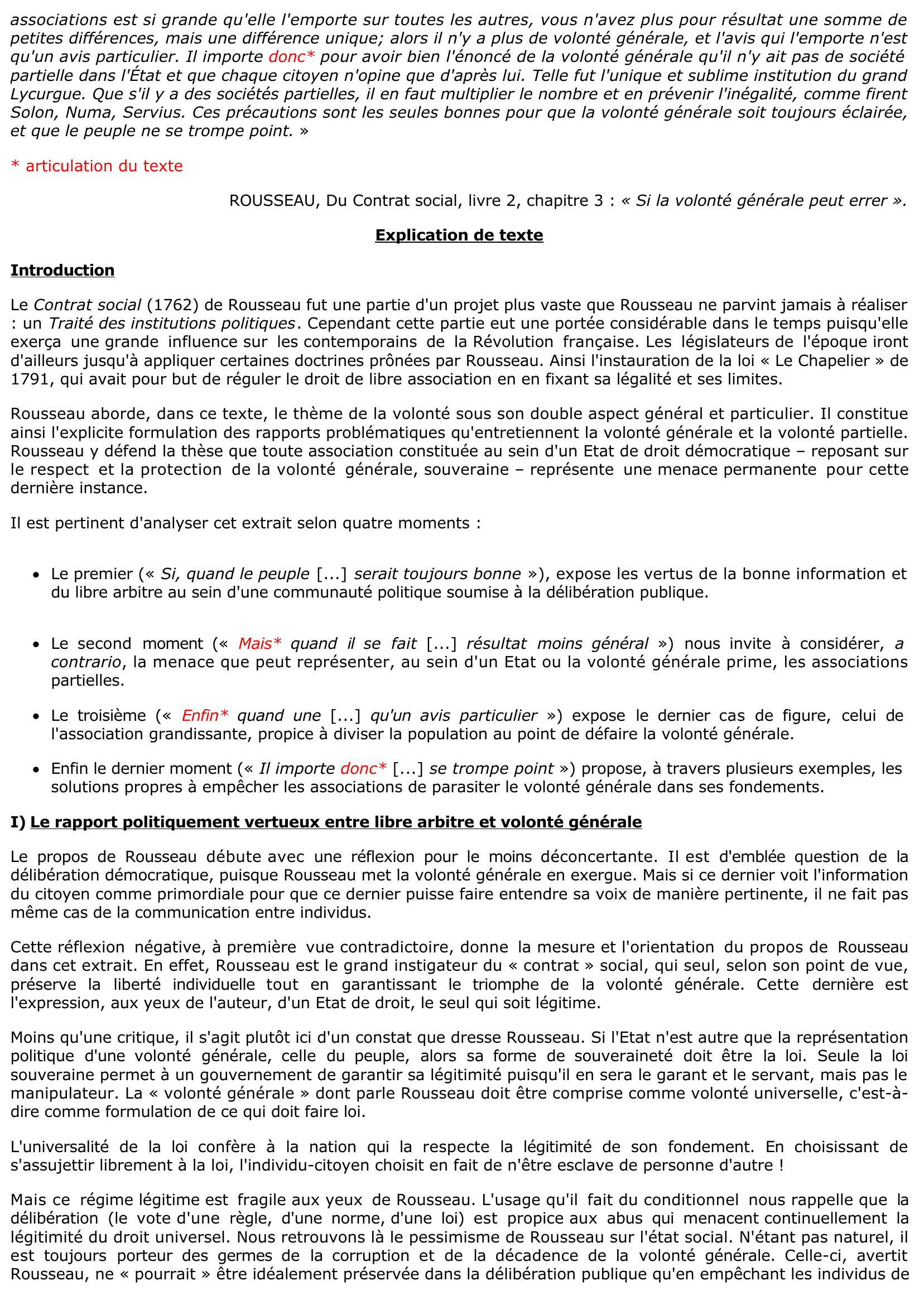Rousseau et le citoyen
Publié le 27/02/2008
Extrait du document

ANALYSE FORMELLE DU TEXTE « Si, quand le peuple suffisamment informé délibère, les citoyens n'avaient aucune communication entre eux, ... Mais quand il se fait des brigues...; on peut dire alors qu'il n'y a plus autant de votants que d'hommes, mais seulement autant que d'associations... Enfin quand... vous n'avez plus pour résultat une somme de petites différences, mais une différence unique; alors il n'y a plus de volonté générale... Il importe donc pour avoir... qu'il n'y ait pas de société partielle dans l'État et que chaque citoyen... Que s'il y a des sociétés partielles, il en faut multiplier le nombre et en prévenir l'inégalité... « QUESTIONNEMENT INDICATIF • A quelle(s) condition(s) nécessaire(s) (et suffisante(s) ?) résulterait-il toujours de la délibération « la volonté générale « selon Rousseau ? • Qu'est-ce qui, selon Rousseau, peut empêcher que ne résulte de la délibération la volonté générale ? • Quelles relations pouvez-vous établir entre « petites différences «, « différence unique «, « volonté générale «, « avis particulier «, « associations partielles «? • Est-ce que, selon Rousseau, s'il y a des sociétés partielles, il ne sera pas issu fatalement de la délibération la volonté générale ? • Pourquoi, s'il y a des sociétés partielles, faut-il « en multiplier le nombre « et « en prévenir l'inégalité «? • Qu'est-ce qui est en jeu dans ce texte ?

«
associations est si grande qu'elle l'emporte sur toutes les autres, vous n'avez plus pour résultat une somme depetites différences, mais une différence unique; alors il n'y a plus de volonté générale, et l'avis qui l'emporte n'estqu'un avis particulier.
Il importe donc* pour avoir bien l'énoncé de la volonté générale qu'il n'y ait pas de société partielle dans l'État et que chaque citoyen n'opine que d'après lui.
Telle fut l'unique et sublime institution du grandLycurgue.
Que s'il y a des sociétés partielles, il en faut multiplier le nombre et en prévenir l'inégalité, comme firentSolon, Numa, Servius.
Ces précautions sont les seules bonnes pour que la volonté générale soit toujours éclairée,et que le peuple ne se trompe point. »
* articulation du texte
ROUSSEAU, Du Contrat social, livre 2, chapitre 3 : « Si la volonté générale peut errer ».
Explication de texte
Introduction
Le Contrat social (1762) de Rousseau fut une partie d'un projet plus vaste que Rousseau ne parvint jamais à réaliser : un Traité des institutions politiques .
Cependant cette partie eut une portée considérable dans le temps puisqu'elle exerça une grande influence sur les contemporains de la Révolution française.
Les législateurs de l'époque irontd'ailleurs jusqu'à appliquer certaines doctrines prônées par Rousseau.
Ainsi l'instauration de la loi « Le Chapelier » de1791, qui avait pour but de réguler le droit de libre association en en fixant sa légalité et ses limites.
Rousseau aborde, dans ce texte, le thème de la volonté sous son double aspect général et particulier.
Il constitueainsi l'explicite formulation des rapports problématiques qu'entretiennent la volonté générale et la volonté partielle.Rousseau y défend la thèse que toute association constituée au sein d'un Etat de droit démocratique – reposant surle respect et la protection de la volonté générale, souveraine – représente une menace permanente pour cettedernière instance.
Il est pertinent d'analyser cet extrait selon quatre moments :
Le premier (« Si, quand le peuple [...] serait toujours bonne »), expose les vertus de la bonne information et du libre arbitre au sein d'une communauté politique soumise à la délibération publique.
Le second moment (« Mais* quand il se fait [...] résultat moins général ») nous invite à considérer, a contrario , la menace que peut représenter, au sein d'un Etat ou la volonté générale prime, les associations partielles.
Le troisième (« Enfin* quand une [...] qu'un avis particulier ») expose le dernier cas de figure, celui de l'association grandissante, propice à diviser la population au point de défaire la volonté générale.
Enfin le dernier moment (« Il importe donc* [...] se trompe point ») propose, à travers plusieurs exemples, les solutions propres à empêcher les associations de parasiter le volonté générale dans ses fondements.
I) Le rapport politiquement vertueux entre libre arbitre et volonté générale
Le propos de Rousseau débute avec une réflexion pour le moins déconcertante.
Il est d'emblée question de ladélibération démocratique, puisque Rousseau met la volonté générale en exergue.
Mais si ce dernier voit l'informationdu citoyen comme primordiale pour que ce dernier puisse faire entendre sa voix de manière pertinente, il ne fait pasmême cas de la communication entre individus.
Cette réflexion négative, à première vue contradictoire, donne la mesure et l'orientation du propos de Rousseaudans cet extrait.
En effet, Rousseau est le grand instigateur du « contrat » social, qui seul, selon son point de vue,préserve la liberté individuelle tout en garantissant le triomphe de la volonté générale.
Cette dernière estl'expression, aux yeux de l'auteur, d'un Etat de droit, le seul qui soit légitime.
Moins qu'une critique, il s'agit plutôt ici d'un constat que dresse Rousseau.
Si l'Etat n'est autre que la représentationpolitique d'une volonté générale, celle du peuple, alors sa forme de souveraineté doit être la loi.
Seule la loisouveraine permet à un gouvernement de garantir sa légitimité puisqu'il en sera le garant et le servant, mais pas lemanipulateur.
La « volonté générale » dont parle Rousseau doit être comprise comme volonté universelle, c'est-à-dire comme formulation de ce qui doit faire loi.
L'universalité de la loi confère à la nation qui la respecte la légitimité de son fondement.
En choisissant des'assujettir librement à la loi, l'individu-citoyen choisit en fait de n'être esclave de personne d'autre !
Mais ce régime légitime est fragile aux yeux de Rousseau.
L'usage qu'il fait du conditionnel nous rappelle que ladélibération (le vote d'une règle, d'une norme, d'une loi) est propice aux abus qui menacent continuellement lalégitimité du droit universel.
Nous retrouvons là le pessimisme de Rousseau sur l'état social.
N'étant pas naturel, ilest toujours porteur des germes de la corruption et de la décadence de la volonté générale.
Celle-ci, avertitRousseau, ne « pourrait » être idéalement préservée dans la délibération publique qu'en empêchant les individus de.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- J.-J. Rousseau, Citoyen du Pays des Chimères
- Que pensez-vous de cette opinion sur l’oisiveté : « Hors de la société, l'homme isolé, ne devant rien à personne, a le droit de vivre comme il lui plaît ; mais dans la société, où il vit nécessairement aux dépens des autres, il leur doit en travail le prix de son entretien ; cela est sans exception. Travailler est donc un devoir indispensable à l’homme social. Riche ou pauvre, puissant ou faible, tout citoyen oisif est un fripon » (J.-J. Rousseau) ?
- Si j'étais chef de quelqu'un des peuples de la Nigritie, je déclare que je ferais élever sur la frontière du pays une potence où je ferais pendre sans rémission le premier Européen qui oserait y pénétrer, et le premier Citoyen qui tenterait d'en sortir. Jean-Jacques Rousseau
- Ces deux mots patrie et citoyen doivent être effacés des langues modernes. Emile ou De l'éducation (1762) Rousseau, Jean-Jacques. Commentez cette citation.
- « Le citoyen toujours actif sue, s'agite, se tourmente sans cesse pour chercher des occupations encore plus laborieuses : il travaille jusqu'à la mort, il y court même pour se mettre en état de vivre, ou renonce à la vie pour acquérir l'immortalité. » Rousseau, Sur l'origine de l'inégalité, 1755. Commentez cette citation.