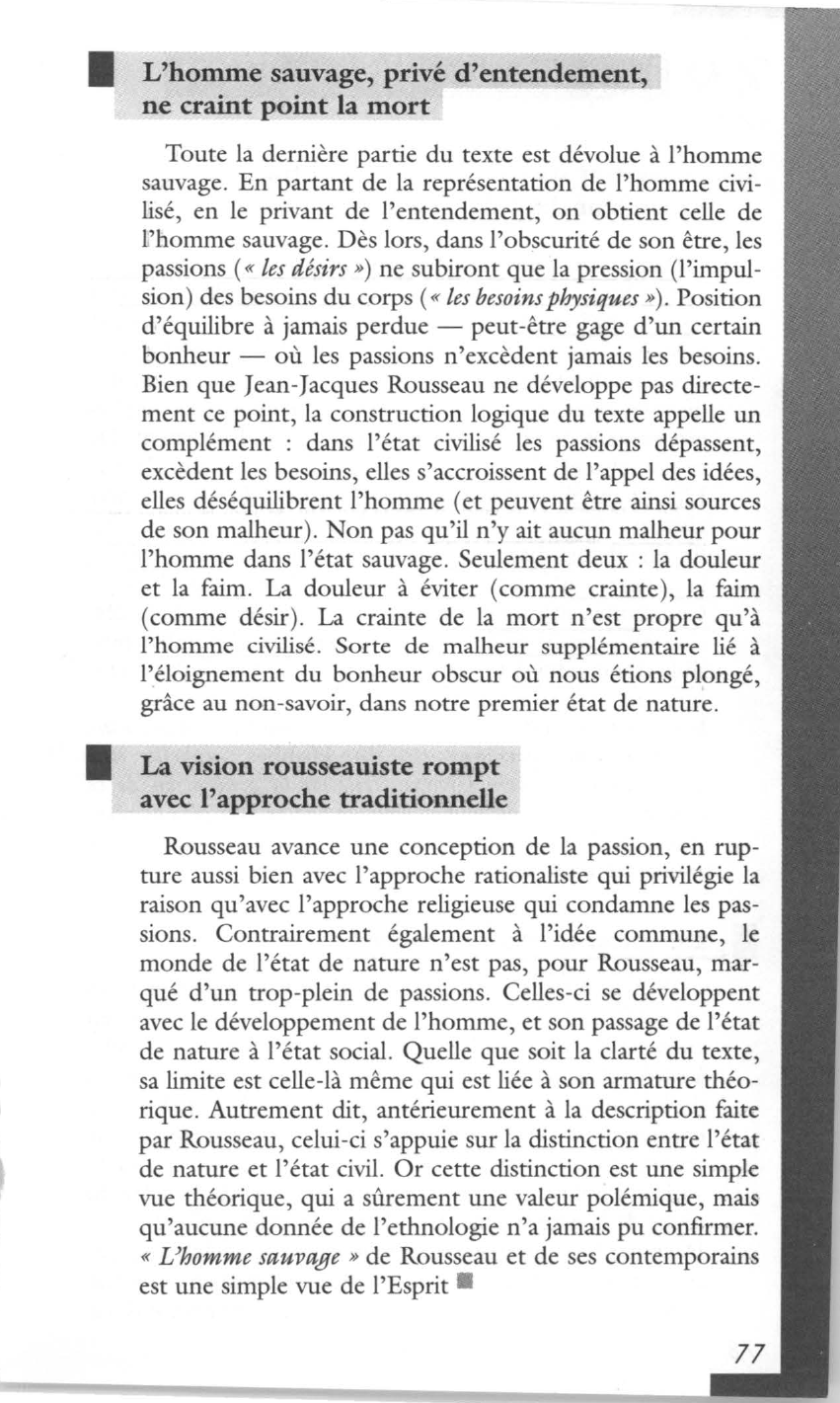Quoi qu'en disent les moralistes, l'entendement humain doit beaucoup
Publié le 19/03/2014

Extrait du document
« Quoi qu'en disent les moralistes, l'entendement humain doit beaucoup aux passions, qui, d'un commun aveu, lui doivent beau-coup aussi. C'est par leur activité que notre raison se perfectionne ; nous ne cherchons à connaître que parce que nous désirons jouir ; et il n'est pas possible de concevoir pourquoi celui qui n'aurait ni désirs ni craintes se donnerait la peine de raisonner. Les passions à leur tour tirent leur origine de nos besoins et leur progrès de nos connaissances. Car on ne peut désirer ou craindre les choses que sur les idées qu'on en peut avoir, ou par la simple impulsion de la nature ; et l'homme sauvage, privé de toute sorte de lumière, n'éprouve que les passions de cette dernière espèce. Ses désirs ne passent point ses besoins physiques ; les seuls maux qu'il craigne sont la douleur et la faim. Je dis la douleur, et non la mort; car jamais l'animal ne saura ce que c'est que mourir; et la connaissance de la mort et de ses terreurs est une des premières acquisitions que l'homme ait faites en s'éloignant de la condition animale. « Rousseau, Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes (1755).
L'entendement dépend de l'activité des passions
Rousseau affirme, contre la position traditionnelle des moralistes, l'influence des passions sur l'entendement. Les passions sont actives, contrairement à une vision répandue selon laquelle pâtir signifie souffrir. Le perfectionnement de la raison dépend de l'activité des passions. La connaissance est impuissante à s'orienter sans le désir. Supprimons en
«
1
1
1
1 L'homme sauvage, privé d'entendement,
ne craint point la mort
1
Toute la dernière partie du texte est dévolue à l'homme
sauvage.
En partant de la représentation de l 'homme civi
lisé, en
le privant de l'entendement, on obtient celle de
L'homme sauvage.
Dès lors, dans l'obscurité de son être,
les
passions («les désirs ») ne subiront que la pression (l'impul
sion) des besoins
du corps («les besoins physiques »).
Position
d'équilibre à jamais perdue -peut-être gage
d'un certain
bonheur -
où les passions n'excèdent jamais les besoins .
Bien que Jean-Jacques Rousseau ne développe pas directe
ment ce point, la construction logique du texte appelle un
complément : dans l'état civilisé les passions dépassent,
excèdent les besoins, elles s'accroissent de l'appel des idées,
elles déséquilibrent
l'homme (et peuvent être ainsi sources
de son malheur).
Non pas qu'il n'y ait aucun malheur pour
l'homme dans l'état sauvage.
Seulement deux : la douleur
et la faim.
La douleur à éviter (comme crainte), la faim
(comme désir
).
La crainte de la mort n'est propre qu'à
l'homme civilisé.
Sorte de malheur supplémentaire lié à
l'éloignement du
bonheur obscur où nous étions plongé,
grâce au non-savoir, dans notre premier état de nature.
La vision rousseauiste rompt
avec l'approche traditionnelle
Rousseau avance une conception de la passion, en rup
ture aussi bien avec l'approche rationaliste qui privilégie
la
raison qu'avec l'approche religieuse qui condamne les pas
sions.
Contrairement également à l'idée commune,
le
monde de l'état de nature n'est pas, pour Rousseau, mar
qué
d'un trop-plein de passions.
Celles-ci se développent
avec
le développement de l'homme, et son passage de l'état
de nature à l'état social.
Quelle que soit
la clarté du texte,
sa limite est celle-là même qui est liée à son armature théo
rique.
Autrement dit, antérieurement à
la description faite
par Rousseau, celui-ci s'appuie sur la distinction entre l'état
de nature et l'état civil.
Or cette distinction est une simple
vue théorique, qui a sûrement une valeur polémique, mais
qu'aucune donnée de l'ethnologie
n'a jamais pu confirmer.
« L'homme sauvage » de Rou sseau et de ses contemporains
est une simple vue de !'Esprit
•.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- « Quoi qu'en disent les moralistes, l'entendement humain doit beaucoup aux passions, qui, d'un commun aveu, lui doivent beaucoup aussi. C'est par leur activité que notre raison se perfectionne; nous ne cherchons à connaître que parce que nous désirons de jouir. » Rousseau, Sur l'origine de l'inégalité, 1755. Commentez cette citation.
- Commentaire de texte Locke: chapitre 18, du livre 4 des Essais sur l'entendement humain
- ESSAI SUR L’ENTENDEMENT HUMAIN, John Locke
- ESSAI PHILOSOPHIQUE CONCERNANT L'ENTENDEMENT HUMAIN John Locke (résumé)
- commentaire Hume "l'entendement humain"