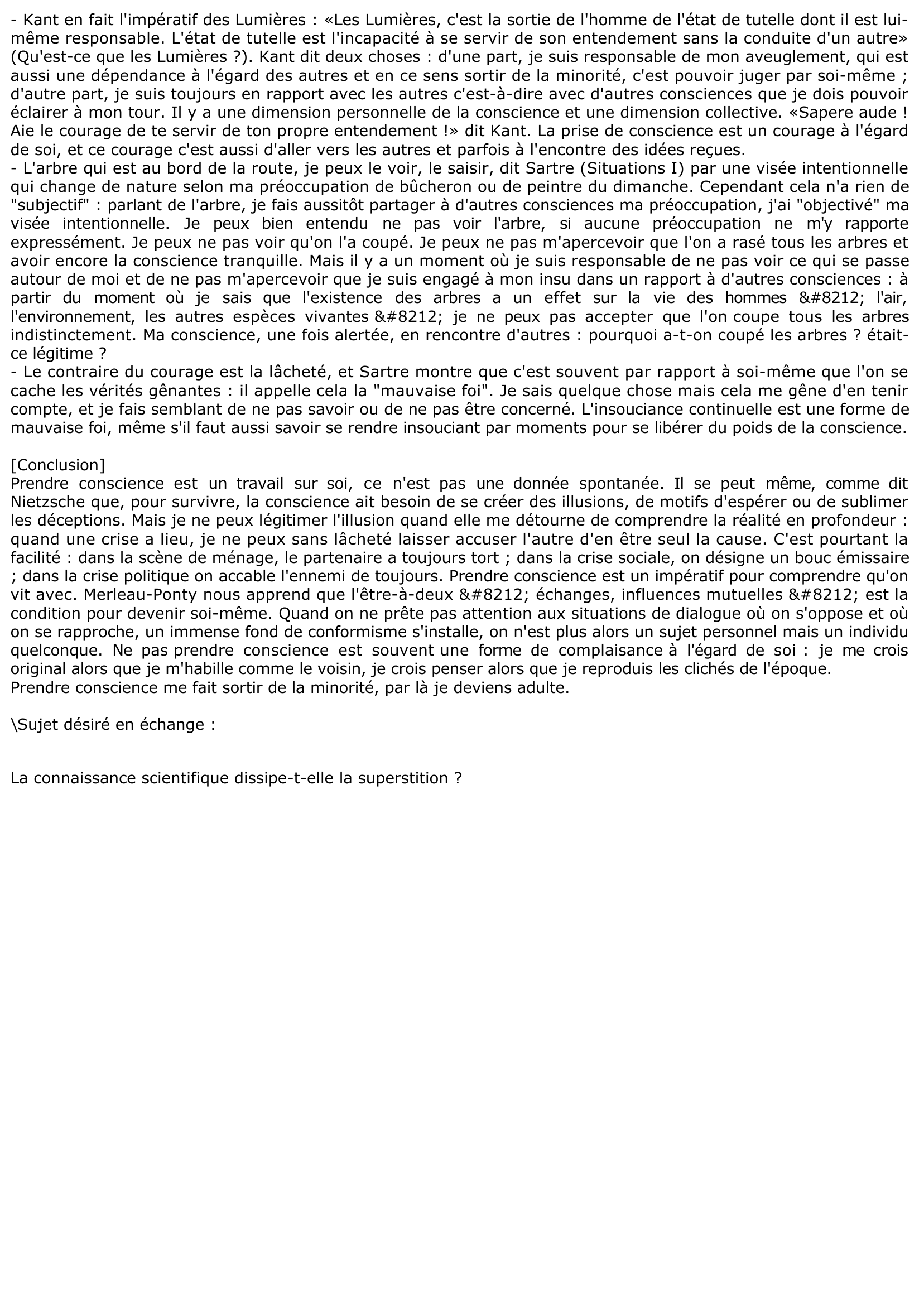Qu'est-ce qu'une prise de conscience ?
Publié le 03/03/2011
Extrait du document

*** On prend soudain conscience qu'on est amoureux de la femme que l'on fréquentait de plus en plus assidûment, comme Swann à l'égard d'Odette (Proust); on prend conscience qu'on est un meurtrier, comme Macbeth (Shakespeare), on prend conscience qu'on a été trahi par sa femme, comme Charles Bovary (Flaubert) : prendre conscience c'est l'acte par lequel on fait la vérité sur soi-même et ce qui nous entoure, en bouleversant nos habitudes, nos manières d'être, de façon irréversible. Il y a un avant et un après la prise de conscience. Il semble que dans la prise de conscience on soit agi par les autres ou par les circonstances. Mais n'y a-t-il pas de prise de conscience sans une longue préparation à ce moment où la vérité nous submerge ? La prise de conscience n'est soudaine que parce qu'on reculait le moment de remettre en question tout ce qui faisait notre confort. On se demandera quelles sont les conditions qui préparent toute prise de conscience, et si les autres qui nous entourent ou nous environnent n'y participent pas de façon active.

«
- Kant en fait l'impératif des Lumières : «Les Lumières, c'est la sortie de l'homme de l'état de tutelle dont il est lui-même responsable.
L'état de tutelle est l'incapacité à se servir de son entendement sans la conduite d'un autre»(Qu'est-ce que les Lumières ?).
Kant dit deux choses : d'une part, je suis responsable de mon aveuglement, qui estaussi une dépendance à l'égard des autres et en ce sens sortir de la minorité, c'est pouvoir juger par soi-même ;d'autre part, je suis toujours en rapport avec les autres c'est-à-dire avec d'autres consciences que je dois pouvoiréclairer à mon tour.
Il y a une dimension personnelle de la conscience et une dimension collective.
«Sapere aude !Aie le courage de te servir de ton propre entendement !» dit Kant.
La prise de conscience est un courage à l'égardde soi, et ce courage c'est aussi d'aller vers les autres et parfois à l'encontre des idées reçues.- L'arbre qui est au bord de la route, je peux le voir, le saisir, dit Sartre (Situations I) par une visée intentionnellequi change de nature selon ma préoccupation de bûcheron ou de peintre du dimanche.
Cependant cela n'a rien de"subjectif" : parlant de l'arbre, je fais aussitôt partager à d'autres consciences ma préoccupation, j'ai "objectivé" mavisée intentionnelle.
Je peux bien entendu ne pas voir l'arbre, si aucune préoccupation ne m'y rapporteexpressément.
Je peux ne pas voir qu'on l'a coupé.
Je peux ne pas m'apercevoir que l'on a rasé tous les arbres etavoir encore la conscience tranquille.
Mais il y a un moment où je suis responsable de ne pas voir ce qui se passeautour de moi et de ne pas m'apercevoir que je suis engagé à mon insu dans un rapport à d'autres consciences : àpartir du moment où je sais que l'existence des arbres a un effet sur la vie des hommes — l'air,l'environnement, les autres espèces vivantes — je ne peux pas accepter que l'on coupe tous les arbresindistinctement.
Ma conscience, une fois alertée, en rencontre d'autres : pourquoi a-t-on coupé les arbres ? était-ce légitime ?- Le contraire du courage est la lâcheté, et Sartre montre que c'est souvent par rapport à soi-même que l'on secache les vérités gênantes : il appelle cela la "mauvaise foi".
Je sais quelque chose mais cela me gêne d'en tenircompte, et je fais semblant de ne pas savoir ou de ne pas être concerné.
L'insouciance continuelle est une forme demauvaise foi, même s'il faut aussi savoir se rendre insouciant par moments pour se libérer du poids de la conscience.
[Conclusion]Prendre conscience est un travail sur soi, ce n'est pas une donnée spontanée.
Il se peut même, comme ditNietzsche que, pour survivre, la conscience ait besoin de se créer des illusions, de motifs d'espérer ou de sublimerles déceptions.
Mais je ne peux légitimer l'illusion quand elle me détourne de comprendre la réalité en profondeur :quand une crise a lieu, je ne peux sans lâcheté laisser accuser l'autre d'en être seul la cause.
C'est pourtant lafacilité : dans la scène de ménage, le partenaire a toujours tort ; dans la crise sociale, on désigne un bouc émissaire; dans la crise politique on accable l'ennemi de toujours.
Prendre conscience est un impératif pour comprendre qu'onvit avec.
Merleau-Ponty nous apprend que l'être-à-deux — échanges, influences mutuelles — est lacondition pour devenir soi-même.
Quand on ne prête pas attention aux situations de dialogue où on s'oppose et oùon se rapproche, un immense fond de conformisme s'installe, on n'est plus alors un sujet personnel mais un individuquelconque.
Ne pas prendre conscience est souvent une forme de complaisance à l'égard de soi : je me croisoriginal alors que je m'habille comme le voisin, je crois penser alors que je reproduis les clichés de l'époque.Prendre conscience me fait sortir de la minorité, par là je deviens adulte.
\Sujet désiré en échange :
La connaissance scientifique dissipe-t-elle la superstition ?.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- LE TRAVAIL PERMET-IL LA PRISE DE CONSCIENCE DE SOI ?
- introduction : la prise de conscience est elle libératrice ?
- Sujet : Toute prise de conscience est- elle libératrice ?
- Prise de conscience et libération
- Dans quelles conditions la conscience peut-elle agir en temps qu'entrave à la prise de conscience?