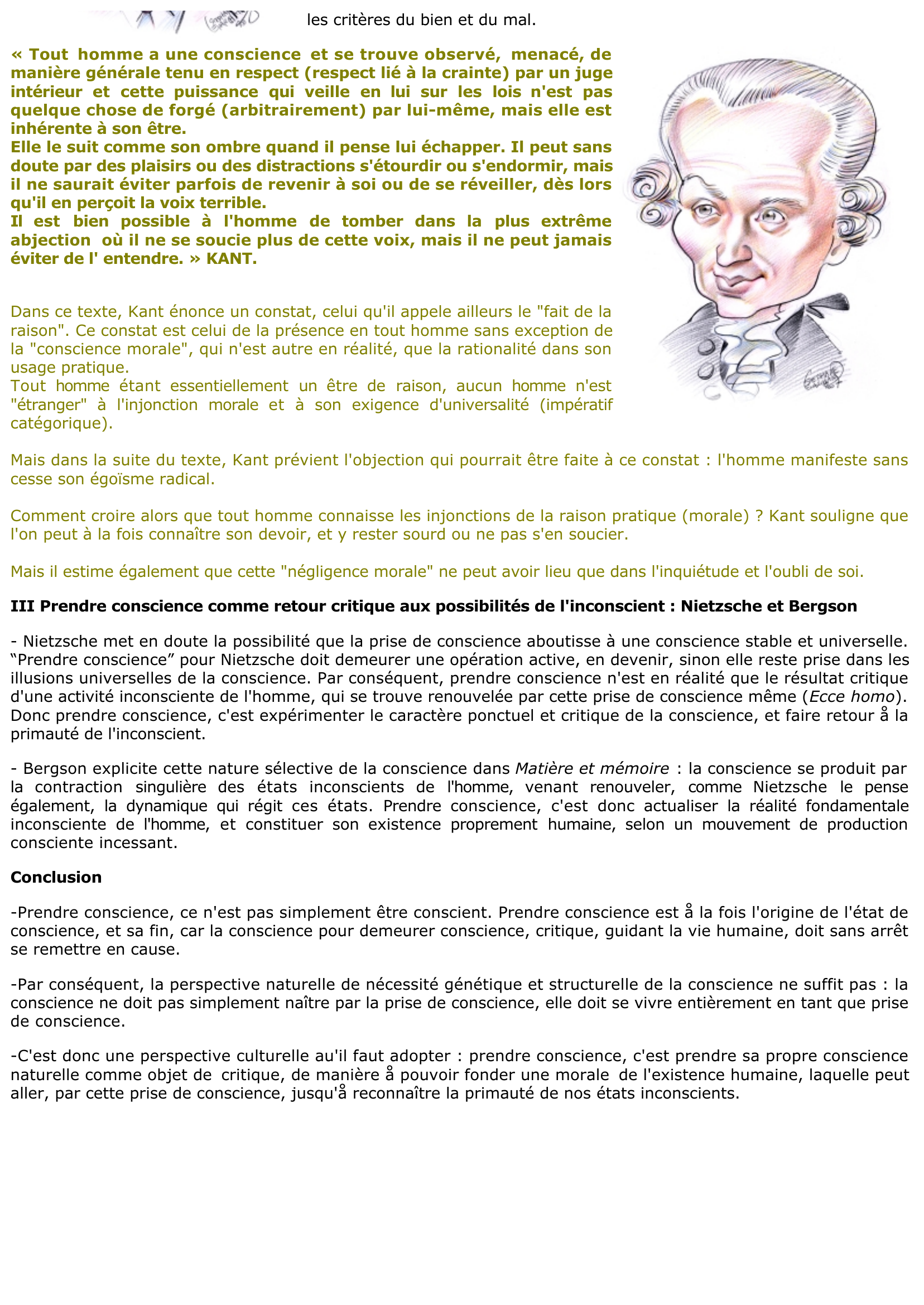Qu'est-ce que prendre conscience ?
Publié le 19/02/2005
Extrait du document


«
- Merleau-Ponty va définir la prise de conscience comme optimisation de
les critères du bien et du mal.
« Tout homme a une conscience et se trouve observé, menacé, demanière générale tenu en respect (respect lié à la crainte) par un jugeintérieur et cette puissance qui veille en lui sur les lois n'est pasquelque chose de forgé (arbitrairement) par lui-même, mais elle estinhérente à son être.Elle le suit comme son ombre quand il pense lui échapper.
Il peut sansdoute par des plaisirs ou des distractions s'étourdir ou s'endormir, maisil ne saurait éviter parfois de revenir à soi ou de se réveiller, dès lorsqu'il en perçoit la voix terrible.Il est bien possible à l'homme de tomber dans la plus extrêmeabjection où il ne se soucie plus de cette voix, mais il ne peut jamaiséviter de l' entendre.
» KANT.
Dans ce texte, Kant énonce un constat, celui qu'il appele ailleurs le "fait de laraison".
Ce constat est celui de la présence en tout homme sans exception dela "conscience morale", qui n'est autre en réalité, que la rationalité dans sonusage pratique.Tout homme étant essentiellement un être de raison, aucun homme n'est"étranger" à l'injonction morale et à son exigence d'universalité (impératifcatégorique).
Mais dans la suite du texte, Kant prévient l'objection qui pourrait être faite à ce constat : l'homme manifeste sanscesse son égoïsme radical.
Comment croire alors que tout homme connaisse les injonctions de la raison pratique (morale) ? Kant souligne quel'on peut à la fois connaître son devoir, et y rester sourd ou ne pas s'en soucier.
Mais il estime également que cette "négligence morale" ne peut avoir lieu que dans l'inquiétude et l'oubli de soi.
III Prendre conscience comme retour critique aux possibilités de l'inconscient : Nietzsche et Bergson
- Nietzsche met en doute la possibilité que la prise de conscience aboutisse à une conscience stable et universelle.“Prendre conscience” pour Nietzsche doit demeurer une opération active, en devenir, sinon elle reste prise dans lesillusions universelles de la conscience.
Par conséquent, prendre conscience n'est en réalité que le résultat critiqued'une activité inconsciente de l'homme, qui se trouve renouvelée par cette prise de conscience même ( Ecce homo ). Donc prendre conscience, c'est expérimenter le caractère ponctuel et critique de la conscience, et faire retour å laprimauté de l'inconscient.
- Bergson explicite cette nature sélective de la conscience dans Matière et mémoire : la conscience se produit par la contraction singulière des états inconscients de l'homme, venant renouveler, comme Nietzsche le penseégalement, la dynamique qui régit ces états.
Prendre conscience, c'est donc actualiser la réalité fondamentaleinconsciente de l'homme, et constituer son existence proprement humaine, selon un mouvement de productionconsciente incessant.
Conclusion
-Prendre conscience, ce n'est pas simplement être conscient.
Prendre conscience est å la fois l'origine de l'état deconscience, et sa fin, car la conscience pour demeurer conscience, critique, guidant la vie humaine, doit sans arrêtse remettre en cause.
-Par conséquent, la perspective naturelle de nécessité génétique et structurelle de la conscience ne suffit pas : laconscience ne doit pas simplement naître par la prise de conscience, elle doit se vivre entièrement en tant que prisede conscience.
-C'est donc une perspective culturelle au'il faut adopter : prendre conscience, c'est prendre sa propre consciencenaturelle comme objet de critique, de manière å pouvoir fonder une morale de l'existence humaine, laquelle peutaller, par cette prise de conscience, jusqu'å reconnaître la primauté de nos états inconscients..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- prendre conscience de soi nous change t-il en un autre ?
- Prendre conscience de soi
- Qu'est ce que prendre conscience ?
- Suffit-il de prendre conscience de ce qui nous détermine pour nous en libérer ?
- Faut-il changer pour prendre conscience de soi ?