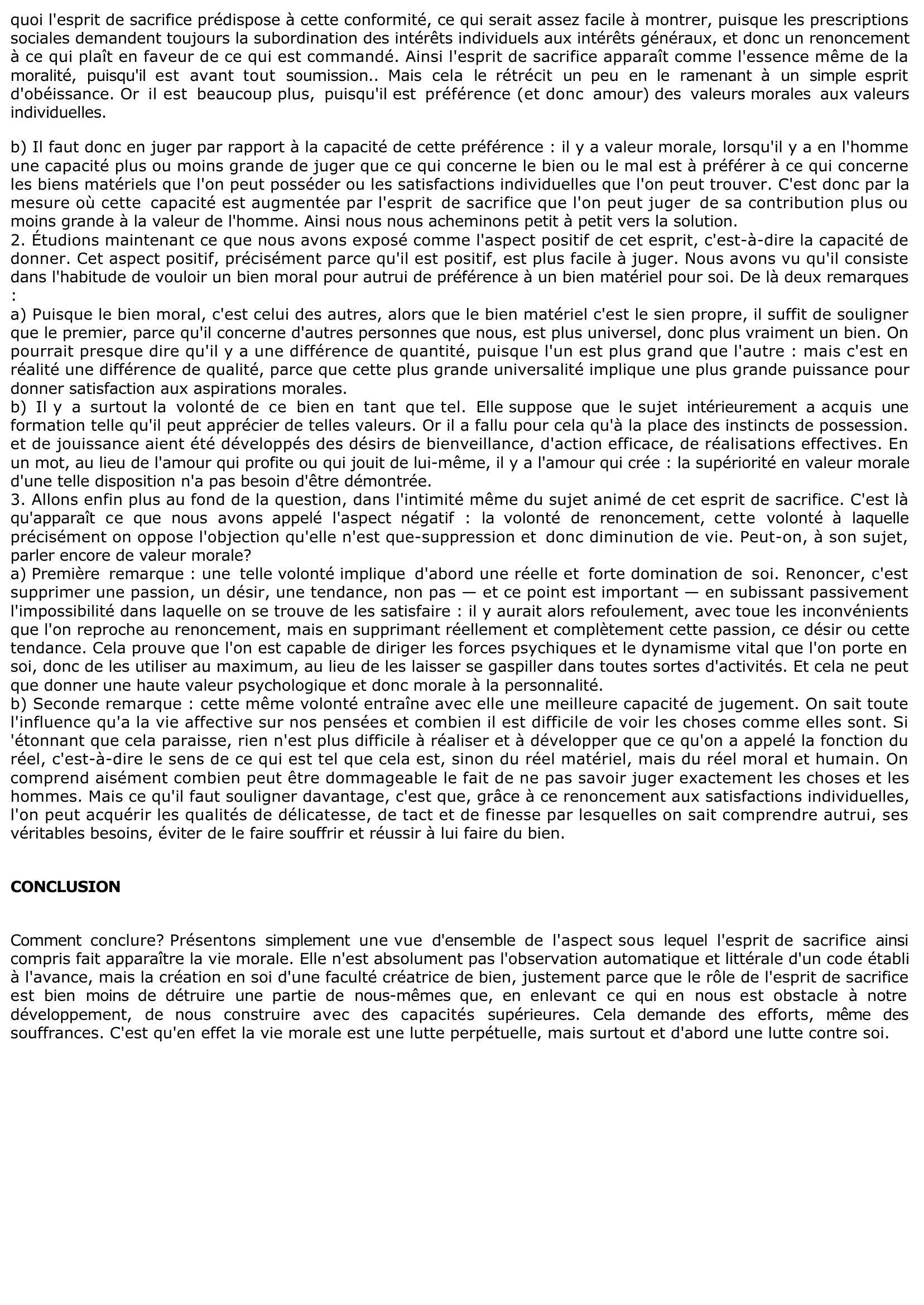Quelle est la valeur de l'esprit de sacrifice dans la vie morale ?
Publié le 20/02/2011
Extrait du document


«
quoi l'esprit de sacrifice prédispose à cette conformité, ce qui serait assez facile à montrer, puisque les prescriptionssociales demandent toujours la subordination des intérêts individuels aux intérêts généraux, et donc un renoncementà ce qui plaît en faveur de ce qui est commandé.
Ainsi l'esprit de sacrifice apparaît comme l'essence même de lamoralité, puisqu'il est avant tout soumission..
Mais cela le rétrécit un peu en le ramenant à un simple espritd'obéissance.
Or il est beaucoup plus, puisqu'il est préférence (et donc amour) des valeurs morales aux valeursindividuelles.
b) Il faut donc en juger par rapport à la capacité de cette préférence : il y a valeur morale, lorsqu'il y a en l'hommeune capacité plus ou moins grande de juger que ce qui concerne le bien ou le mal est à préférer à ce qui concerneles biens matériels que l'on peut posséder ou les satisfactions individuelles que l'on peut trouver.
C'est donc par lamesure où cette capacité est augmentée par l'esprit de sacrifice que l'on peut juger de sa contribution plus oumoins grande à la valeur de l'homme.
Ainsi nous nous acheminons petit à petit vers la solution.2.
Étudions maintenant ce que nous avons exposé comme l'aspect positif de cet esprit, c'est-à-dire la capacité dedonner.
Cet aspect positif, précisément parce qu'il est positif, est plus facile à juger.
Nous avons vu qu'il consistedans l'habitude de vouloir un bien moral pour autrui de préférence à un bien matériel pour soi.
De là deux remarques:a) Puisque le bien moral, c'est celui des autres, alors que le bien matériel c'est le sien propre, il suffit de soulignerque le premier, parce qu'il concerne d'autres personnes que nous, est plus universel, donc plus vraiment un bien.
Onpourrait presque dire qu'il y a une différence de quantité, puisque l'un est plus grand que l'autre : mais c'est enréalité une différence de qualité, parce que cette plus grande universalité implique une plus grande puissance pourdonner satisfaction aux aspirations morales.b) Il y a surtout la volonté de ce bien en tant que tel.
Elle suppose que le sujet intérieurement a acquis uneformation telle qu'il peut apprécier de telles valeurs.
Or il a fallu pour cela qu'à la place des instincts de possession.et de jouissance aient été développés des désirs de bienveillance, d'action efficace, de réalisations effectives.
Enun mot, au lieu de l'amour qui profite ou qui jouit de lui-même, il y a l'amour qui crée : la supériorité en valeur moraled'une telle disposition n'a pas besoin d'être démontrée.3.
Allons enfin plus au fond de la question, dans l'intimité même du sujet animé de cet esprit de sacrifice.
C'est làqu'apparaît ce que nous avons appelé l'aspect négatif : la volonté de renoncement, cette volonté à laquelleprécisément on oppose l'objection qu'elle n'est que-suppression et donc diminution de vie.
Peut-on, à son sujet,parler encore de valeur morale?a) Première remarque : une telle volonté implique d'abord une réelle et forte domination de soi.
Renoncer, c'estsupprimer une passion, un désir, une tendance, non pas — et ce point est important — en subissant passivementl'impossibilité dans laquelle on se trouve de les satisfaire : il y aurait alors refoulement, avec toue les inconvénientsque l'on reproche au renoncement, mais en supprimant réellement et complètement cette passion, ce désir ou cettetendance.
Cela prouve que l'on est capable de diriger les forces psychiques et le dynamisme vital que l'on porte ensoi, donc de les utiliser au maximum, au lieu de les laisser se gaspiller dans toutes sortes d'activités.
Et cela ne peutque donner une haute valeur psychologique et donc morale à la personnalité.b) Seconde remarque : cette même volonté entraîne avec elle une meilleure capacité de jugement.
On sait toutel'influence qu'a la vie affective sur nos pensées et combien il est difficile de voir les choses comme elles sont.
Si'étonnant que cela paraisse, rien n'est plus difficile à réaliser et à développer que ce qu'on a appelé la fonction duréel, c'est-à-dire le sens de ce qui est tel que cela est, sinon du réel matériel, mais du réel moral et humain.
Oncomprend aisément combien peut être dommageable le fait de ne pas savoir juger exactement les choses et leshommes.
Mais ce qu'il faut souligner davantage, c'est que, grâce à ce renoncement aux satisfactions individuelles,l'on peut acquérir les qualités de délicatesse, de tact et de finesse par lesquelles on sait comprendre autrui, sesvéritables besoins, éviter de le faire souffrir et réussir à lui faire du bien.
CONCLUSION
Comment conclure? Présentons simplement une vue d'ensemble de l'aspect sous lequel l'esprit de sacrifice ainsicompris fait apparaître la vie morale.
Elle n'est absolument pas l'observation automatique et littérale d'un code établià l'avance, mais la création en soi d'une faculté créatrice de bien, justement parce que le rôle de l'esprit de sacrificeest bien moins de détruire une partie de nous-mêmes que, en enlevant ce qui en nous est obstacle à notredéveloppement, de nous construire avec des capacités supérieures.
Cela demande des efforts, même dessouffrances.
C'est qu'en effet la vie morale est une lutte perpétuelle, mais surtout et d'abord une lutte contre soi..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Madame de Staël écrit on 1800 dans De la Littérature (Première Partie, chap. 11 ) : « Ce que l'homme a fait de plus grand, il le doit au sentiment douloureux de l'incomplet de sa destinée. Les esprits médiocres sont, en général, assez satisfaits de la vie commune: ils arrondissent, pour ainsi dire, leur existence, et suppléent a ce qui peut leur manquer encore par les illusions de la vanité: mais le sublime de l'esprit, des sentiments et des actions doit son essor au besoin d'échapper
- LA MORALE ET LA VIE PERSONNELLE. LA VIE DU CORPS ET LA VIS DE L'ESPRIT. LA DIGNITÉ INDIVIDUELLE. RAPPORTS DE LA MORALITÉ PERSONNELLE ET DE LA VIE SOCIALE.
- Gabriel Rey écrit dans Humanisme et surhumanisme (1951): «Dire que la littérature classique est le fait d'une élite pour une élite est sans doute plus exact historiquement qu'en soi. Rien n'empêche de concevoir un classicisme de masse ; c'est une simple question d'éducation et de pensée régnante, de mode enfin. [...] Prétendre que le «peuple» - entité d'ailleurs plus mythique que réelle - est voué à jamais à sa vie intellectuelle et artistique actuelle, à la pensée (si l'on peut dire)
- Madame de Staël écrit en 1800 dans De la Littérature (Première Partie, chap.11) : «Ce que l'homme a fait de plus grand, il le doit au sentiment douloureux de l'incomplet de sa destinée. Les esprits médiocres sont, en général, assez satisfaits de la vie commune ; ils arrondissent, pour ainsi dire, leur existence, et suppléent à ce qui peut leur manquer encore par les illusions de la vanité ; mais le sublime de l'esprit, des sentiments et des actions doit son essor au besoin d'échapper a
- NATHAN LE SAGE : Dans la scène 7 de l'acte III, le personnage principal Nathan est opposé au sultan Saladin qui le convoque à prouver sa sagesse. Ainsi, il lui demande ce qu'est la vraie religion, espérant que celui restera fidèle au judaïsme. En revanche, Nathan, par crainte de décevoir ce despote qui a le droit de vie et de mort sur tous, lui répond par un récit à visée morale afin d'éclairer son esprit. Comment Lessing s'y prend-t-il donc pour lui affliger une leçon de morale tout e