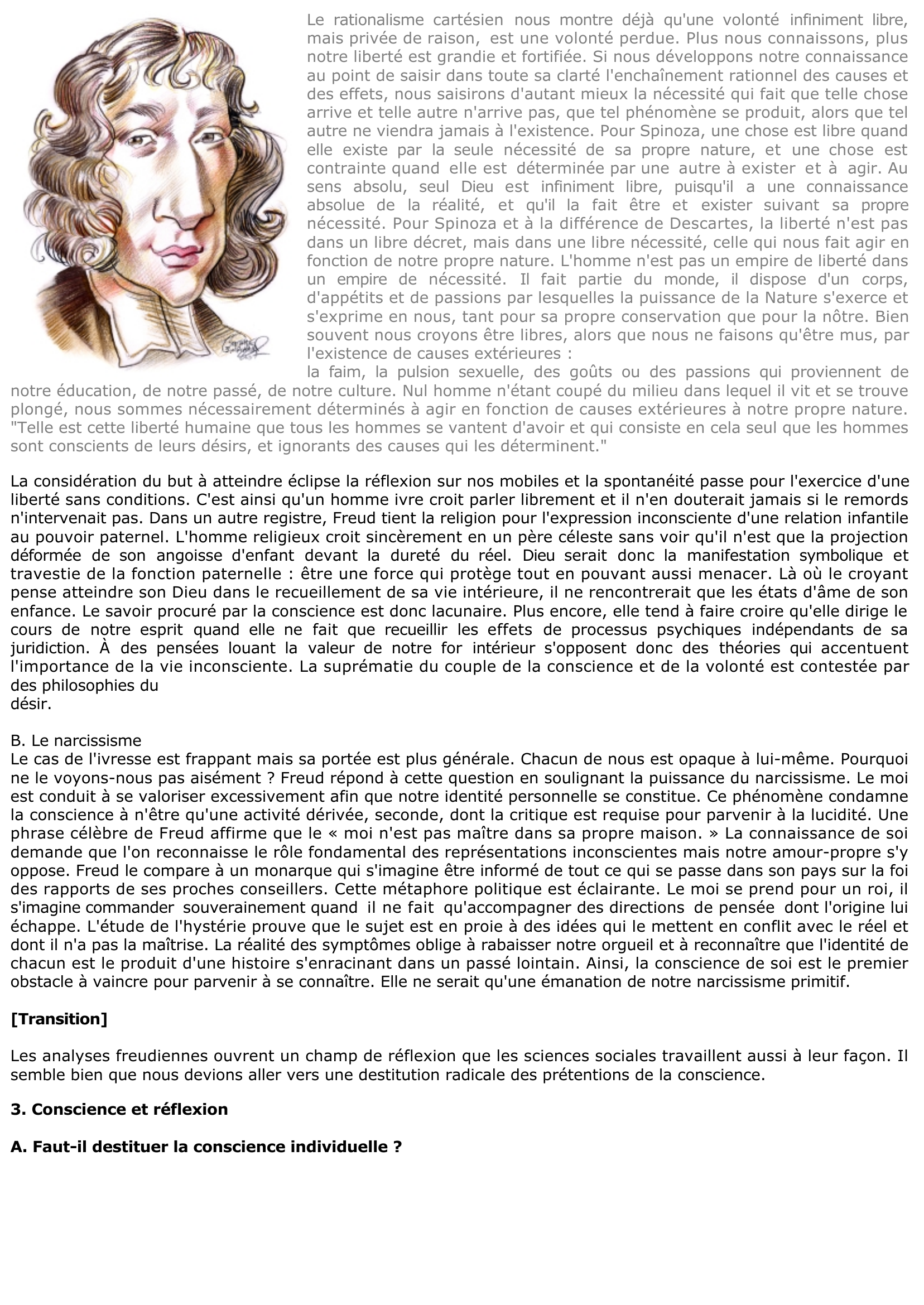Puis-je faire confiance à ma conscience?
Publié le 02/03/2005
Extrait du document


«
Le rationalisme cartésien nous montre déjà qu'une volonté infiniment libre,mais privée de raison, est une volonté perdue.
Plus nous connaissons, plusnotre liberté est grandie et fortifiée.
Si nous développons notre connaissanceau point de saisir dans toute sa clarté l'enchaînement rationnel des causes etdes effets, nous saisirons d'autant mieux la nécessité qui fait que telle chosearrive et telle autre n'arrive pas, que tel phénomène se produit, alors que telautre ne viendra jamais à l'existence.
Pour Spinoza, une chose est libre quandelle existe par la seule nécessité de sa propre nature, et une chose estcontrainte quand elle est déterminée par une autre à exister et à agir.
Ausens absolu, seul Dieu est infiniment libre, puisqu'il a une connaissanceabsolue de la réalité, et qu'il la fait être et exister suivant sa proprenécessité.
Pour Spinoza et à la différence de Descartes, la liberté n'est pasdans un libre décret, mais dans une libre nécessité, celle qui nous fait agir enfonction de notre propre nature.
L'homme n'est pas un empire de liberté dansun empire de nécessité.
Il fait partie du monde, il dispose d'un corps,d'appétits et de passions par lesquelles la puissance de la Nature s'exerce ets'exprime en nous, tant pour sa propre conservation que pour la nôtre.
Biensouvent nous croyons être libres, alors que nous ne faisons qu'être mus, parl'existence de causes extérieures :la faim, la pulsion sexuelle, des goûts ou des passions qui proviennent de notre éducation, de notre passé, de notre culture.
Nul homme n'étant coupé du milieu dans lequel il vit et se trouveplongé, nous sommes nécessairement déterminés à agir en fonction de causes extérieures à notre propre nature."Telle est cette liberté humaine que tous les hommes se vantent d'avoir et qui consiste en cela seul que les hommessont conscients de leurs désirs, et ignorants des causes qui les déterminent."
La considération du but à atteindre éclipse la réflexion sur nos mobiles et la spontanéité passe pour l'exercice d'uneliberté sans conditions.
C'est ainsi qu'un homme ivre croit parler librement et il n'en douterait jamais si le remordsn'intervenait pas.
Dans un autre registre, Freud tient la religion pour l'expression inconsciente d'une relation infantileau pouvoir paternel.
L'homme religieux croit sincèrement en un père céleste sans voir qu'il n'est que la projectiondéformée de son angoisse d'enfant devant la dureté du réel.
Dieu serait donc la manifestation symbolique ettravestie de la fonction paternelle : être une force qui protège tout en pouvant aussi menacer.
Là où le croyantpense atteindre son Dieu dans le recueillement de sa vie intérieure, il ne rencontrerait que les états d'âme de sonenfance.
Le savoir procuré par la conscience est donc lacunaire.
Plus encore, elle tend à faire croire qu'elle dirige lecours de notre esprit quand elle ne fait que recueillir les effets de processus psychiques indépendants de sajuridiction.
À des pensées louant la valeur de notre for intérieur s'opposent donc des théories qui accentuentl'importance de la vie inconsciente.
La suprématie du couple de la conscience et de la volonté est contestée pardes philosophies dudésir.
B.
Le narcissismeLe cas de l'ivresse est frappant mais sa portée est plus générale.
Chacun de nous est opaque à lui-même.
Pourquoine le voyons-nous pas aisément ? Freud répond à cette question en soulignant la puissance du narcissisme.
Le moiest conduit à se valoriser excessivement afin que notre identité personnelle se constitue.
Ce phénomène condamnela conscience à n'être qu'une activité dérivée, seconde, dont la critique est requise pour parvenir à la lucidité.
Unephrase célèbre de Freud affirme que le « moi n'est pas maître dans sa propre maison.
» La connaissance de soidemande que l'on reconnaisse le rôle fondamental des représentations inconscientes mais notre amour-propre s'yoppose.
Freud le compare à un monarque qui s'imagine être informé de tout ce qui se passe dans son pays sur la foides rapports de ses proches conseillers.
Cette métaphore politique est éclairante.
Le moi se prend pour un roi, ils'imagine commander souverainement quand il ne fait qu'accompagner des directions de pensée dont l'origine luiéchappe.
L'étude de l'hystérie prouve que le sujet est en proie à des idées qui le mettent en conflit avec le réel etdont il n'a pas la maîtrise.
La réalité des symptômes oblige à rabaisser notre orgueil et à reconnaître que l'identité dechacun est le produit d'une histoire s'enracinant dans un passé lointain.
Ainsi, la conscience de soi est le premierobstacle à vaincre pour parvenir à se connaître.
Elle ne serait qu'une émanation de notre narcissisme primitif.
[Transition]
Les analyses freudiennes ouvrent un champ de réflexion que les sciences sociales travaillent aussi à leur façon.
Ilsemble bien que nous devions aller vers une destitution radicale des prétentions de la conscience.
3.
Conscience et réflexion
A.
Faut-il destituer la conscience individuelle ?.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Si pour Descartes aucune preuve n'est nécessaire, si l'expérience suffit c'est parce que l'évidence du libre-arbitre est liée à notre conscience. Être conscient c'est en effet se savoir être, se savoir exister, et donc être face à la réalité qui nous entoure : j'ai le choix de faire ou non des études, j'ai le choix de pratiquer ou non un sport etc. On voit ainsi qu'être un être conscient c'est se sentir libre. La conscience nous donne l'intuition de notre existence, de notre présence a
- peut-on faire confiance a ces sens
- Sujet : Puis-je faire confiance à mes sens ?
- La conscience de ce que nous sommes peut-elle faire obstacle à notre bonheur?
- Puis-je faire confiance a mes sens ?