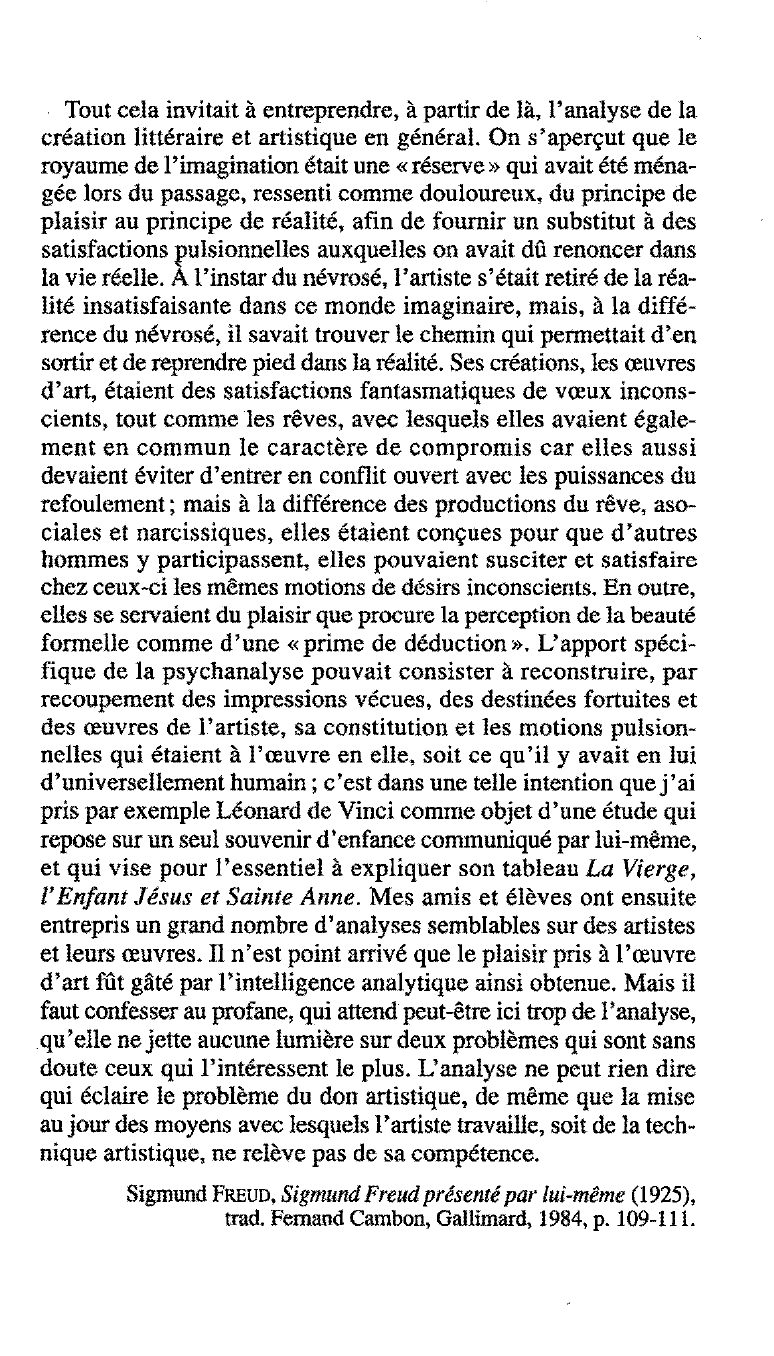Pouvoirs de l'inconscient de S. FREUD
Publié le 05/01/2020
Extrait du document
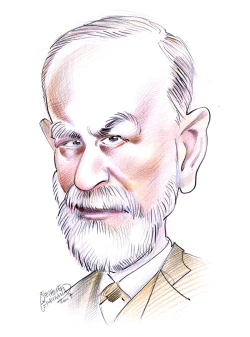
Tout cela invitait à entreprendre, à partir de là, l’analyse de la création littéraire et artistique en général. On s’aperçut que le royaume de l’imagination était une « réserve » qui avait été ménagée lors du passage, ressenti comme douloureux, du principe de plaisir au principe de réalité, afin de fournir un substitut à des satisfactions pulsionnelles auxquelles on avait dû renoncer dans la vie réelle. A l’instar du névrosé, l’artiste s’était retiré de la réalité insatisfaisante dans ce monde imaginaire, mais, à la différence du névrosé, il savait trouver le chemin qui permettait d’en sortir et de reprendre pied dans la réalité. Ses créations, les œuvres d’art, étaient des satisfactions fantasmatiques de vœux inconscients, tout comme les rêves, avec lesquels elles avaient également en commun le caractère de compromis car elles aussi devaient éviter d’entrer en conflit ouvert avec les puissances du refoulement ; mais à la différence des productions du rêve, asociales et narcissiques, elles étaient conçues pour que d’autres hommes y participassent, elles pouvaient susciter et satisfaire chez ceux-ci les mêmes motions de désirs inconscients. En outre, elles se servaient du plaisir que procure la perception de la beauté formelle comme d’une «prime de déduction». L’apport spécifique de la psychanalyse pouvait consister à reconstruire, par recoupement des impressions vécues, des destinées fortuites et des œuvres de l’artiste, sa constitution et les motions pulsionnelles qui étaient à l’œuvre en elle, soit ce qu’il y avait en lui d’universellement humain ; c’est dans une telle intention que j’ai pris par exemple Léonard de Vinci comme objet d’une étude qui repose sur un seul souvenir d’enfance communiqué par lui-même, et qui vise pour l’essentiel à expliquer son tableau La Vierge, l’Enfant Jésus et Sainte Anne. Mes amis et élèves ont ensuite entrepris un grand nombre d’analyses semblables sur des artistes et leurs œuvres. Il n’est point arrivé que le plaisir pris à l’œuvre d’art fût gâté par l’intelligence analytique ainsi obtenue. Mais il faut confesser au profane, qui attend peut-être ici trop de l’analyse, qu’elle ne jette aucune lumière sur deux problèmes qui sont sans doute ceux qui l’intéressent le plus. L’analyse ne peut rien dire qui éclaire le problème du don artistique, de même que la mise au jour des moyens avec lesquels l’artiste travaille, soit de la technique artistique, ne relève pas de sa compétence.
Sigmund Freud, Sigmund Freud présenté par lui-même (1925), trad. Fernand Cambon, Gallimard, 1984, p. 109-111.
La création d'une œuvre d'art, pour Freud, relève en partie de la vie affective et inconsciente. L'adaptation à la réalité sociale et la poursuite de buts utilitaires fait passer l’imaginaire au second plan pour la majorité des individus. L'artiste, au contraire, met au second plan la réalité commune au profit de l'expression de fantasmes, de pulsions. Que l'artiste soit comparé au névrosé ne doit toutefois pas faire penser que l’art s'identifie à une forme de pathologie.
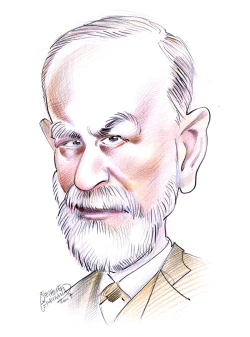
«
Tout cela invitait à entreprendre, à partir de là, l'analyse de la création littéraire et artistique en général.
On s'aperçut que le
royaume de l'imagination était une «réserve» qui avait été ména gée lors du passage, ressenti comme douloureux, du principe de
plaisir au principe de réalité, afin de fournir un substitut à des
satisfactions pulsionnelles auxquelles on avait dû renoncer dans
la vie réelle.
A l'instar du névrosé, l'artiste s'était retiré de la réa
lité insatisfaisante dans ce monde imaginaire, mais, à la diffé
rence du névrosé, il savait trouver le chemin qui permettait d'en
sortir et de reprendre pied dans la réalité.
Ses créations, les œuvres
d'art, étaient des satisfactions fantasmatiques de vœux incons
cients, tout comme les rêves, avec lesquels elles avaient égale
ment en commun le caractère de compromis car elles aussi
devaient éviter d'entrer en conflit ouvert avec les puissances du
refoulement ; mais à la différence des productions du rêve, aso
ciales et narcissiques, elles étaient conçues pour que d'autres hommes y participassent, elles pouvaient susciter et satisfaire
chez ceux-ci les mêmes motions de désirs inconscients.
En outre, elles se servaient du plaisir que procure la perception de la beauté
formelle comme d'une «prime de déduction».
L'apport spéci
fique de la psychanalyse pouvait consister à reconstruire, par
recoupement des impressions vécues, des destinées fortuites et
des œuvres de l'artiste, sa constitution et les motions pulsion nelles qui étaient à l'œuvre en elle, soit ce qu'il y avait en lui
d'universellement humain; c'est dans une telle intention que j'ai
pris par exemple Uonard de Vinci comme objet d'une étude qui
repose sur un seul souvenir d'enfance communiqué par lui-même,
et qui vise pour l'essentiel à expliquer son tableau La Vierge,
l' Enfant Jésus et Sainte Anne.
Mes amis et élèves ont ensuite
entrepris un grand nombre d'analyses semblables sur des artistes
et leurs œuvres.
Il n'est point arrivé que le plaisir pris à l'œuvre
d'art fût gâté par l'intelligence analytique ainsi obtenue.
Mais il
faut confesser au profane, qui attend peut-être ici trop de l'analyse,
qu'elle ne jette aucune lumière sur deux problèmes qui sont sans
doute ceux qui l'intéressent le plus.
L'analyse ne peut rien dire
qui éclaire le problème du don artistique, de même que la mise
au jour des moyens avec lesquels l'artiste travaille, soit de la tech
nique artistique, ne relève pas de sa compétence.
Sigmund FREUD, Sigmund Freud présenté par lui-même (1925), trad.
Fernand Cambon, Gallimard, 1984, p.
109-111..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L'inconscient de Freud
- « L'Inconscient et la Conscience. La Réalité » Dans L'interprétation du rêve. 1900 S.Freud.
- commentaire de texte: Freud, l'hypothèse de l'inconscient
- Métapsychologie Freud inconscient
- Sigmund Freud, Métapsychologie, « l'inconscient »