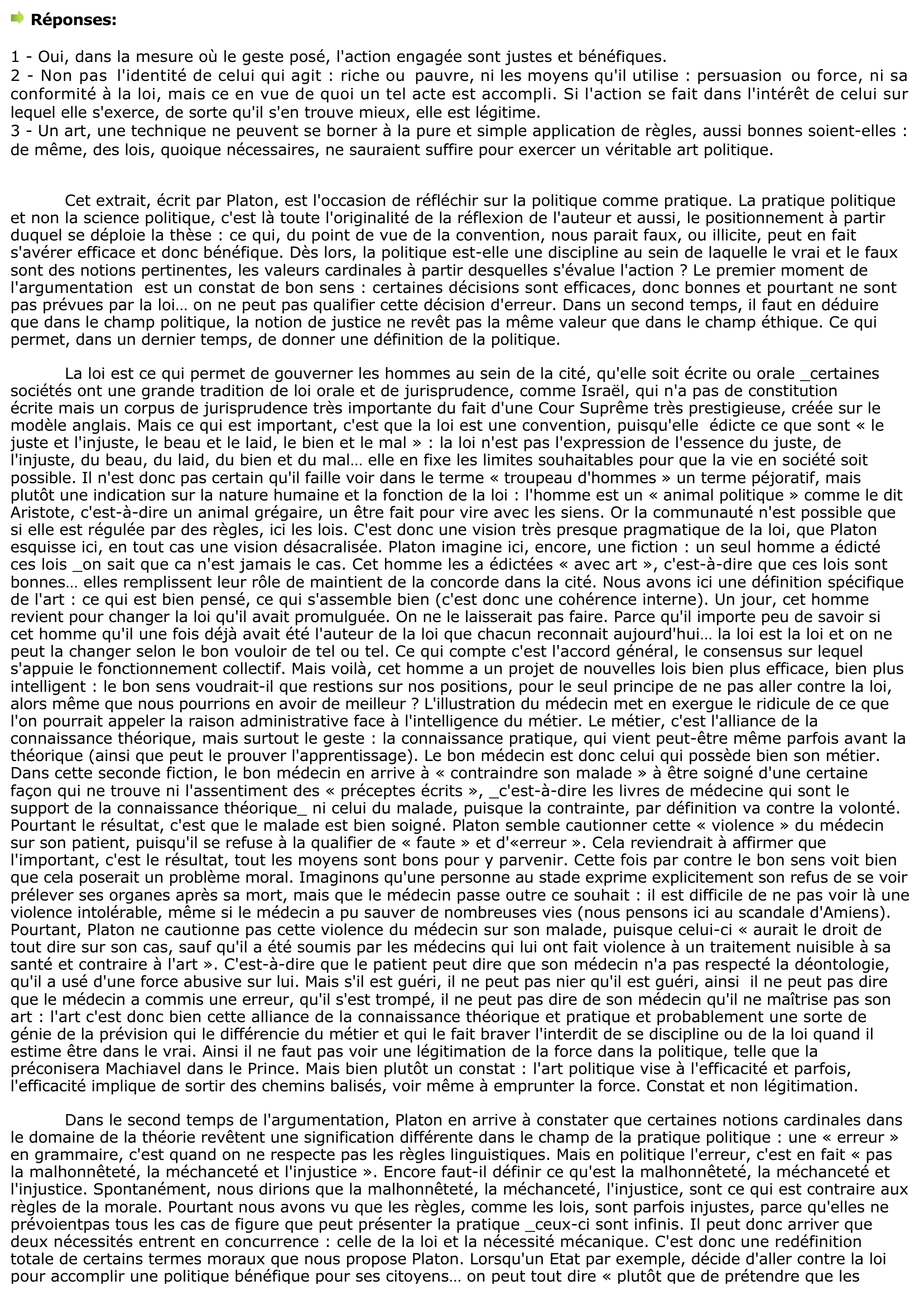Platon: L'État doit-il se conformer au droit ?
Publié le 11/03/2005
Extrait du document
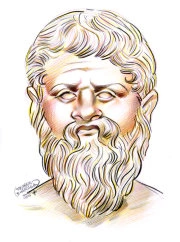
Cet extrait, écrit par Platon, est l’occasion de réfléchir sur la politique comme pratique. La pratique politique et non la science politique, c’est là toute l’originalité de la réflexion de l’auteur et aussi, le positionnement à partir duquel se déploie la thèse : ce qui, du point de vue de la convention, nous parait faux, ou illicite, peut en fait s’avérer efficace et donc bénéfique. Dès lors, la politique est-elle une discipline au sein de laquelle le vrai et le faux sont des notions pertinentes, les valeurs cardinales à partir desquelles s’évalue l’action ? Le premier moment de l’argumentation est un constat de bon sens : certaines décisions sont efficaces, donc bonnes et pourtant ne sont pas prévues par la loi… on ne peut pas qualifier cette décision d’erreur. Dans un second temps, il faut en déduire que dans le champ politique, la notion de justice ne revêt pas la même valeur que dans le champ éthique. Ce qui permet, dans un dernier temps, de donner une définition de la politique.
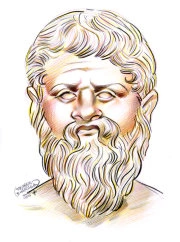
«
Réponses:
1 - Oui, dans la mesure où le geste posé, l'action engagée sont justes et bénéfiques.2 - Non pas l'identité de celui qui agit : riche ou pauvre, ni les moyens qu'il utilise : persuasion ou force, ni saconformité à la loi, mais ce en vue de quoi un tel acte est accompli.
Si l'action se fait dans l'intérêt de celui surlequel elle s'exerce, de sorte qu'il s'en trouve mieux, elle est légitime.3 - Un art, une technique ne peuvent se borner à la pure et simple application de règles, aussi bonnes soient-elles :de même, des lois, quoique nécessaires, ne sauraient suffire pour exercer un véritable art politique.
Cet extrait, écrit par Platon, est l'occasion de réfléchir sur la politique comme pratique.
La pratique politique et non la science politique, c'est là toute l'originalité de la réflexion de l'auteur et aussi, le positionnement à partirduquel se déploie la thèse : ce qui, du point de vue de la convention, nous parait faux, ou illicite, peut en faits'avérer efficace et donc bénéfique.
Dès lors, la politique est-elle une discipline au sein de laquelle le vrai et le fauxsont des notions pertinentes, les valeurs cardinales à partir desquelles s'évalue l'action ? Le premier moment del'argumentation est un constat de bon sens : certaines décisions sont efficaces, donc bonnes et pourtant ne sontpas prévues par la loi… on ne peut pas qualifier cette décision d'erreur.
Dans un second temps, il faut en déduire que dans le champ politique, la notion de justice ne revêt pas la même valeur que dans le champ éthique.
Ce quipermet, dans un dernier temps, de donner une définition de la politique.
La loi est ce qui permet de gouverner les hommes au sein de la cité, qu'elle soit écrite ou orale _certaines sociétés ont une grande tradition de loi orale et de jurisprudence, comme Israël, qui n'a pas de constitutionécrite mais un corpus de jurisprudence très importante du fait d'une Cour Suprême très prestigieuse, créée sur lemodèle anglais.
Mais ce qui est important, c'est que la loi est une convention, puisqu'elle édicte ce que sont « lejuste et l'injuste, le beau et le laid, le bien et le mal » : la loi n'est pas l'expression de l'essence du juste, del'injuste, du beau, du laid, du bien et du mal… elle en fixe les limites souhaitables pour que la vie en société soitpossible.
Il n'est donc pas certain qu'il faille voir dans le terme « troupeau d'hommes » un terme péjoratif, maisplutôt une indication sur la nature humaine et la fonction de la loi : l'homme est un « animal politique » comme le ditAristote, c'est-à-dire un animal grégaire, un être fait pour vire avec les siens.
Or la communauté n'est possible quesi elle est régulée par des règles, ici les lois.
C'est donc une vision très presque pragmatique de la loi, que Platonesquisse ici, en tout cas une vision désacralisée.
Platon imagine ici, encore, une fiction : un seul homme a édictéces lois _on sait que ca n'est jamais le cas.
Cet homme les a édictées « avec art », c'est-à-dire que ces lois sontbonnes… elles remplissent leur rôle de maintient de la concorde dans la cité.
Nous avons ici une définition spécifiquede l'art : ce qui est bien pensé, ce qui s'assemble bien (c'est donc une cohérence interne).
Un jour, cet hommerevient pour changer la loi qu'il avait promulguée.
On ne le laisserait pas faire.
Parce qu'il importe peu de savoir sicet homme qu'il une fois déjà avait été l'auteur de la loi que chacun reconnait aujourd'hui… la loi est la loi et on nepeut la changer selon le bon vouloir de tel ou tel.
Ce qui compte c'est l'accord général, le consensus sur lequels'appuie le fonctionnement collectif.
Mais voilà, cet homme a un projet de nouvelles lois bien plus efficace, bien plusintelligent : le bon sens voudrait-il que restions sur nos positions, pour le seul principe de ne pas aller contre la loi,alors même que nous pourrions en avoir de meilleur ? L'illustration du médecin met en exergue le ridicule de ce quel'on pourrait appeler la raison administrative face à l'intelligence du métier.
Le métier, c'est l'alliance de laconnaissance théorique, mais surtout le geste : la connaissance pratique, qui vient peut-être même parfois avant lathéorique (ainsi que peut le prouver l'apprentissage).
Le bon médecin est donc celui qui possède bien son métier.Dans cette seconde fiction, le bon médecin en arrive à « contraindre son malade » à être soigné d'une certainefaçon qui ne trouve ni l'assentiment des « préceptes écrits », _c'est-à-dire les livres de médecine qui sont lesupport de la connaissance théorique_ ni celui du malade, puisque la contrainte, par définition va contre la volonté.
Pourtant le résultat, c'est que le malade est bien soigné.
Platon semble cautionner cette « violence » du médecinsur son patient, puisqu'il se refuse à la qualifier de « faute » et d'«erreur ».
Cela reviendrait à affirmer quel'important, c'est le résultat, tout les moyens sont bons pour y parvenir.
Cette fois par contre le bon sens voit bien que cela poserait un problème moral.
Imaginons qu'une personne au stade exprime explicitement son refus de se voirprélever ses organes après sa mort, mais que le médecin passe outre ce souhait : il est difficile de ne pas voir là uneviolence intolérable, même si le médecin a pu sauver de nombreuses vies (nous pensons ici au scandale d'Amiens).Pourtant, Platon ne cautionne pas cette violence du médecin sur son malade, puisque celui-ci « aurait le droit detout dire sur son cas, sauf qu'il a été soumis par les médecins qui lui ont fait violence à un traitement nuisible à sasanté et contraire à l'art ».
C'est-à-dire que le patient peut dire que son médecin n'a pas respecté la déontologie,qu'il a usé d'une force abusive sur lui.
Mais s'il est guéri, il ne peut pas nier qu'il est guéri, ainsi il ne peut pas direque le médecin a commis une erreur, qu'il s'est trompé, il ne peut pas dire de son médecin qu'il ne maîtrise pas sonart : l'art c'est donc bien cette alliance de la connaissance théorique et pratique et probablement une sorte degénie de la prévision qui le différencie du métier et qui le fait braver l'interdit de se discipline ou de la loi quand ilestime être dans le vrai.
Ainsi il ne faut pas voir une légitimation de la force dans la politique, telle que lapréconisera Machiavel dans le Prince.
Mais bien plutôt un constat : l'art politique vise à l'efficacité et parfois,l'efficacité implique de sortir des chemins balisés, voir même à emprunter la force.
Constat et non légitimation.
Dans le second temps de l'argumentation, Platon en arrive à constater que certaines notions cardinales dans le domaine de la théorie revêtent une signification différente dans le champ de la pratique politique : une « erreur »en grammaire, c'est quand on ne respecte pas les règles linguistiques.
Mais en politique l'erreur, c'est en fait « pasla malhonnêteté, la méchanceté et l'injustice ».
Encore faut-il définir ce qu'est la malhonnêteté, la méchanceté etl'injustice.
Spontanément, nous dirions que la malhonnêteté, la méchanceté, l'injustice, sont ce qui est contraire auxrègles de la morale.
Pourtant nous avons vu que les règles, comme les lois, sont parfois injustes, parce qu'elles neprévoientpas tous les cas de figure que peut présenter la pratique _ceux-ci sont infinis.
Il peut donc arriver quedeux nécessités entrent en concurrence : celle de la loi et la nécessité mécanique.
C'est donc une redéfinitiontotale de certains termes moraux que nous propose Platon.
Lorsqu'un Etat par exemple, décide d'aller contre la loipour accomplir une politique bénéfique pour ses citoyens… on peut tout dire « plutôt que de prétendre que les.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Platon: La société et l'État; la justice et le droit.
- COMMENTAIRE DE TEXTE DE PLATON: Le droit ; la justice
- Platon : Droit et justice
- L'État doit-il se conformer au droit ?
- Ceux qui, au sens droit du terme, se mêlent de philosopher, s'exercent à mourir. [ Phédon, 67e ] Platon. Commentez cette citation.