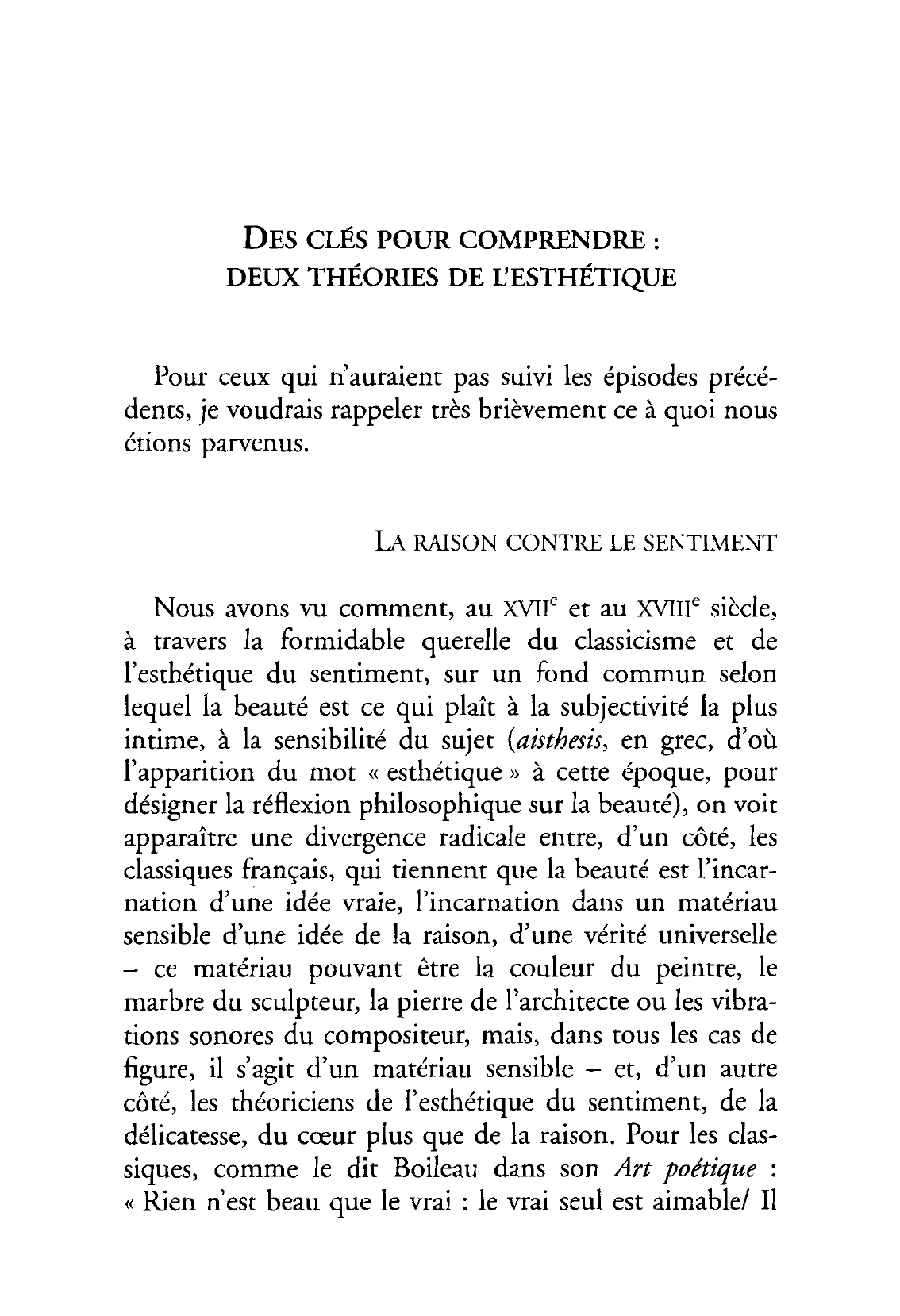Philosophie de l'art moderne
Publié le 01/04/2015
Extrait du document

Dès les années 1912-1913, Duchamp avait déjà, sinon inventé tous les «trucs« et tous les tics de l'innovation pour l'innovation (en fait, ils les a largement copiés sur les inventions des groupes bohèmes de la fin du xixe siècle, notamment chez les Incohérents), du moins mis en scène de manière multiple cette stratégie de Pori-ginalisme.
Dans une conférence qu'il appelle modestement, originalité oblige, À propos of myself --- et cette absence de modestie, en vérité, est liée à l'impératif de l'innovation, de l'originalité à tout prix ---, conférence prononcée devant un parterre d'Américains évidemment ébahis, il explique tranquillement comment, au cours de l'année 1913, il a changé six fois de style, signe manifeste qu'il est absolument génial.
Steve Jobs et son successeur sont à peu près dans le même cas : eux aussi doivent, si possible, changer trois fois de style dans l'année pour que leur téléphone portable ne soit pas rendu obsolète par la concurrence.
réconciliation des deux mondes dans le concept commun de l'innovation pour l'innovation.
Mais il y a aussi ce deuxième aspect, que j'évoquais tout à l'heure avec Nietzsche, à savoir l'idée que l'art moderne, puis contemporain, ne va pas être simplement un art révolutionnaire au sens de la table rase, de la rupture permanente et de l'innovation permanente, mais qu'il est aussi un art chargé de refléter une nouvelle conception de la vérité comme chaos, brisure et différence.
En ce sens, l'art moderne est bel et bien ce qu'on pourrait appeler un «classicisme de la différence«.

«
DES CLÉS POUR COMPRENDRE :
DEUX THÉORIES DE {;ESTHÉTIQUE
Pour ceux qui n'auraient pas suivi les épisodes précé
dents,
je voudrais rappeler très brièvement ce à quoi nous
étions parvenus.
LA RAISON CONTRE LE SENTIMENT
Nous avons vu comment, au XVIIe et au XVIIIe siècle,
à travers la formidable querelle du classicisme et de
l'esthétique
du sentiment, sur un fond commun selon
lequel la beauté est
ce qui plaît à la subjectivité la plus
intime,
à la sensibilité du sujet (aisthesis, en grec, d'où
l'apparition
du mot «esthétique» à cette époque, pour
désigner la réflexion philosophique sur la beauté), on voit
apparaître une divergence radicale entre,
d'un côté, les
classiques français, qui tiennent que la beauté est l'incar
nation d'une idée vraie, l'incarnation dans
un matériau
sensible d'une idée de la raison, d'une vérité universelle
-
ce matériau pouvant être la couleur du peintre, le
marbre du sculpteur, la pierre de l'architecte ou les vibra
tions sonores
du compositeur, mais, dans tous les cas de
figure,
il s'agit d'un matériau sensible -et, d'un autre
côté,
les théoriciens de l'esthétique du sentiment, de la
délicatesse,
du cœur plus que de la raison.
Pour les clas
siques, comme
le dit Boileau dans son Art poétique :
« Rien n'est beau que le vrai : le vrai seul est aimable/ Il.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Philosophie Post-moderne
- l'art moderne - l'expressionisme avec Edward Munch
- La physique moderne en philosophie
- PHYSIQUE ET PHILOSOPHIE, la Science moderne en révolution, Werner Karl Heisenberg - résumé de l'oeuvre
- TRAITÉ DE PHILOSOPHIE MODERNE, The Josiah Royce (résumé & analyse)