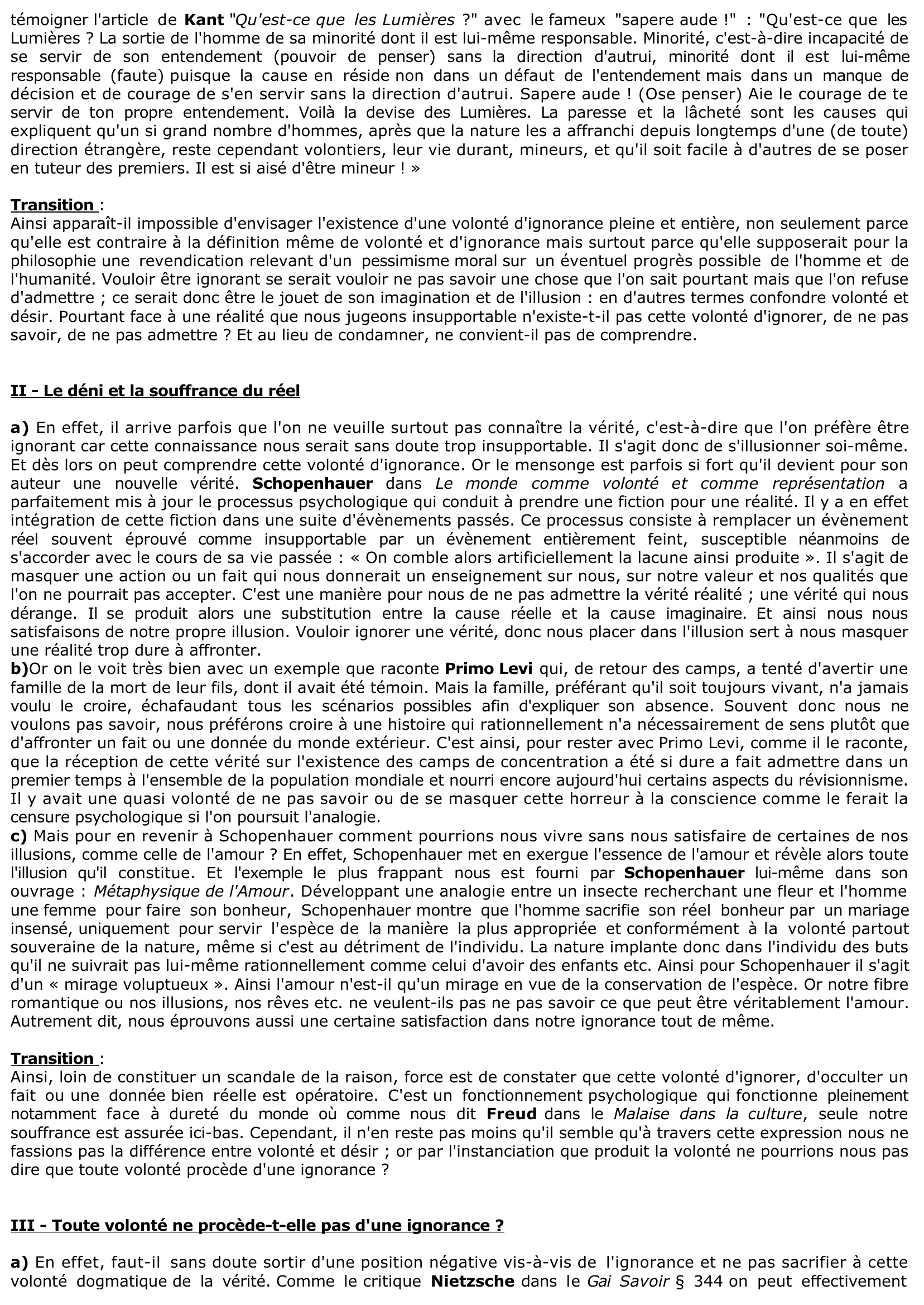Peut-on vouloir ignorer ?
Publié le 27/02/2008
Extrait du document
«
témoigner l'article de Kant "Qu'est-ce que les Lumières ?" avec le fameux "sapere aude !" : "Qu'est-ce que les Lumières ? La sortie de l'homme de sa minorité dont il est lui-même responsable.
Minorité, c'est-à-dire incapacité dese servir de son entendement (pouvoir de penser) sans la direction d'autrui, minorité dont il est lui-mêmeresponsable (faute) puisque la cause en réside non dans un défaut de l'entendement mais dans un manque dedécision et de courage de s'en servir sans la direction d'autrui.
Sapere aude ! (Ose penser) Aie le courage de teservir de ton propre entendement.
Voilà la devise des Lumières.
La paresse et la lâcheté sont les causes quiexpliquent qu'un si grand nombre d'hommes, après que la nature les a affranchi depuis longtemps d'une (de toute)direction étrangère, reste cependant volontiers, leur vie durant, mineurs, et qu'il soit facile à d'autres de se poseren tuteur des premiers.
Il est si aisé d'être mineur ! » Transition : Ainsi apparaît-il impossible d'envisager l'existence d'une volonté d'ignorance pleine et entière, non seulement parcequ'elle est contraire à la définition même de volonté et d'ignorance mais surtout parce qu'elle supposerait pour laphilosophie une revendication relevant d'un pessimisme moral sur un éventuel progrès possible de l'homme et del'humanité.
Vouloir être ignorant se serait vouloir ne pas savoir une chose que l'on sait pourtant mais que l'on refused'admettre ; ce serait donc être le jouet de son imagination et de l'illusion : en d'autres termes confondre volonté etdésir.
Pourtant face à une réalité que nous jugeons insupportable n'existe-t-il pas cette volonté d'ignorer, de ne passavoir, de ne pas admettre ? Et au lieu de condamner, ne convient-il pas de comprendre.
II - Le déni et la souffrance du réel a) En effet, il arrive parfois que l'on ne veuille surtout pas connaître la vérité, c'est-à-dire que l'on préfère être ignorant car cette connaissance nous serait sans doute trop insupportable.
Il s'agit donc de s'illusionner soi-même.Et dès lors on peut comprendre cette volonté d'ignorance.
Or le mensonge est parfois si fort qu'il devient pour sonauteur une nouvelle vérité.
Schopenhauer dans Le monde comme volonté et comme représentation a parfaitement mis à jour le processus psychologique qui conduit à prendre une fiction pour une réalité.
Il y a en effetintégration de cette fiction dans une suite d'évènements passés.
Ce processus consiste à remplacer un évènementréel souvent éprouvé comme insupportable par un évènement entièrement feint, susceptible néanmoins des'accorder avec le cours de sa vie passée : « On comble alors artificiellement la lacune ainsi produite ».
Il s'agit demasquer une action ou un fait qui nous donnerait un enseignement sur nous, sur notre valeur et nos qualités quel'on ne pourrait pas accepter.
C'est une manière pour nous de ne pas admettre la vérité réalité ; une vérité qui nousdérange.
Il se produit alors une substitution entre la cause réelle et la cause imaginaire.
Et ainsi nous noussatisfaisons de notre propre illusion.
Vouloir ignorer une vérité, donc nous placer dans l'illusion sert à nous masquerune réalité trop dure à affronter.b)Or on le voit très bien avec un exemple que raconte Primo Levi qui, de retour des camps, a tenté d'avertir une famille de la mort de leur fils, dont il avait été témoin.
Mais la famille, préférant qu'il soit toujours vivant, n'a jamaisvoulu le croire, échafaudant tous les scénarios possibles afin d'expliquer son absence.
Souvent donc nous nevoulons pas savoir, nous préférons croire à une histoire qui rationnellement n'a nécessairement de sens plutôt qued'affronter un fait ou une donnée du monde extérieur.
C'est ainsi, pour rester avec Primo Levi, comme il le raconte,que la réception de cette vérité sur l'existence des camps de concentration a été si dure a fait admettre dans unpremier temps à l'ensemble de la population mondiale et nourri encore aujourd'hui certains aspects du révisionnisme.Il y avait une quasi volonté de ne pas savoir ou de se masquer cette horreur à la conscience comme le ferait lacensure psychologique si l'on poursuit l'analogie.c) Mais pour en revenir à Schopenhauer comment pourrions nous vivre sans nous satisfaire de certaines de nosillusions, comme celle de l'amour ? En effet, Schopenhauer met en exergue l'essence de l'amour et révèle alors toutel'illusion qu'il constitue.
Et l'exemple le plus frappant nous est fourni par Schopenhauer lui-même dans son ouvrage : Métaphysique de l'Amour .
Développant une analogie entre un insecte recherchant une fleur et l'homme une femme pour faire son bonheur, Schopenhauer montre que l'homme sacrifie son réel bonheur par un mariageinsensé, uniquement pour servir l'espèce de la manière la plus appropriée et conformément à la volonté partoutsouveraine de la nature, même si c'est au détriment de l'individu.
La nature implante donc dans l'individu des butsqu'il ne suivrait pas lui-même rationnellement comme celui d'avoir des enfants etc.
Ainsi pour Schopenhauer il s'agitd'un « mirage voluptueux ».
Ainsi l'amour n'est-il qu'un mirage en vue de la conservation de l'espèce.
Or notre fibreromantique ou nos illusions, nos rêves etc.
ne veulent-ils pas ne pas savoir ce que peut être véritablement l'amour.Autrement dit, nous éprouvons aussi une certaine satisfaction dans notre ignorance tout de même.
Transition : Ainsi, loin de constituer un scandale de la raison, force est de constater que cette volonté d'ignorer, d'occulter unfait ou une donnée bien réelle est opératoire.
C'est un fonctionnement psychologique qui fonctionne pleinementnotamment face à dureté du monde où comme nous dit Freud dans le Malaise dans la culture , seule notre souffrance est assurée ici-bas.
Cependant, il n'en reste pas moins qu'il semble qu'à travers cette expression nous nefassions pas la différence entre volonté et désir ; or par l'instanciation que produit la volonté ne pourrions nous pasdire que toute volonté procède d'une ignorance ? III - Toute volonté ne procède-t-elle pas d'une ignorance ? a) En effet, faut-il sans doute sortir d'une position négative vis-à-vis de l'ignorance et ne pas sacrifier à cettevolonté dogmatique de la vérité.
Comme le critique Nietzsche dans le Gai Savoir § 344 on peut effectivement.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Vouloir soigner tous les yeux avec le même collyre
- ART DE DOUTER ET DE CROIRE, D’IGNORER ET DE SAVOIR (De l’) (résumé & analyse)
- ): A priori, il paraît normal de vouloir s'appuyer sur des certitudes pour agir dans la vie pratique (s'assurer que les freins de la voiture sont en bon état.
- « Peut-on ne vouloir que du bonheur ? »
- Vouloir revenir a un mode de vie naturel a t'il un sens pour l'homme?