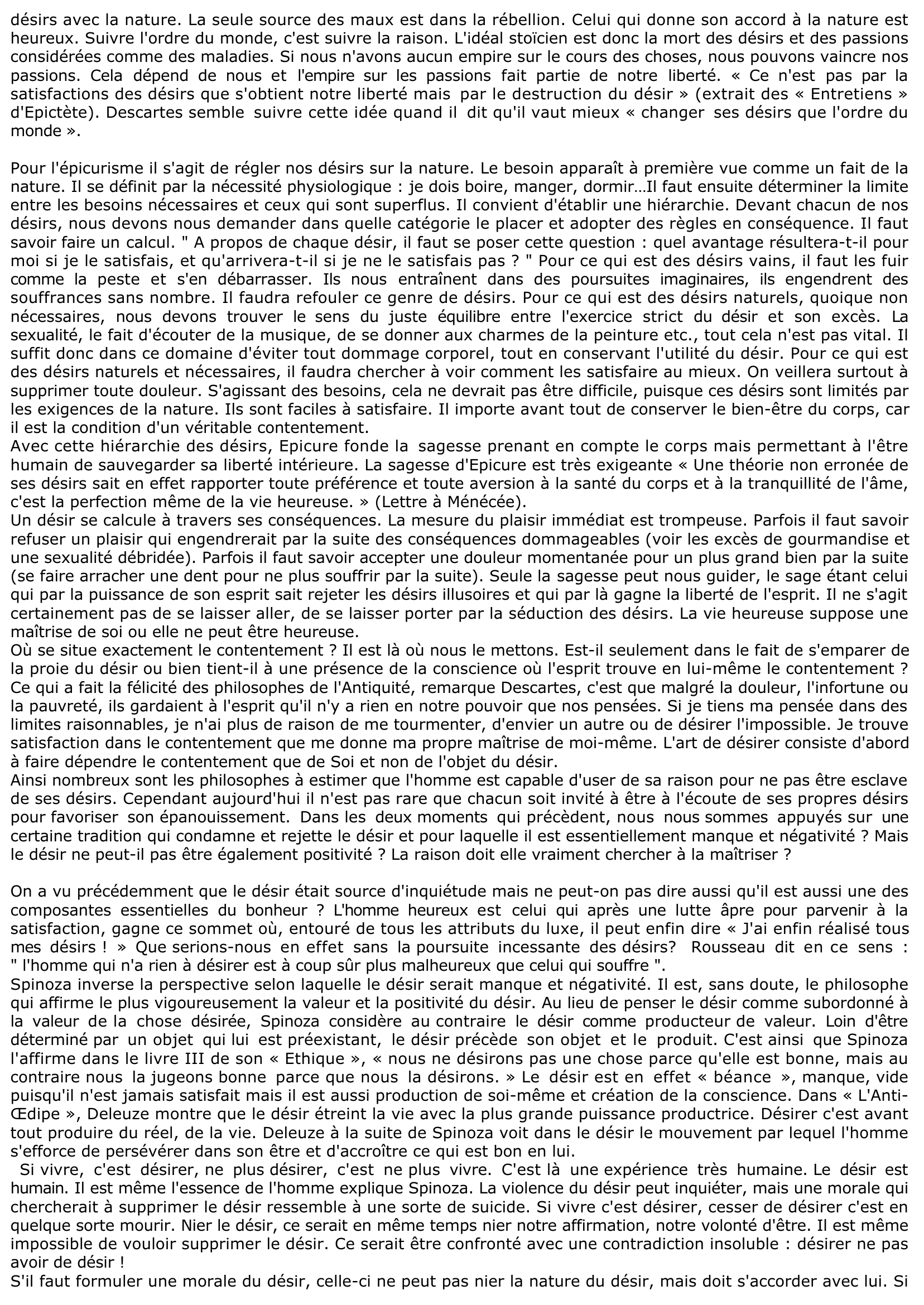Peut-on traiter raisonnablement ses désirs ?
Publié le 18/03/2009
Extrait du document
Le désir peut-il être l'objet d'une maîtrise ou est-il une force incontrôlable par la raiosn ? L'homme a-t-il la puissance et les ressources nécessaires pour soumettre ses désir à sa volonté ? Désir et raison ne s’opposent-ils pas ? Le désir comme les passions met l’homme face à ses limites et ses responsabilités, mais n’est-il pas également le seul à pouvoir sortir l’homme de l’ennui ? En ce sens, faut-il raisonnablement maîtriser ses désirs ?
«
désirs avec la nature.
La seule source des maux est dans la rébellion.
Celui qui donne son accord à la nature estheureux.
Suivre l'ordre du monde, c'est suivre la raison.
L'idéal stoïcien est donc la mort des désirs et des passionsconsidérées comme des maladies.
Si nous n'avons aucun empire sur le cours des choses, nous pouvons vaincre nospassions.
Cela dépend de nous et l'empire sur les passions fait partie de notre liberté.
« Ce n'est pas par lasatisfactions des désirs que s'obtient notre liberté mais par le destruction du désir » (extrait des « Entretiens »d'Epictète).
Descartes semble suivre cette idée quand il dit qu'il vaut mieux « changer ses désirs que l'ordre dumonde ».
Pour l'épicurisme il s'agit de régler nos désirs sur la nature.
Le besoin apparaît à première vue comme un fait de lanature.
Il se définit par la nécessité physiologique : je dois boire, manger, dormir…Il faut ensuite déterminer la limiteentre les besoins nécessaires et ceux qui sont superflus.
Il convient d'établir une hiérarchie.
Devant chacun de nosdésirs, nous devons nous demander dans quelle catégorie le placer et adopter des règles en conséquence.
Il fautsavoir faire un calcul .
" A propos de chaque désir, il faut se poser cette question : quel avantage résultera-t-il pour moi si je le satisfais, et qu'arrivera-t-il si je ne le satisfais pas ? " Pour ce qui est des désirs vains, il faut les fuircomme la peste et s'en débarrasser.
Ils nous entraînent dans des poursuites imaginaires, ils engendrent dessouffrances sans nombre.
Il faudra refouler ce genre de désirs.
Pour ce qui est des désirs naturels, quoique nonnécessaires, nous devons trouver le sens du juste équilibre entre l'exercice strict du désir et son excès.
Lasexualité , le fait d'écouter de la musique, de se donner aux charmes de la peinture etc., tout cela n'est pas vital.
Il suffit donc dans ce domaine d'éviter tout dommage corporel, tout en conservant l'utilité du désir.
Pour ce qui estdes désirs naturels et nécessaires, il faudra chercher à voir comment les satisfaire au mieux.
On veillera surtout àsupprimer toute douleur.
S'agissant des besoins, cela ne devrait pas être difficile, puisque ces désirs sont limités parles exigences de la nature.
Ils sont faciles à satisfaire.
Il importe avant tout de conserver le bien-être du corps, caril est la condition d'un véritable contentement.Avec cette hiérarchie des désirs, Epicure fonde la sagesse prenant en compte le corps mais permettant à l'êtrehumain de sauvegarder sa liberté intérieure.
La sagesse d'Epicure est très exigeante « Une théorie non erronée deses désirs sait en effet rapporter toute préférence et toute aversion à la santé du corps et à la tranquillité de l'âme,c'est la perfection même de la vie heureuse.
» (Lettre à Ménécée). Un désir se calcule à travers ses conséquences.
La mesure du plaisir immédiat est trompeuse.
Parfois il faut savoirrefuser un plaisir qui engendrerait par la suite des conséquences dommageables (voir les excès de gourmandise etune sexualité débridée).
Parfois il faut savoir accepter une douleur momentanée pour un plus grand bien par la suite(se faire arracher une dent pour ne plus souffrir par la suite).
Seule la sagesse peut nous guider, le sage étant celui qui par la puissance de son esprit sait rejeter les désirs illusoires et qui par là gagne la liberté de l'esprit.
Il ne s'agitcertainement pas de se laisser aller, de se laisser porter par la séduction des désirs.
La vie heureuse suppose unemaîtrise de soi ou elle ne peut être heureuse.
Où se situe exactement le contentement ? Il est là où nous le mettons.
Est-il seulement dans le fait de s'emparer dela proie du désir ou bien tient-il à une présence de la conscience où l'esprit trouve en lui-même le contentement ?Ce qui a fait la félicité des philosophes de l'Antiquité, remarque Descartes, c'est que malgré la douleur, l'infortune oula pauvreté, ils gardaient à l'esprit qu'il n'y a rien en notre pouvoir que nos pensées.
Si je tiens ma pensée dans deslimites raisonnables, je n'ai plus de raison de me tourmenter, d'envier un autre ou de désirer l'impossible.
Je trouvesatisfaction dans le contentement que me donne ma propre maîtrise de moi-même.
L'art de désirer consiste d'abord à faire dépendre le contentement que de Soi et non de l'objet du désir.Ainsi nombreux sont les philosophes à estimer que l'homme est capable d'user de sa raison pour ne pas être esclavede ses désirs.
Cependant aujourd'hui il n'est pas rare que chacun soit invité à être à l'écoute de ses propres désirspour favoriser son épanouissement.
Dans les deux moments qui précèdent, nous nous sommes appuyés sur unecertaine tradition qui condamne et rejette le désir et pour laquelle il est essentiellement manque et négativité ? Maisle désir ne peut-il pas être également positivité ? La raison doit elle vraiment chercher à la maîtriser ? On a vu précédemment que le désir était source d'inquiétude mais ne peut-on pas dire aussi qu'il est aussi une descomposantes essentielles du bonheur ? L'homme heureux est celui qui après une lutte âpre pour parvenir à lasatisfaction, gagne ce sommet où, entouré de tous les attributs du luxe, il peut enfin dire « J'ai enfin réalisé tousmes désirs ! » Que serions-nous en effet sans la poursuite incessante des désirs? Rousseau dit en ce sens :" l'homme qui n'a rien à désirer est à coup sûr plus malheureux que celui qui souffre ".Spinoza inverse la perspective selon laquelle le désir serait manque et négativité.
Il est, sans doute, le philosophequi affirme le plus vigoureusement la valeur et la positivité du désir.
Au lieu de penser le désir comme subordonné àla valeur de la chose désirée, Spinoza considère au contraire le désir comme producteur de valeur.
Loin d'êtredéterminé par un objet qui lui est préexistant, le désir précède son objet et le produit.
C'est ainsi que Spinozal'affirme dans le livre III de son « Ethique », « nous ne désirons pas une chose parce qu'elle est bonne, mais aucontraire nous la jugeons bonne parce que nous la désirons.
» Le désir est en effet « béance », manque, videpuisqu'il n'est jamais satisfait mais il est aussi production de soi-même et création de la conscience.
Dans « L'Anti-Œdipe », Deleuze montre que le désir étreint la vie avec la plus grande puissance productrice.
Désirer c'est avanttout produire du réel, de la vie.
Deleuze à la suite de Spinoza voit dans le désir le mouvement par lequel l'hommes'efforce de persévérer dans son être et d'accroître ce qui est bon en lui.
Si vivre, c'est désirer, ne plus désirer, c'est ne plus vivre.
C'est là une expérience très humaine.
Le désir esthumain .
Il est même l'essence de l'homme explique Spinoza.
La violence du désir peut inquiéter, mais une morale qui chercherait à supprimer le désir ressemble à une sorte de suicide.
Si vivre c'est désirer, cesser de désirer c'est enquelque sorte mourir.
Nier le désir, ce serait en même temps nier notre affirmation, notre volonté d'être.
Il est mêmeimpossible de vouloir supprimer le désir.
Ce serait être confronté avec une contradiction insoluble : désirer ne pasavoir de désir !S'il faut formuler une morale du désir, celle-ci ne peut pas nier la nature du désir, mais doit s'accorder avec lui.
Si.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L'accomplissement de tous nos désirs s'oppose-t-il à une bonne règle de vie ?
- Accomplir tous ses désirs, est-ce une bonne règle de vie ?
- Anne de noailles: « Être dans la nature ainsi qu’un arbre humain, / Étendre ses désirs comme un profond feuillage » ,« Être le jour qui monte et l’ombre qui descend »
- Dissertation: Qu'est-ce que se conduire raisonnablement?
- La liberté consiste-t-elle « à tâcher toujours de se vaincre plutôt que la fortune et à changer ses désirs plutôt que l’ordre du monde » ?