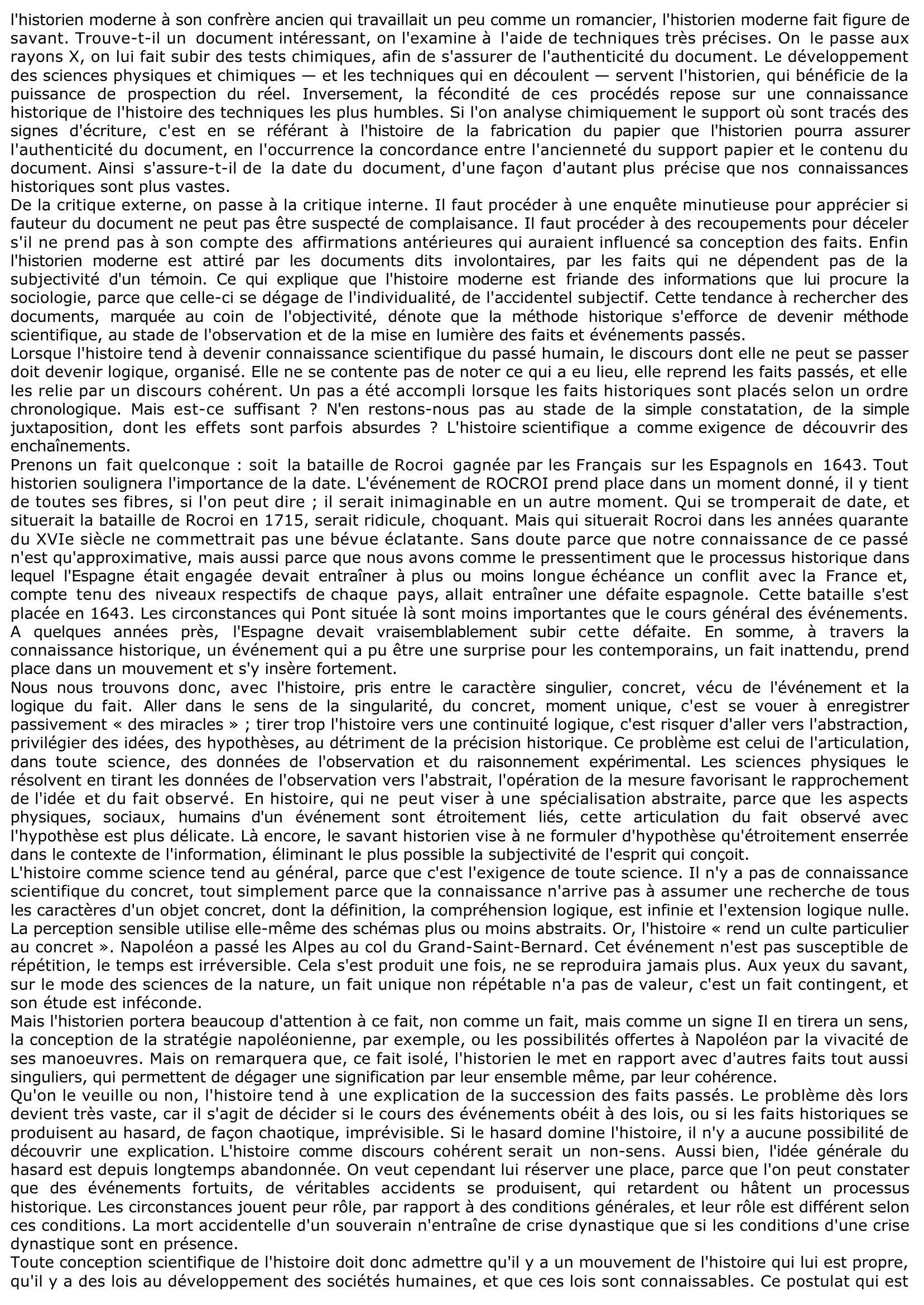Peut-on ranger l'histoire parmi les sciences ?
Publié le 12/01/2010
Extrait du document

- CONSEILS PRÉLIMINAIRES
- PLAN PROPOSÉ
1re partie. a) La méthode historique moderne s'entoure de toutes les garanties et de procédés techniques issus des sciences pour analyser et authentifier les documents. La critique externe et la critique interne sont du domaine de spécialistes de la recherche historique. L'histoire a cessé d'être une étude d'amateurs. b) L'événement historique et sa place en histoire. Histoire événementielle et histoire logique. 2e partie. e) L'histoire, tend, comme toute science, au général. Elle se heurte au concret particulier de l'événement b) L'historien tire de l'exemple concret une signification générale qui relie plusieurs faits. c) L'accident, les circonstances, les conditions en histoire. Conclusion. — L'histoire est à la recherche de son statut scientifique. L'idée de loi du mouvement historique la domine. Elle est une science, jeune encore, en pleine transformation.

«
l'historien moderne à son confrère ancien qui travaillait un peu comme un romancier, l'historien moderne fait figure desavant.
Trouve-t-il un document intéressant, on l'examine à l'aide de techniques très précises.
On le passe auxrayons X, on lui fait subir des tests chimiques, afin de s'assurer de l'authenticité du document.
Le développementdes sciences physiques et chimiques — et les techniques qui en découlent — servent l'historien, qui bénéficie de lapuissance de prospection du réel.
Inversement, la fécondité de ces procédés repose sur une connaissancehistorique de l'histoire des techniques les plus humbles.
Si l'on analyse chimiquement le support où sont tracés dessignes d'écriture, c'est en se référant à l'histoire de la fabrication du papier que l'historien pourra assurerl'authenticité du document, en l'occurrence la concordance entre l'ancienneté du support papier et le contenu dudocument.
Ainsi s'assure-t-il de la date du document, d'une façon d'autant plus précise que nos connaissanceshistoriques sont plus vastes.De la critique externe, on passe à la critique interne.
Il faut procéder à une enquête minutieuse pour apprécier sifauteur du document ne peut pas être suspecté de complaisance.
Il faut procéder à des recoupements pour décelers'il ne prend pas à son compte des affirmations antérieures qui auraient influencé sa conception des faits.
Enfinl'historien moderne est attiré par les documents dits involontaires, par les faits qui ne dépendent pas de lasubjectivité d'un témoin.
Ce qui explique que l'histoire moderne est friande des informations que lui procure lasociologie, parce que celle-ci se dégage de l'individualité, de l'accidentel subjectif.
Cette tendance à rechercher desdocuments, marquée au coin de l'objectivité, dénote que la méthode historique s'efforce de devenir méthodescientifique, au stade de l'observation et de la mise en lumière des faits et événements passés.Lorsque l'histoire tend à devenir connaissance scientifique du passé humain, le discours dont elle ne peut se passerdoit devenir logique, organisé.
Elle ne se contente pas de noter ce qui a eu lieu, elle reprend les faits passés, et elleles relie par un discours cohérent.
Un pas a été accompli lorsque les faits historiques sont placés selon un ordrechronologique.
Mais est-ce suffisant ? N'en restons-nous pas au stade de la simple constatation, de la simplejuxtaposition, dont les effets sont parfois absurdes ? L'histoire scientifique a comme exigence de découvrir desenchaînements.Prenons un fait quelconque : soit la bataille de Rocroi gagnée par les Français sur les Espagnols en 1643.
Touthistorien soulignera l'importance de la date.
L'événement de ROCROI prend place dans un moment donné, il y tientde toutes ses fibres, si l'on peut dire ; il serait inimaginable en un autre moment.
Qui se tromperait de date, etsituerait la bataille de Rocroi en 1715, serait ridicule, choquant.
Mais qui situerait Rocroi dans les années quarantedu XVIe siècle ne commettrait pas une bévue éclatante.
Sans doute parce que notre connaissance de ce passén'est qu'approximative, mais aussi parce que nous avons comme le pressentiment que le processus historique danslequel l'Espagne était engagée devait entraîner à plus ou moins longue échéance un conflit avec la France et,compte tenu des niveaux respectifs de chaque pays, allait entraîner une défaite espagnole.
Cette bataille s'estplacée en 1643.
Les circonstances qui Pont située là sont moins importantes que le cours général des événements.A quelques années près, l'Espagne devait vraisemblablement subir cette défaite.
En somme, à travers laconnaissance historique, un événement qui a pu être une surprise pour les contemporains, un fait inattendu, prendplace dans un mouvement et s'y insère fortement.Nous nous trouvons donc, avec l'histoire, pris entre le caractère singulier, concret, vécu de l'événement et lalogique du fait.
Aller dans le sens de la singularité, du concret, moment unique, c'est se vouer à enregistrerpassivement « des miracles » ; tirer trop l'histoire vers une continuité logique, c'est risquer d'aller vers l'abstraction,privilégier des idées, des hypothèses, au détriment de la précision historique.
Ce problème est celui de l'articulation,dans toute science, des données de l'observation et du raisonnement expérimental.
Les sciences physiques lerésolvent en tirant les données de l'observation vers l'abstrait, l'opération de la mesure favorisant le rapprochementde l'idée et du fait observé.
En histoire, qui ne peut viser à une spécialisation abstraite, parce que les aspectsphysiques, sociaux, humains d'un événement sont étroitement liés, cette articulation du fait observé avecl'hypothèse est plus délicate.
Là encore, le savant historien vise à ne formuler d'hypothèse qu'étroitement enserréedans le contexte de l'information, éliminant le plus possible la subjectivité de l'esprit qui conçoit.L'histoire comme science tend au général, parce que c'est l'exigence de toute science.
Il n'y a pas de connaissancescientifique du concret, tout simplement parce que la connaissance n'arrive pas à assumer une recherche de tousles caractères d'un objet concret, dont la définition, la compréhension logique, est infinie et l'extension logique nulle.La perception sensible utilise elle-même des schémas plus ou moins abstraits.
Or, l'histoire « rend un culte particulierau concret ».
Napoléon a passé les Alpes au col du Grand-Saint-Bernard.
Cet événement n'est pas susceptible derépétition, le temps est irréversible.
Cela s'est produit une fois, ne se reproduira jamais plus.
Aux yeux du savant,sur le mode des sciences de la nature, un fait unique non répétable n'a pas de valeur, c'est un fait contingent, etson étude est inféconde.Mais l'historien portera beaucoup d'attention à ce fait, non comme un fait, mais comme un signe Il en tirera un sens,la conception de la stratégie napoléonienne, par exemple, ou les possibilités offertes à Napoléon par la vivacité deses manoeuvres.
Mais on remarquera que, ce fait isolé, l'historien le met en rapport avec d'autres faits tout aussisinguliers, qui permettent de dégager une signification par leur ensemble même, par leur cohérence.Qu'on le veuille ou non, l'histoire tend à une explication de la succession des faits passés.
Le problème dès lorsdevient très vaste, car il s'agit de décider si le cours des événements obéit à des lois, ou si les faits historiques seproduisent au hasard, de façon chaotique, imprévisible.
Si le hasard domine l'histoire, il n'y a aucune possibilité dedécouvrir une explication.
L'histoire comme discours cohérent serait un non-sens.
Aussi bien, l'idée générale duhasard est depuis longtemps abandonnée.
On veut cependant lui réserver une place, parce que l'on peut constaterque des événements fortuits, de véritables accidents se produisent, qui retardent ou hâtent un processushistorique.
Les circonstances jouent peur rôle, par rapport à des conditions générales, et leur rôle est différent selonces conditions.
La mort accidentelle d'un souverain n'entraîne de crise dynastique que si les conditions d'une crisedynastique sont en présence.Toute conception scientifique de l'histoire doit donc admettre qu'il y a un mouvement de l'histoire qui lui est propre,qu'il y a des lois au développement des sociétés humaines, et que ces lois sont connaissables.
Ce postulat qui est.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- IDÉOLOGIE ET RATIONALITÉ DANS L’HISTOIRE DES SCIENCES DE LA VIE, 1977. Georges Canguilhem
- Georges Canguilhem, Idéologie et rationalité dans l'histoire des sciences de la vie (résumé et analyse)
- La méthode scientifique ( histoire de l'épistémologie des sciences)
- Seule l’histoire ne peut vraiment pas prendre rang au milieu des autres sciences de Schopenhauer
- Commenter ou discuter cette pensée de Renouvier : « La morale et les mathématiques ont cela de commun que, pour exister en tant que sciences, elles doivent se fonder sur de purs concepts. L'expérience et l’histoire sont plus loin de représenter les lois de la morale que la nature ne l’est de réaliser exactement les Idées mathématiques »