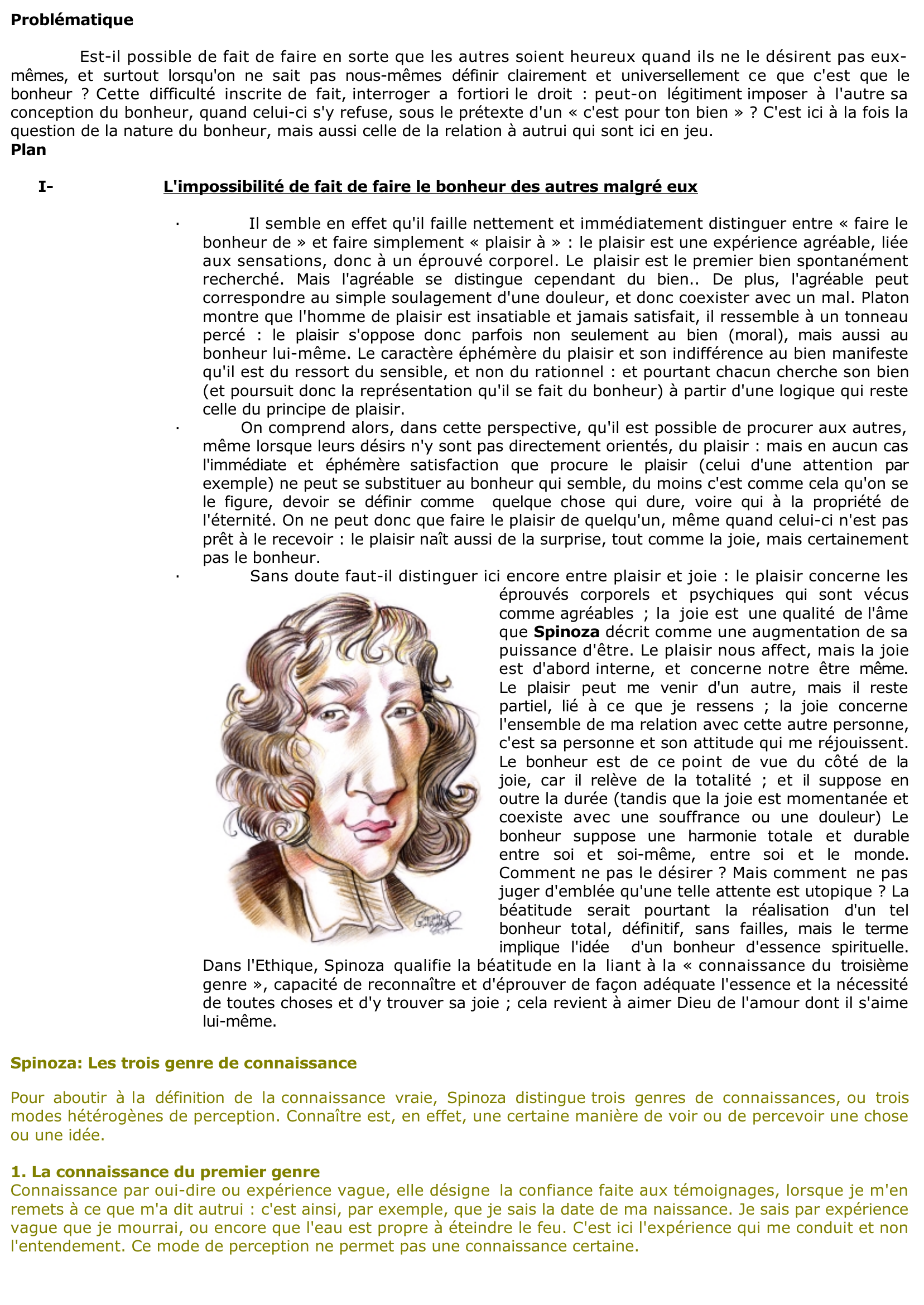Peut-on faire le bonheur des autres contre leur volonté ?
Publié le 27/02/2008
Extrait du document
«
Problématique Est-il possible de fait de faire en sorte que les autres soient heureux quand ils ne le désirent pas eux-mêmes, et surtout lorsqu'on ne sait pas nous-mêmes définir clairement et universellement ce que c'est que lebonheur ? Cette difficulté inscrite de fait, interroger a fortiori le droit : peut-on légitiment imposer à l'autre saconception du bonheur, quand celui-ci s'y refuse, sous le prétexte d'un « c'est pour ton bien » ? C'est ici à la fois laquestion de la nature du bonheur, mais aussi celle de la relation à autrui qui sont ici en jeu.Plan I- L'impossibilité de fait de faire le bonheur des autres malgré eux · Il semble en effet qu'il faille nettement et immédiatement distinguer entre « faire le bonheur de » et faire simplement « plaisir à » : le plaisir est une expérience agréable, liéeaux sensations, donc à un éprouvé corporel.
Le plaisir est le premier bien spontanémentrecherché.
Mais l'agréable se distingue cependant du bien..
De plus, l'agréable peutcorrespondre au simple soulagement d'une douleur, et donc coexister avec un mal.
Platonmontre que l'homme de plaisir est insatiable et jamais satisfait, il ressemble à un tonneaupercé : le plaisir s'oppose donc parfois non seulement au bien (moral), mais aussi aubonheur lui-même.
Le caractère éphémère du plaisir et son indifférence au bien manifestequ'il est du ressort du sensible, et non du rationnel : et pourtant chacun cherche son bien(et poursuit donc la représentation qu'il se fait du bonheur) à partir d'une logique qui restecelle du principe de plaisir. · On comprend alors, dans cette perspective, qu'il est possible de procurer aux autres, même lorsque leurs désirs n'y sont pas directement orientés, du plaisir : mais en aucun casl'immédiate et éphémère satisfaction que procure le plaisir (celui d'une attention parexemple) ne peut se substituer au bonheur qui semble, du moins c'est comme cela qu'on sele figure, devoir se définir comme quelque chose qui dure, voire qui à la propriété del'éternité.
On ne peut donc que faire le plaisir de quelqu'un, même quand celui-ci n'est pasprêt à le recevoir : le plaisir naît aussi de la surprise, tout comme la joie, mais certainementpas le bonheur. · Sans doute faut-il distinguer ici encore entre plaisir et joie : le plaisir concerne les éprouvés corporels et psychiques qui sont vécuscomme agréables ; la joie est une qualité de l'âmeque Spinoza décrit comme une augmentation de sa puissance d'être.
Le plaisir nous affect, mais la joieest d'abord interne, et concerne notre être même.Le plaisir peut me venir d'un autre, mais il restepartiel, lié à ce que je ressens ; la joie concernel'ensemble de ma relation avec cette autre personne,c'est sa personne et son attitude qui me réjouissent.Le bonheur est de ce point de vue du côté de lajoie, car il relève de la totalité ; et il suppose enoutre la durée (tandis que la joie est momentanée etcoexiste avec une souffrance ou une douleur) Lebonheur suppose une harmonie totale et durableentre soi et soi-même, entre soi et le monde.Comment ne pas le désirer ? Mais comment ne pasjuger d'emblée qu'une telle attente est utopique ? Labéatitude serait pourtant la réalisation d'un telbonheur total, définitif, sans failles, mais le termeimplique l'idée d'un bonheur d'essence spirituelle. Dans l'Ethique, Spinoza qualifie la béatitude en la liant à la « connaissance du troisièmegenre », capacité de reconnaître et d'éprouver de façon adéquate l'essence et la nécessitéde toutes choses et d'y trouver sa joie ; cela revient à aimer Dieu de l'amour dont il s'aimelui-même. Spinoza: Les trois genre de connaissance
Pour aboutir à la définition de la connaissance vraie, Spinoza distingue trois genres de connaissances, ou troismodes hétérogènes de perception.
Connaître est, en effet, une certaine manière de voir ou de percevoir une choseou une idée.
1.
La connaissance du premier genreConnaissance par oui-dire ou expérience vague, elle désigne la confiance faite aux témoignages, lorsque je m'enremets à ce que m'a dit autrui : c'est ainsi, par exemple, que je sais la date de ma naissance.
Je sais par expériencevague que je mourrai, ou encore que l'eau est propre à éteindre le feu.
C'est ici l'expérience qui me conduit et nonl'entendement.
Ce mode de perception ne permet pas une connaissance certaine..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Peut-on faire le bonheur d'autrui ?
- Que signifie « faire le bonheur des autres » ?
- Ai-je le devoir de faire le bonheur des autres?
- L’industrie peut-elle faire le bonheur de l’homme?
- Schopenhauer, Le Monde comme volonté et comme représentation: L'histoire; la liberté; le vivant; le bonheur (la culture).