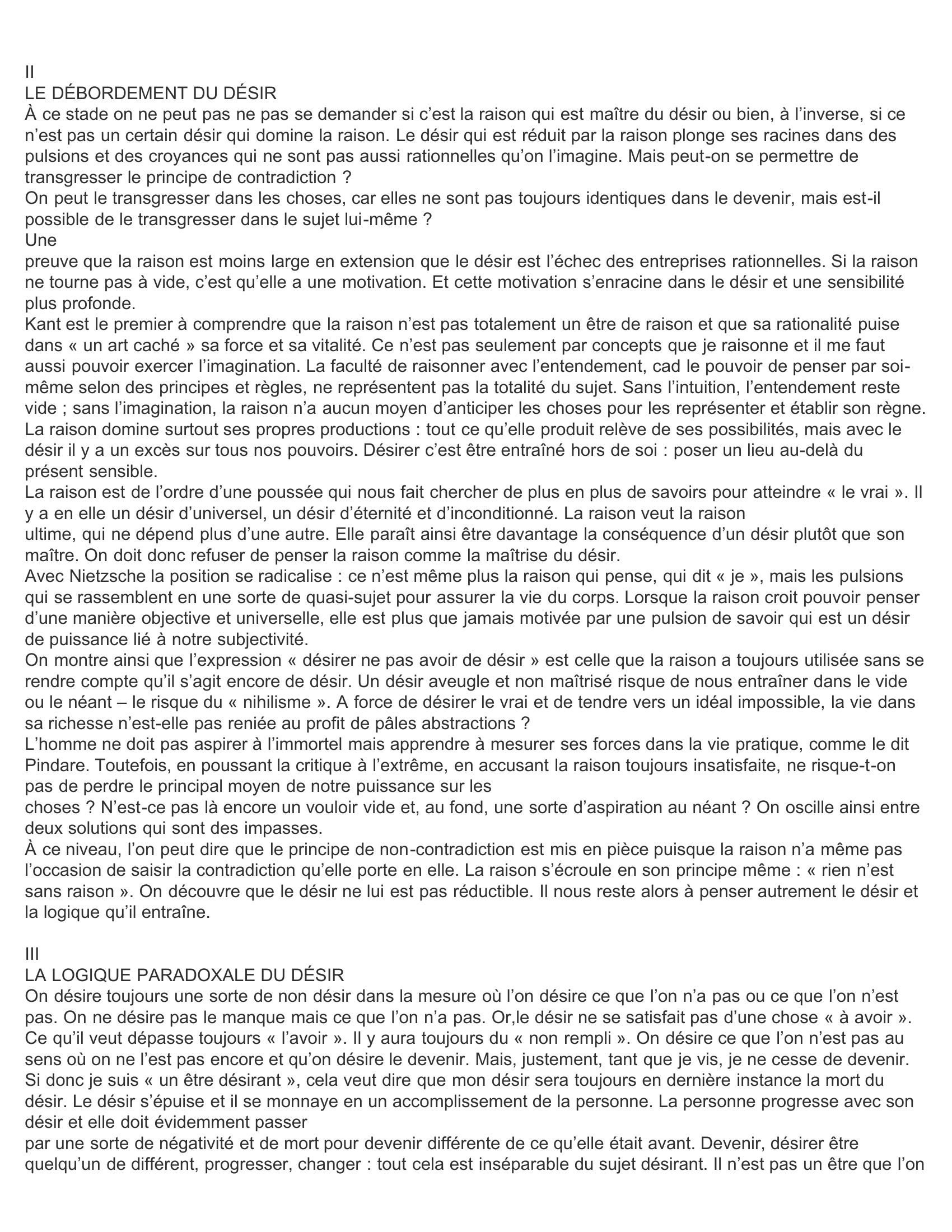Peut-on désirer ne pas avoir de désir ?
Publié le 27/02/2008
Extrait du document
«
II
LE DÉBORDEMENT DU DÉSIR
À ce stade on ne peut pas ne pas se demander si c’est la raison qui est maître du désir ou bien, à l’inverse, si ce
n’est pas un certain désir qui domine la raison.
Le désir qui est réduit par la raison plonge ses racines dans des
pulsions et des croyances qui ne sont pas aussi rationnelles qu’on l’imagine.
Mais peut -on se permettre de
transgresser le principe de contradiction ?
On peut le transgresser dans les choses, car elles ne sont pas toujours identiques dans le devenir, mais est -il
possible de le transgresser dans le sujet lui -même ?
Une
preuve que la raison est moins large en extension que le désir est l’échec des entreprises rationnelles.
Si la raison
ne tourne pas à vide, c’est qu’elle a une motivation.
Et cette motivation s’enracine dans le désir et une sensibilité
plus profonde.
Kant est le premier à comprendre que la raison n’est pas totalement un être de raison et que sa rationalité puise
dans « un art caché » sa force et sa vitalité.
Ce n’est pas seulement par concepts que je raisonne et il me faut
aussi pouvoir exercer l’imagination.
La faculté de raisonner avec l’entendement, cad le pouvoir de penser par soi -
même selon des principes et règles, ne représentent pas la totalité du sujet.
Sans l’intuition, l’entendement reste
vide ; sans l’imagination, la raison n’a aucun moyen d’anticiper les choses pour les représenter et établir son règne.
La raison domine surtout ses propres productions : tout ce qu’elle produit relève de ses possibilités, mais avec le
désir il y a un excès sur tous nos pouvoirs.
Désirer c’est être entraîné hors de soi : poser un lieu au-delà du
présent sensible.
La raison est de l’ordre d’une poussée qui nous fait chercher de plus en plus de savoirs pour atteindre « le vrai ».
Il
y a en elle un désir d’universel, un désir d’éternité et d’inconditionné.
La raison veut la raison
ultime, qui ne dépend plus d’une autre.
Elle paraît ainsi être davantage la conséquence d’un désir plutôt que son
maître.
On doit donc refuser de penser la raison comme la maîtrise du désir.
Avec Nietzsche la position se radicalise : ce n’est même plus la raison qui pense, qui dit « je », mais les pulsions
qui se rassemblent en une sorte de quasi-sujet pour assurer la vie du corps.
Lorsque la raison croit pouvoir penser
d’une manière objective et universelle, elle est plus que jamais motivée par une pulsion de savoir qui est un désir
de puissance lié à notre subjectivité.
On montre ainsi que l’expression « désirer ne pas avoir de désir » est celle que la raison a toujours utilisée sans se
rendre compte qu’il s’agit encore de désir.
Un désir aveugle et non maîtrisé risque de nous entraîner dans le vide
ou le néant – le risque du « nihilisme ».
A force de désirer le vrai et de tendre vers un idéal impossible, la vie dans
sa richesse n’est-elle pas reniée au profit de pâles abstractions ?
L’homme ne doit pas aspirer à l’immortel mais apprendre à mesurer ses forces dans la vie pratique, comme le dit
Pindare.
Toutefois, en poussant la critique à l’extrême, en accusant la raison toujours insatisfaite, ne risque-t -on
pas de perdre le principal moyen de notre puissance sur les
choses ? N’est -ce pas là encore un vouloir vide et, au fond, une sorte d’aspiration au néant ? On oscille ainsi entre
deux solutions qui sont des impasses.
À ce niveau, l’on peut dire que le principe de non -contradiction est mis en pièce puisque la raison n’a même pas
l’occasion de saisir la contradiction qu’elle porte en elle.
La raison s’écroule en son principe même : « rien n’est
sans raison ».
On découvre que le désir ne lui est pas réductible.
Il nous reste alors à penser autrement le désir et
la logique qu’il entraîne.
III
LA LOGIQUE PARADOXALE DU DÉSIR
On désire toujours une sorte de non désir dans la mesure où l’on désire ce que l’on n’a pas ou ce que l’on n’est
pas.
On ne désire pas le manque mais ce que l’on n’a pas.
Or,le désir ne se satisfait pas d’une chose « à avoir ».
Ce qu’il veut dépasse toujours « l’avoir ».
Il y aura toujours du « non rempli ».
On désire ce que l’on n’est pas au
sens où on ne l’est pas encore et qu’on désire le devenir.
Mais, justement, tant que je vis, je ne cesse de devenir.
Si donc je suis « un être désirant », cela veut dire que mon désir sera toujours en dernière instance la mort du
désir.
Le désir s’épuise et il se monnaye en un accomplissement de la personne.
La personne progresse avec son
désir et elle doit évidemment passer
par une sorte de négativité et de mort pour devenir différente de ce qu’elle était avant.
Devenir, désirer être
quelqu’un de différent, progresser, changer : tout cela est inséparable du sujet désirant.
Il n’est pas un être que l’on.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Rousseau et le désir: Malheur à qui n'a plus rien à désirer
- Peut-on désirer un désir sans fin ?
- Désirer est-ce necessairement aimer ? Le désir est-il nécessairement amour ?
- L'objet du désir doit-il être connu avant d'être désiré ? Pour que je puisse désirer, avoir le sentiment du désir, faut-il d'abord que je sache ce que je désire ?
- Peut-on désirer un désir sans fin ?