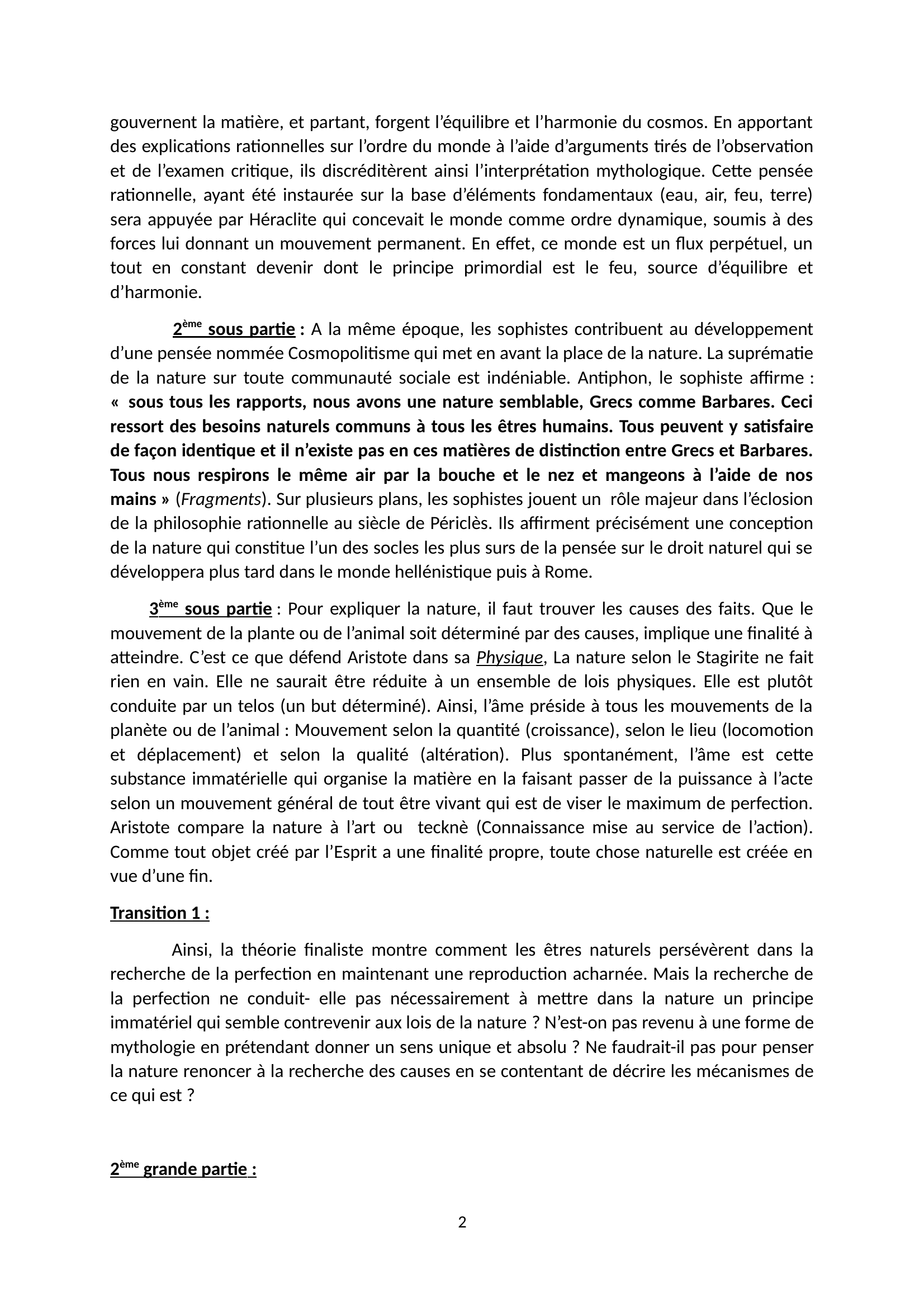Penser la nature
Publié le 27/04/2016
Extrait du document
«
gouvernent la matière, et partant, forgent l’équilibre et l’harmonie du cosmos.
En apportant
des explications rationnelles sur l’ordre du monde à l’aide d’arguments tirés de l’observation
et de l’examen critique, ils discréditèrent ainsi l’interprétation mythologique.
Cette pensée
rationnelle, ayant été instaurée sur la base d’éléments fondamentaux (eau, air, feu, terre)
sera appuyée par Héraclite qui concevait le monde comme ordre dynamique, soumis à des
forces lui donnant un mouvement permanent.
En effet, ce monde est un flux perpétuel, un
tout en constant devenir dont le principe primordial est le feu, source d’équilibre et
d’harmonie.
2 ème
sous partie : A la même époque, les sophistes contribuent au développement
d’une pensée nommée Cosmopolitisme qui met en avant la place de la nature.
La suprématie
de la nature sur toute communauté sociale est indéniable.
Antiphon, le sophiste affirme :
« sous tous les rapports, nous avons une nature semblable, Grecs comme Barbares.
Ceci
ressort des besoins naturels communs à tous les êtres humains.
Tous peuvent y satisfaire
de façon identique et il n’existe pas en ces matières de distinction entre Grecs et Barbares.
Tous nous respirons le même air par la bouche et le nez et mangeons à l’aide de nos
mains » ( Fragments ).
Sur plusieurs plans, les sophistes jouent un rôle majeur dans l’éclosion
de la philosophie rationnelle au siècle de Périclès.
Ils affirment précisément une conception
de la nature qui constitue l’un des socles les plus surs de la pensée sur le droit naturel qui se
développera plus tard dans le monde hellénistique puis à Rome.
3 ème
sous partie : Pour expliquer la nature, il faut trouver les causes des faits.
Que le
mouvement de la plante ou de l’animal soit déterminé par des causes, implique une finalité à
atteindre.
C’est ce que défend Aristote dans sa Physique , La nature selon le Stagirite ne fait
rien en vain.
Elle ne saurait être réduite à un ensemble de lois physiques.
Elle est plutôt
conduite par un telos (un but déterminé).
Ainsi, l’âme préside à tous les mouvements de la
planète ou de l’animal : Mouvement selon la quantité (croissance), selon le lieu (locomotion
et déplacement) et selon la qualité (altération).
Plus spontanément, l’âme est cette
substance immatérielle qui organise la matière en la faisant passer de la puissance à l’acte
selon un mouvement général de tout être vivant qui est de viser le maximum de perfection.
Aristote compare la nature à l’art ou tecknè (Connaissance mise au service de l’action).
Comme tout objet créé par l’Esprit a une finalité propre, toute chose naturelle est créée en
vue d’une fin.
Transition 1 :
Ainsi, la théorie finaliste montre comment les êtres naturels persévèrent dans la
recherche de la perfection en maintenant une reproduction acharnée.
Mais la recherche de
la perfection ne conduit- elle pas nécessairement à mettre dans la nature un principe
immatériel qui semble contrevenir aux lois de la nature ? N’est-on pas revenu à une forme de
mythologie en prétendant donner un sens unique et absolu ? Ne faudrait-il pas pour penser
la nature renoncer à la recherche des causes en se contentant de décrire les mécanismes de
ce qui est ?
2 ème
grande partie :
2.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Comment penser la nature ?
- Peut-on penser la société sans une quelconque référence à l'idée de nature ?
- Est-il raisonnable de penser que la nature poursuit des fins ?
- Est-il raisonnable de penser que la nature poursuit des fins ?
- « LA NATURE SE LAISSE-T-ELLE AISEMENT PENSER ? »